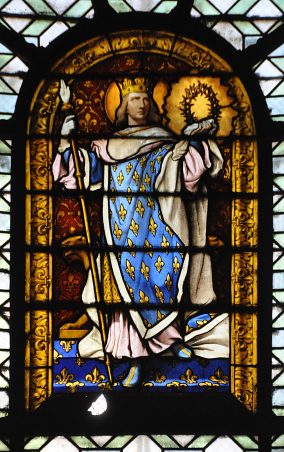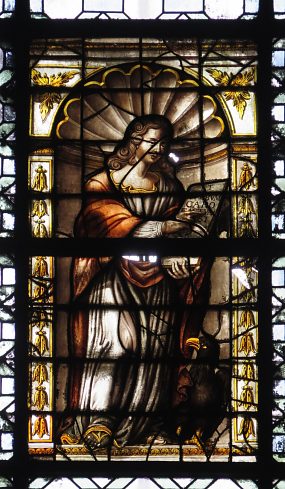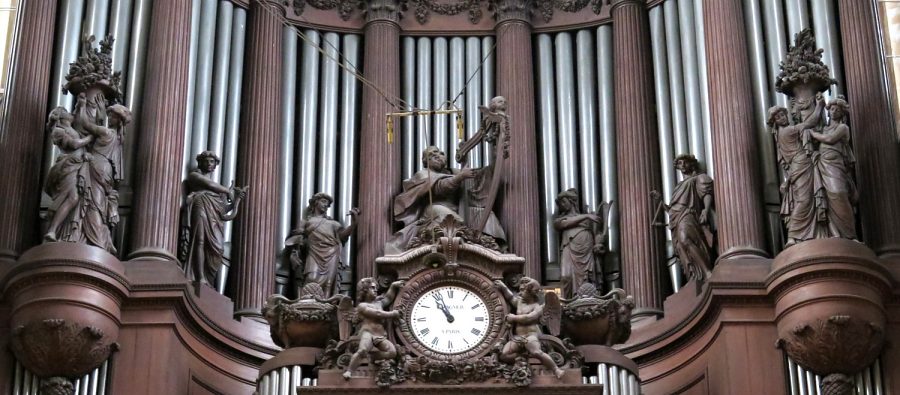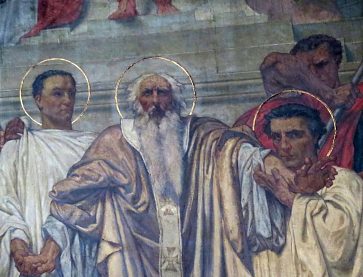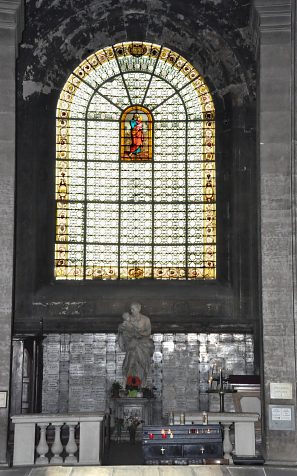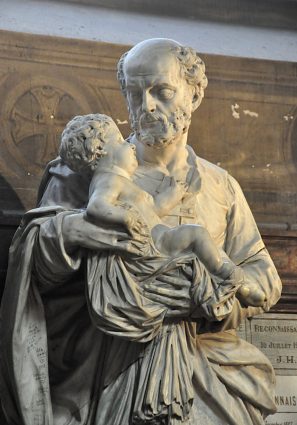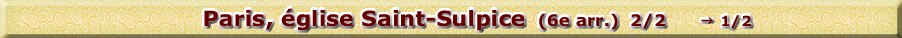 |
 |
Cette seconde page sur l'église
Saint-Sulpice propose des illustrations de toutes les chapelles
du déambulatoire, notamment la très belle chapelle
de la Vierge avec sa statue
de Jean-Baptiste Pigalle. Elle se termine par des photos de l'orgue
de tribune et une présentation rapide de cet instrument
célèbre, toujours tenu par des maîtres de renom.
La page contient un long encart
sur un phénomène très actuel, mais qui est
vu ici à l'aune du XVIIIe siècle : l'aide sociale
telle que l'a conçue Monsieur de Terssac, entré en
fonction en 1777 à la cure de Saint-Sulpice. Son objectif
était de gérer la pauvreté dans sa vaste paroisse.
Les caractéristiques de cette aide, dûment formalisée
et orchestrée, sont instructives.
|
 |
| LE DÉAMBULATOIRE
ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |
|

Entrée du déambulatoire sud.
Tout le style de l'église est un mariage heureux
entre le classique et le baroque.
|
| LA CHAPELLE RAYONNANTE
SAINT-DENIS |
|

«Saint Denis et ses compagnons conduits au supplice».
Peinture murale de Félix Jobbé-Duval, 1859.
Chapelle Saint-Denis. |

Vue d'ensemble de la chapelle Saint-Denis. |
«««---
Les deux compagnons de saint Denis sont
Rustique et Eleuthère. Tous trois furent décapités
sur ordre du préfet Fescennius, envoyé depuis
Rome contre les chrétiens de Paris (Légende
dorée). |
|
|
|
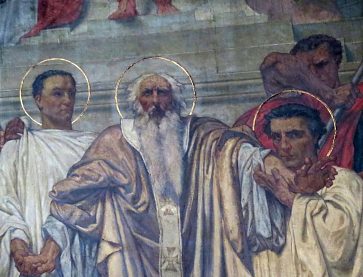
«Saint Denis et ses compagnons conduits au supplice»,
détail .
Peinture murale de Félix Jobbé-Duval, 1859
Chapelle Saint-Denis. |
 |
|
Architecture (2/2).
---»»» Son successeur,
Gilles-Marie Oppenord (1672-1742) ne changera
rien au style architectural de la nef, qu'il bâtira
cinquante ans plus tard grâce au financement tiré
de la loterie du curé Languet de Cergy.
On ne peut manquer d'être impressionné
par la hauteur des chapelles, traduction concrète
de la volonté du curé Jean-Jacques
Olier (1608-1657), qui a lancé le chantier,
de dresser, dans ce quartier sud de Paris, la plus grande
église de la capitale.
On remarque dans la photo la suite d'oculi au-dessus
de l'entablement. Ces verrières de la fin du
XVIIe siècle possèdent une bordure circulaire
à motif floral, semblable à celles des
vitraux des chapelles de la nef. La majeure partie du
vitrail est en verre blanc : les concepteurs appliquent
leur volonté de recherche de la lumière.
|
|
|
| LA CHAPELLE RAYONNANTE
SAINTE-GENEVIÈVE |
|

Sainte Catherine d'Alexandrie
Médaillon du vitrail de la chapelle Sainte-Geneviève.
Années 1670. |
|
L'aide
aux pauvres dans la paroisse Saint-Sulpice au XVIIIe
siècle (1/4).
L'aide sociale est omniprésente dans
nos sociétés modernes. Dans la France
de ce début du XXIe siècle, elle est même
devenue outrancière et elle a transformé
la démocratie en un vaste système de corruption.
Bien souvent au cours de l'Histoire, l'aide aux pauvres
ne s'est comprise qu'en échange d'un travail.
Il en fut ainsi dans l'Angleterre élisabéthaine.
Après les Poor Laws de 1563 et 1569, légiférant
sur la répression et les punitions qui devaient
frapper mendiants et vagabonds, l'Act de 1576
mit l'accent sur le travail : les villes devaient offrir
des emplois aux pauvres pour les détourner de
l'oisiveté. On les occupa à travailler
les matières premières, notamment la laine.
Les pauvres qui refusaient de travailler étaient
mis dans une prison de la ville, financée par
une taxe, the rates.
---»»» Suite 2/4 à droite.
|
|
|

L'autel de la chapelle Sainte Geneviève. |

«L'intercession de sainte Geneviève délivre
Paris de la peste des Ardents»
Peinture murale de Louis-Charles Timbal, 1864
Chapelle Sainte-Geneviève. |
|

«Sainte Geneviève distribuant des vivres aux habitants
de Paris»
Peinture murale de Louis-Charles Timbal, 1864
Chapelle Sainte-Geneviève. |
|
L'aide
aux pauvres... (2/4)
---»»»
En 1597, l'Act for the Relief of the Poor posa
les fondations de l'aide aux pauvres en Angleterre pour
les deux cent cinquante années suivantes. Chaque
paroisse administrative (parish) était
déclarée responsable de l'aide, avec désignation
de superviseurs pour veiller au respect de ses deux
axes principaux : proposer du travail et aider les pauvres
qui ne pouvaient pas travailler. Avec sanctions (fouet,
galère, voire pendaison dans les cas graves)
pour ceux qui ne voulaient rien faire. L'un des points
importants était l'existence d'une Poor tax
pour financer cette aide, renforcée par le droit
donné aux parishes de saisir les biens
de ceux qui refusaient de la payer.
En France, l'aide aux indigents, laissée à
la seule charité, a été pendant
très longtemps un des ministères de l'Église.
Les religieux jugés dignes de la canonisation
ont souvent brillé par leur action en faveur
des pauvres et de leur instruction. Au XVIIIe siècle,
l'église Saint-Sulpice offre un exemple intéressant
de cette aide en la personne de son curé, monsieur
de Terssac. Arrivé en 1777, celui-ci s'informe
tout de suite de la situation de la pauvreté
dans sa paroisse. Sur cent mille habitants, les pauvres
sont évalués à 20%. Mais, dès
le départ, M. de Terssac applique ses principes
humanitaires : sur ces vingt mille pauvres, il faut
distinguer les vrais des faux, «ceux qui ne sont
pauvres que par leur faute, parce qu'ils ne veulent
pas travailler... et dépensent en un jour ce
qui les ferait subsister des semaines entières.»
---»»» Suite 3/4
plus bas.
|
|
|
| LA CHAPELLE RAYONNANTE
SAINTE-ANNE |
|

Chapelle Sainte-Anne. |

|

«La Naissance de Marie»
Peinture murale de Lepneveu, 1864
Chapelle Sainte-Anne.

«««---
«L'Éducation de la Vierge»
Groupe en plâtre patiné avec un décor doré.
Julien-Jean Gourdel, 1841. |
|

«L'Éducation de la Vierge», détail (Gourdel,
1841). |

«La Naissance de Marie», détail.
Peinture murale de Lepneveu, 1864
Chapelle Sainte-Anne. |

«La Présentation de la Vierge au Temple»
Peinture murale de Lepneveu, 1864
Chapelle Sainte-Anne. |
|
L'aide
aux pauvres... (3/4)
---»»» Ainsi parle le curé
dans sa brochure Ordre d'administration pour le soulagement
des pauvres de la paroisse de Saint-Sulpice, un document
essentiel pour l'étude de l'aide apportée par
l'Église aux indigents, à la veille de la Révolution.
Il estime les faux pauvres à la moitié. Restent
donc dix mille pauvres, soit deux mille familles. Concrètement,
la paroisse est découpée en quatre secteurs.
Chacun d'entre eux dispose d'un registre où sont consignés
les noms, domiciles, mœurs et besoins des nécessiteux.
Les prêtres visitent les familles ; les dames de charité
prêtent leur concours. On rédige des notes et
on se réunit tous les mois pour faire le point sur
les besoins constatés sur le terrain.
Quelle est la nature de l'aide? M. de Terssac applique
là encore ses principes intransgressibles à
la liste des secours : toute aide directe en argent est exclue
; création de cartes mensuelles donnant droit à
du pain ; paiement partiel (et jamais total) des loyers ;
fourniture d'habits et de layette ; délivrance des
prisonniers pour dettes si c'est à l'avantage de la
famille ; soins apportés aux malades ; pensions modestes
données aux vieillards avec placement dans un hôpital
si personne n'est là pour s'occuper d'eux.
---»»» Suite 4/4
plus bas.
|
|

|

L'autel de la chapelle Sainte-Anne. |
«««---
À GAUCHE
Vitrail de l'Éducation de la Vierge.
Vitrail du XVIIe siècle refait en 1872.
Chapelle Sainte-Anne. |
|
| LA CHAPELLE AXIALE,
DITE «DE LA VIERGE» |
|

La chapelle de la Vierge.
Elle est la plupart du temps plongée dans la pénombre.
Il est très difficile de voir les peintures (la coupole
de François
Lemoyne (1688-1737) et les quatre tableaux de Carl Van Loo (1705-1765).
La photo ci-dessus a été éclaircie. |
«L'Assomption»
par François Lemoyne (1688-1737) ---»»»
Coupole de la chapelle de la Vierge
Cette photo a été éclaircie. Il est
très difficile d'observer
cette peinture dans de bonnes conditions. |
|

Le déambulatoire devant la chapelle de la Vierge.
Malgré la voûte à caisson, la chapelle axiale
est
toujours plongée dans la pénombre. |
|

Vue d'ensemble de la coupole conçue par Charles de Wailly
dans les années 1770.
Le décor central de François Lemoyne (1688-1737)
est éclairé très subtilement par
des fenêtres invisibles situées entre l'entablement
ovoïde et la peinture. |

|
|
L'aide
aux pauvres dans la paroisse Saint-Sulpice au XVIIIe
siècle (4/4).
---»»» Enfin, on cherche avant
tout à procurer du travail aux gens. Aux marchands
dont le commerce périclite on apporte un secours,
remboursable, après s'être assurés
de leur capacité et de leur conduite. Pour contrer
l'usure qui ruine le peuple, on instaure des prêts
sur gage.
Dans la pratique, le curé de Terssac demande
que les bienfaiteurs passent par sa paroisse afin que
l'information y soit centralisée (quelle aide?
à qui? combien? et quand?). Si l'aide est, malgré
tout, externe, il faut lui en communiquer les caractéristiques.
Son souci majeur est de conserver une aide efficace
et de ne jamais encourager les faux pauvres. Les règles
sont drastiques ; l'aide est soumise à une vigilance
permanente car elle exclut certaines personnes : ceux
qui travaillent pour l'opéra ou la comédie,
jouent de la musique dans les cabarets ou dans les rues
; les catholiques qui n'accomplissent pas leur devoir
religieux (mais aucune religion n'est exclue du secours)
; les mendiants (le vrai pauvre ne mendie pas) ; les
parents qui n'envoient pas leurs enfants au catéchisme
ou aux écoles de charité ; ceux qui produisent
des faux pour réclamer de l'aide ou dont la mauvaise
foi peut être prouvée.
Mis en application dès 1777, ces principes obtiennent
de très bons résultats et le curé,
dans sa brochure, s'en réjouit. Son texte s'étend
d'ailleurs sur la nature du travail offert : aux femmes,
la filature de lin et de chanvre, la broderie et la
couture ; aux hommes, grâce au concours du lieutenant
de police, le nettoyage des rues (en attendant un travail
plus lucratif) ; pour les enfants, des filatures de
soie ou de coton dès l'âge de sept ans
afin de les préserver de l'oisiveté tant
que l'âge de l'apprentissage (treize-quatorze
ans) n'est pas atteint. Le curé le rappelle :
«Ces différents moyens de soulager les
familles indigentes sont fondés sur le travail
et ont pour objet de leur en inspirer le goût
en les mettant pour ainsi dire dans la nécessité
de ne pas s'y refuser.» On estime que l'aide apportée
s'élevait environ à trois cent mille livres
par an.
Le règlement du curé de Saint-Sulpice
acquit une certaine réputation en France et à
l'étranger. L'impératrice Catherine II
en reçut trois exemplaires et remercia en envoyant
une médaille en or, commémorant la dernière
paix avec les Turcs. En 1778, madame Necker demanda
au curé de Terssac de diriger l'hôpital
qu'elle venait de créer et qui porte toujours
son nom. M. de Terssac mourut en 1788.
Sources : 1) De
pierre et de cœur, l'église Saint-Sulpice,
350 ans d'histoire
aux éditions du Cerf, article Monsieur de
Terssac et l'assistance aux pauvres de Michel Portal
; 2) Britain 1558-1689 aux éditions Collins,
série Flagship History.
|
|
|

Ornementation au-dessous de la coupole : les parties en stuc
et en bois doré (angelots et guirlandes)
sont dues à Sébastien-Antoine et Paul-Ambroise
Slodtz. Le tout est enrichi de médaillons
peints en camaïeu de gris décrivant des épisodes
de la vie de la Vierge. |

La Vierge à l'Enfant de Jean-Baptiste Pigalle, détail.
L'expression de la Vierge laisse échapper un léger
sourire,
mais on le perçoit mieux de loin (voir la photo à
droite).
|
|
La
chapelle de la Vierge est l'un des endroits
les plus anciens du monument. Gamard a dessiné
sa forme elliptique, le Vau en a élevé
les murs, et Servandoni est le père d'une partie
de la décoration. En 1774, Charles de Wailly
va l'enrichir d'une coupole ouverte, très originale,
chargée de plonger l'Assomption de François
Lemoyne dans une sorte de lumière céleste.
On peut y voir aussi deux toiles de Carl Van Loo
(1705-1765) portant sur la vie de la Vierge, et des
anges des frères Slodtz agrémentés
de guirlandes.
Enfin, l'élément le plus majestueux est
sans conteste la statue en marbre blanc, La Vierge
à l'Enfant, de Jean-Baptiste Pigalle
(1714-1785) dans une niche créée par Louis-Philippe
Mouchy (1734-1804), son neveu et élève.
Dans cette chapelle, le classique et le baroque se côtoient
d'heureuse manière, mais, en général,
la pénombre empêche de l'admirer pleinement.
|
|
|

La Vierge à l'Enfant
Statue en marbre blanc de
Jean-Baptiste Pigalle (1714-1785)
Chapelle de la Vierge
Voir l'autre statue parisienne de la Vierge
à l'Enfant
faite par Jean-Baptiste Pigalle
à l'église Saint-Eustache.
|

Vitrail de Chabin, détail
Chapelle de la Vierge. |
| LA CHAPELLE RAYONNANTE
SAINT-LOUIS |
|

« Saint Louis rendant la justice au pied d'un chêne»
Peinture murale de Louis Matout, 1870. |
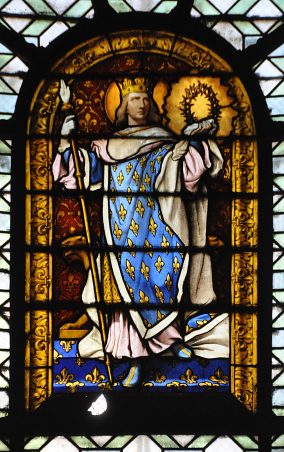
«Saint Louis»
Médaillon central du vitrail de 1691. |

Chapelle Saint Louis
Au centre trône la statue de sainte Thérèse de
Lisieux.
(La chapelle est également dédiée à sainte
Thérèse.) |
| LA CHAPELLE RAYONNANTE
SAINT-JOSEPH |
|
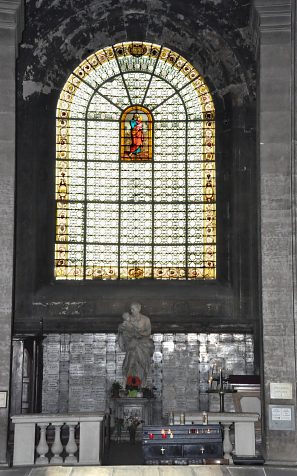
La chapelle Saint Joseph et ses nombreux ex-voto. |
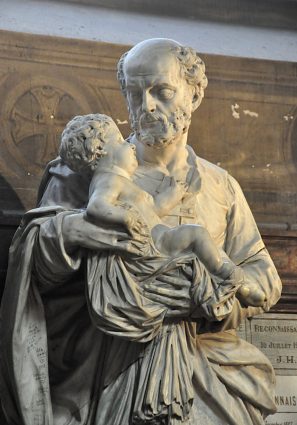
«Saint Joseph portant l'Enfant»
par Giovanni Marchiori, élève du Bernin, début
du XVIIe siècle.
Une statue magnifique dont le bas est malheureusement
saccagé par des tags. |
|

«Saint Joseph et l'Enfant Jésus»
Médaillon central du vitrail de la chapelle Saint-Joseph.
Vitrail de 1693, refait en 1872. |

«Le songe de saint Joseph», 1860.
Peinture murale de Charles Landelle (1812-1908). |

Suite de chapelles rayonnantes dans le déambulatoire
sud. |
|
| LA CHAPELLE RAYONNANTE
SAINT-CHARLES-BORROMÉE ET LA CHAPELLE RAYONNANTE SAINT-JEAN |
|

L'autel de la chapelle Saint-Charles-Borromée
et la partie basse d'une peinture d'Auguste Pichon :
«Charles de Borromée pendant la peste à Milan»,
1867. |

«Saint Antoine de Padoue en prière», 1686.
Chapelle Saint-Charles-Borromée. |
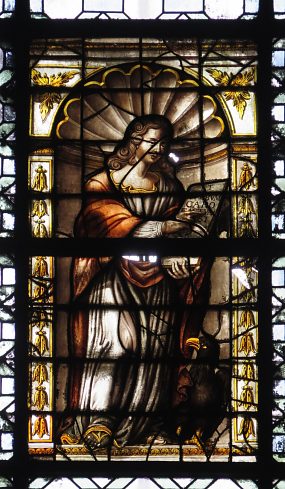
«Saint Jean l'évangéliste», 1692.
Chapelle Saint-Jean. |

«Saint Jean l'évangéliste», détail
(1692).
Chapelle Saint-Jean. |
|
L'orgue
de Saint-Sulpice jouit d'une renommée
internationale. Construit par Cliquot en 1781
(avec 5 claviers et 64 jeux), on le regardait déjà,
à l'époque, comme l'un des meilleurs du
royaume. Aristide Cavaillé-Coll le reconstruisit
de 1857 à 1861 (avec cent jeux). Il réutilisa
de nombreux éléments créés
par Cliquot pour lier la tradition classique au romantisme.
Le XXe siècle a respecté cet illustre
instrument : il a conservé toutes ses caractéristiques
d'origine. Charles-Marie Widor et Marcel Dupré
en furent titulaires.
|
|
|
|
|

Le très célèbre orgue de tribune de l'église
Saint-Sulpice.
Le buffet a été dessiné en 1781 par Jean-François
Chalgrin. |
|
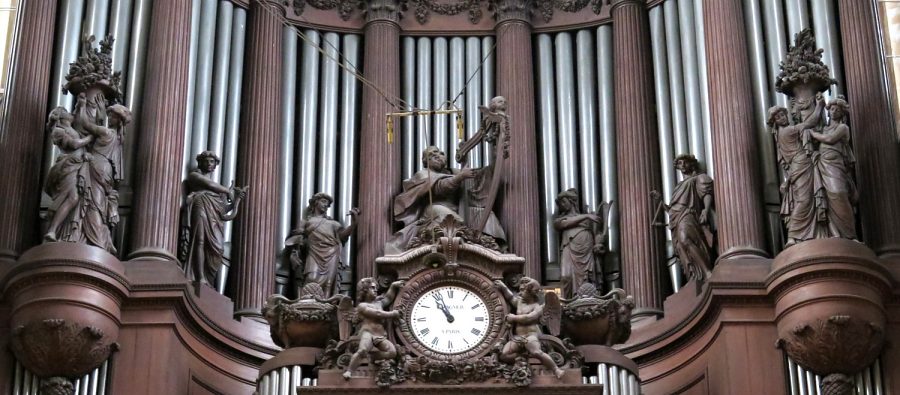
Les personnages du buffet d'orgue. Au centre, David jouant de la harpe. |

Les anges musiciens sur le couronnement de l'orgue. |

Les angelots musiciens sur le couronnement d'une tourelle. |
|

David jouant de la harpe
par François-Joseph Duret (1732-1816). |
À DROITE ---»»»
Femmes tenant une corne d'abondance
sur le buffet d'orgue. |
|
|

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur. |
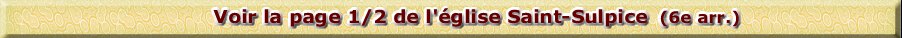
|
Documentation : «Paris d'église
en église» (Massin éditeur), ISBN :978-2-7072-0583-4
+ «Saint-Sulpice», brochure disponible dans la nef + «Louis-Simon
Boizot (1743-1809)», Musée Lambinet, Somogy, Éditions
d'Art, 2001
+ «De pierre et de cœur, l'église Saint-Sulpice,
350 ans d'histoire» aux éditions du Cerf, 1996. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |