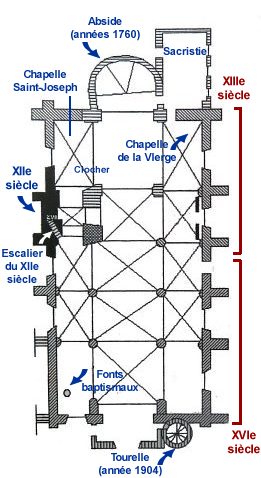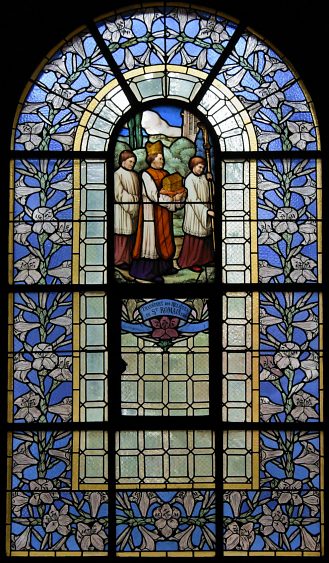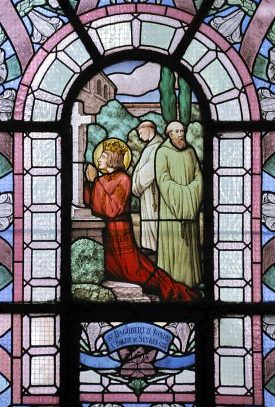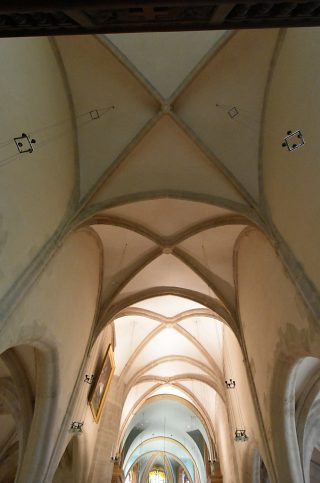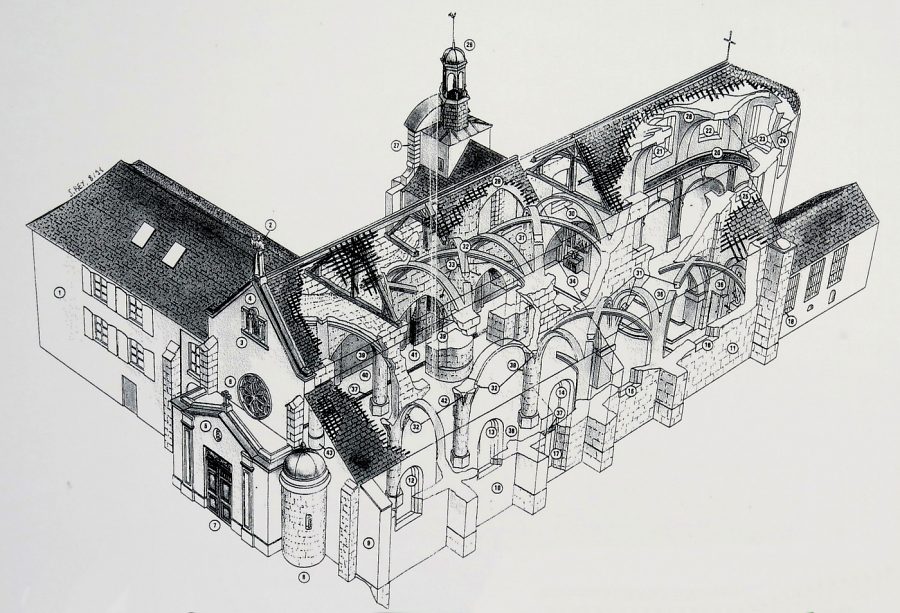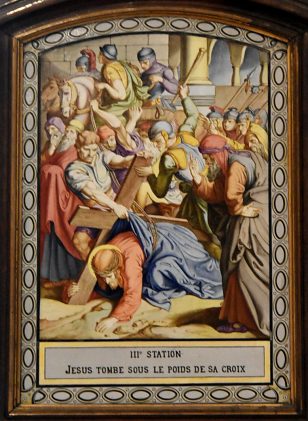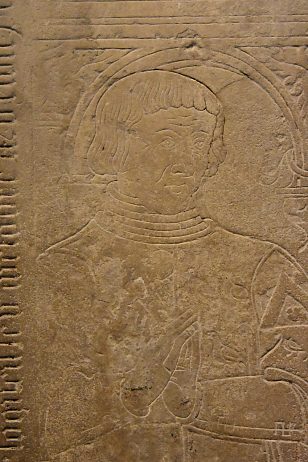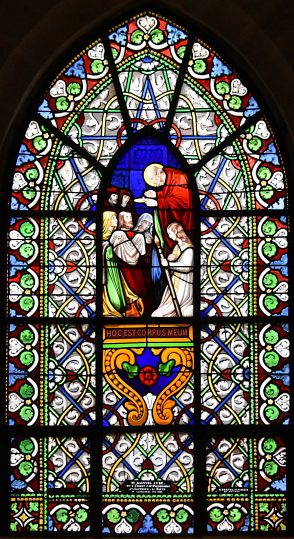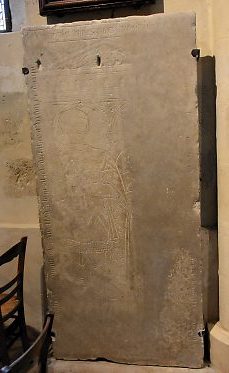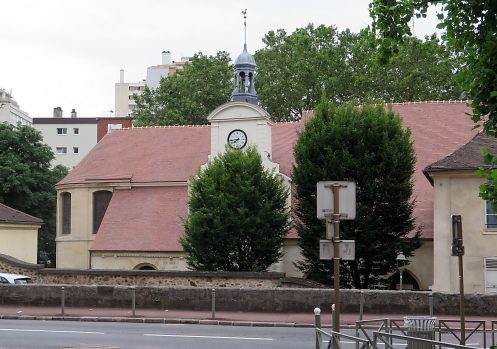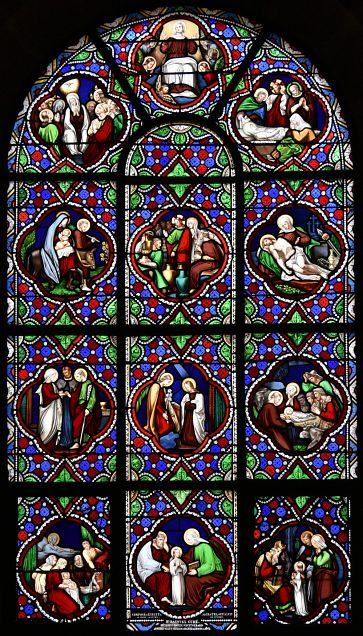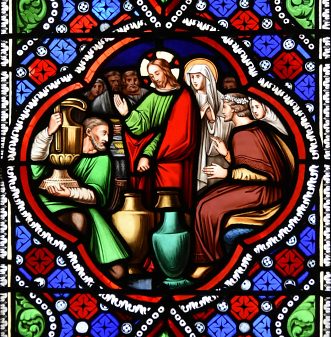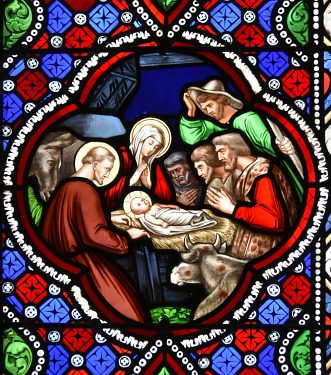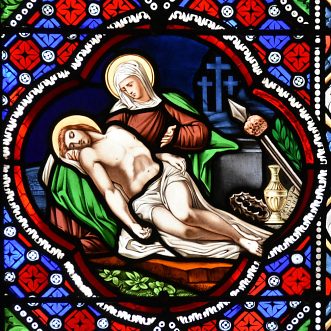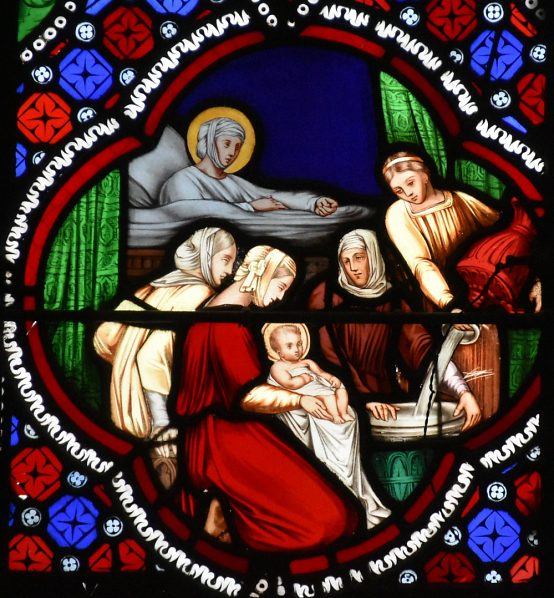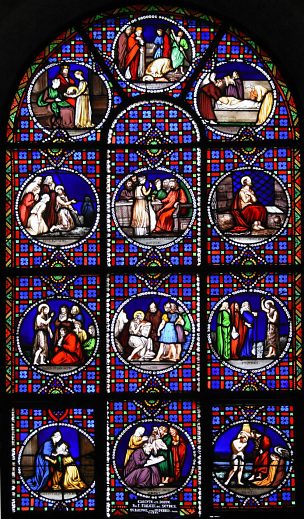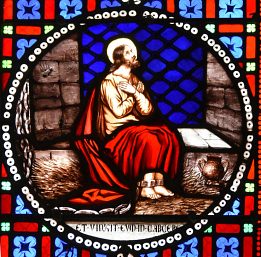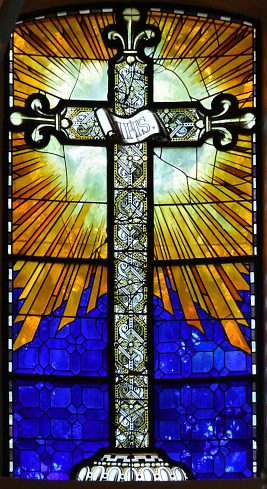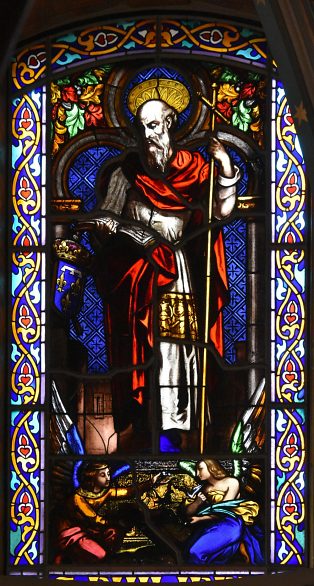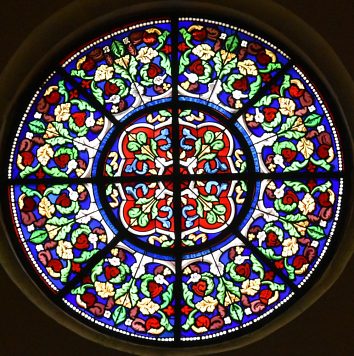|
|
 |
 |
Sur son clocher et dans son entrée,
on lit que l'église Saint-Romain a été fondée
en 675 par le roi
Dagobert II. Cependant, les historiens n'en ont aucune preuve. Dans
la réalité, ce lieu entre deux coteaux, au milieu
des marais, abritait, depuis l'époque romaine, un petit port
sur une rivière du nom de Savara. D'où la dédicace
future à saint Romain, patron des mariniers. Ce port était
utilisé pour le convoyage vers la Seine des pierres extraites
des carrières avoisinantes. Il devait donc y avoir quelque
part un petit édifice pour le culte sans que l'on sache où.
On sait que, vers l'an 560, l'évêque saint Germain
(voir vitraux
plus bas) y fit une tournée pastorale. Quel est le rôle
de Dagobert II dans l'érection éventuelle d'une nouvelle
église? C'est un mystère. Quoi qu'il en soit, l'édifice
et tout le village ont dû subir le saccage des Normands au
IXe siècle. L'église sera rebâtie au XIe en
style roman à l'endroit où s'élève l'édifice
actuel.
De cette première construction médiévale, il
nous reste quelques éléments sur le côté
nord : la base du clocher roman et plusieurs voûtes du
bas-côté. Au début du XVIe siècle, l'édifice
est agrandi vers l'ouest de plusieurs travées. Sous Louis
XV, en raison de la présence de la Manufacture royale de
porcelaine, l'église devient Paroisse royale. Pour
accueillir tous les fidèles, sa partie orientale est agrandie
d'une abside semi-circulaire
dont l'axe n'est pas dans l'alignement exact de la nef. Au cours
de son histoire, Saint-Romain a vu ses fondations et sa structure
même sapées par l'humidité. Les abbés
n'ont cessé de réclamer de l'aide pour restaurer un
édifice si délabré et malsain que les Sévriens
hésitaient à le fréquenter. En 1788, le clocher,
menaçant ruine, est démoli. Il ne sera jamais reconstruit.
Aujourd'hui, c'est un simple campanile
que le remplace.
À la Révolution, l'église devient temple de
la Raison. L'atmosphère dans la petite ville est assez survoltée,
ce que la proximité de Paris explique sûrement. De
1807 à 1850, les demandes de restauration s'enchaînent.
En 1859, Napoléon III lui-même est sollicité.
Plutôt que de restaurer, c'est un projet de nouvelle
église érigée non loin qui est élaboré
; des fonds sont prévus. Mais la guerre de 1870 en empêche
la concrétisation. Au début du XXe siècle,
l'entrée de l'église est modifiée : un nouveau
porche et tribune pour l'orgue avec tourelle d'accès extérieure.
Mais l'humidité frappe toujours. Pour un clerc, être
nommé à la cure de Sèvres
n'est pas un honneur. De plus, les Sévriens, travaillant
presque tous à Paris, ne fréquentent pas l'église.
En 1989, des fouilles sont entreprises par la Société
d'Archéologie et d'Histoire de Sèvres dans le
sol de l'église. On découvrira des pierres
tombales, des corps inhumés là depuis des siècles
et quelques pièces de monnaie dont la plus ancienne remonte
à 1461. On mettra aussi à jour un étroit escalier
du XIIe siècle, jusque-là caché. Enfin, en
2017-2019, d'importants travaux de restauration et de consolidation
seront entrepris.
Quand on visite l'ouest parisien, il est bon de connaître
l'église Saint-Romain. Outre le charme de ses vieilles pierres,
l'édifice est riche de vitraux
du XIXe siècle qui sont des marqueurs de la renaissance du
vitrail français à cette époque. Trois ont
été réalisés par la Manufacture de porcelaine
de Sèvres, mais l'essentiel vient de l'atelier de François
Fialex, un verrier formé à la Manufacture.
|
 |

Vue d'ensemble de la nef quand on entre dans l'église.
Le chœur est très légèrement décalé
vers la gauche.
Est-ce un rappel de la position de la tête du Christ sur la
croix au moment de sa mort ? |

Le côté sud de l'église et ses contreforts
du XIIIe siècle.
La tourelle sur la façade a été bâtie
en 1904 pour accéder à la tribune de l'orgue. |

L'inscription «675-1893»
sur le clocher est folklorique. |
|
Une
origine en 675 ? L'année 675 qui figure
sur le clocher de l'église n'est rattachée
à aucun fait historique. Elle a été
inscrite sous l'autorité du curé Antoine
Brazillier à l'occasion des travaux effectués
dans son église en 1893. Ce prélat était
visiblement persuadé que Saint-Romain avait été
fondée en 675, sous le règne de Dagobert
II, un roi de la dynastie mérovingienne, grand
fondateur d'églises et, plus tard, canonisé.
En réalité, il n'en est rien. Aucun élément
archéologique ne l'atteste. En 1894, la Commission
des Antiquités et Arts de Seine et Oise a qualifié
l'inscription «675-1893» de pure
hérésie archéologique, mais n'a
pu réussir à la faire supprimer. Certes,
en 1989, des fouilles ont mis à jour des tessons
et des poteries à deux mètres de profondeur
sous l'église, sans que les archéologues
sachent à quel siècle les raccrocher :
époque gallo-romaine ou mérovingienne
?
À l'époque de Dagobert II, quand le christianisme
s'efforçait encore d'éradiquer les tout
derniers vestiges du paganisme, un centre d'activité
humaine ne pouvait se concevoir sans un lieu de culte
chrétien (au minimum un baptistère ou
une chapelle), mais rien ne prouve qu'il s'élevait
à cet endroit. Les première traces de
l'église actuelle datent du XIIIe siècle.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse, 2009.
|
|
|
|
La dédicace
à saint Romain, patron des mariniers. Elle
date de 1504 et s'explique par la géographie. L'église
était jusque-là dédicacée à
saint Jean-Baptiste.
Le village de Sèvres
(anciennement Savara) était à l'origine
une zone assez marécageuse, traversée par une
petite rivière, le Ru de Marivel, qui prenait sa source
près de Porchefontaine, un quartier actuel de Versailles.
Étangs et marais se rencontraient partout. «L'eau
venait aussi des étangs de Chaville et des Bruyères,
ainsi que des étangs de Ville
d'Avray, avant qu'ils ne soient détournés
vers le château de St-Cloud au XVIIe siècle»,
lit-on dans le livret édité par la paroisse.
Dans cette petite vallée entre deux coteaux de l'ouest
parisien, l'eau se déversait dans des fontaines, des
puits, des abreuvoirs, des lavoirs. L'eau permettait aussi
d'actionner des moulins. D'où la présence d'industries
prospères : tanneries, brasseries et surtout blanchisseries.
Les Romains, grands bâtisseurs, exploitèrent
les nombreuses carrières de la contrée utilisant
le Ru pour le transport. Plus tard, la rivière fut
aménagée et l'on put naviguer depuis la Seine
jusqu'au port, situé devant le parvis de l'église.
Y avait-il danger à naviguer sur le Ru ? Fallait-il
un saint protecteur pour écarter les périls
? On croira plutôt que la dédicace à saint
Romain était toute symbolique et voulait rappeler l'importance,
pour le village, du transport par voie d'eau et celle de ses
acteurs.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse, 2009.
|
|

La façade de l'église a été refaite à
la toute fin du XIXe siècle. |

Le chevet et la sacristie. |

La statue de saint Romain sur le pignon est datée de 1901.
La barque qu'il tient dans la main, rappelle
que Romain est le saint patron des mariniers. |

L'élévation sud et le bas-côté sud. La
hauteur sous voûte est de 14 mètres.
Cette partie de l'église remonte au XVIe siècle. |
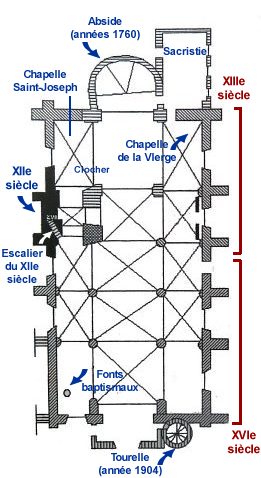
Plan de l'église Saint-Romain. |
|
Architecture
intérieure. L'église Saint-Romain
accuse, en interne, 45 mètres de long sur 15 mètres
de large avec une hauteur sous voûte de 14 mètres.
Malgré sa petite taille, elle regorge de richesses
architecturales, mêlant le roman et le gothique.
La nef s'étale sur cinq travées. Le chœur
occupait jadis le centre de la 5e travée. En 1765,
il a été déplacé dans une abside
construite lors de travaux d'agrandissement.
La moitié orientale de l'édifice est datée
du XIIIe siècle, mais il y subsiste encore une partie
du XIIe siècle, de style roman, en aplomb du clocher
(partie noire dans le dessin ci-contre). C'est là que,
en 1989, des travaux ont dégagé un escalier
très étroit desservant le clocher. Cet escalier
demeure l'un des points les plus pittoresques de l'édifice.
Dans cette partie de l'église, le visiteur, en levant
la tête, apercevra des clés de voûte avec
têtes humaines, des nervures d'ogives dont la variété
signe l'évolution artistique au fil des siècles,
des voûtes peintes de rinceaux polychromes. Sur le mur
gouttereau du clocher, il verra une console du XIIe siècle
avec deux angelots tenant un écu... C'est le monde
grisant des vieilles pierres avec leur histoire et leurs transformations.
Les trois premières travées (partie occidentale)
remontent au XVIe siècle. On y voit des piles cylindriques,
des arcades en plein cintre rappelant l'art roman et tombant
en pénétration sur les piles, des bas-côtés
avec des arcades en tiers-point rappelant le style gothique.
Le tout est voûté d'ogives et dégage une
atmosphère médiévale. On pourrait croire
déambuler, très agréablement, dans un
édifice très ancien.
L'église a subi une importante restauration de 2017
à 2019, portant notamment sur la 5e travée et
l'abside. Les arcades qui séparent la nef des deux
chapelles, minées par les fissures, étaient
renforcées d'impressionnants étais de bois.
La restauration a bien mis en lumière l'opposition
entre le monde médiéval de la nef et l'aspect
de style classique de l'abside.
|
|

«Angelus custos (L'Ange gardien) dans le bas-côté
nord.
Ce vitrail a été commandé en 1840
par la reine Amélie à la Manufacture de Sèvres.
Le dessin central est d'Henri Decaisne. |
|
Les vitraux
de Saint-Romain datent du XIXe siècle. Trois
sont des créations de l'atelier de peinture sur verre
de la Manufacture de Sèvres
: «l'Ange gardien» donné ci-contre est
une commande de la reine Amélie en 1840 ; les deux
vitraux de l'abside montrant saint Louis et saint Philippe,
offerts par Louis-Philippe, ont été installés
en 1839 et 1847. Endommagé lors d'un orage, le vitrail
de saint Louis a été refait par le verrier parisien
Philippe Giot en 1928.
Les fenêtres de la chapelle de la Vierge et de la chapelle
Saint-Joseph reçoivent deux verrières dites
légendaires réalisées par l'atelier
François Fialex à Mayet, près du Mans
: une Vie
de saint Jean-Baptiste (vitrail de 1843) et une Vie
de la Vierge (vitrail de 1846). Dans les Hauts-de-Seine,
Saint-Romain est la seule église qui conserve des verrières
figurées du XIXe siècle antérieures à
1850.
François Fialex (1818-1886) a été
formé à la Manufacture de Sèvres
qu'il a quittée en 1840. --»» 2/2
|
|
|
Jeanne
d'Arc à Sèvres ? (1/2)
Le tableau de Paul-Hippolyte Flandrin, qui
possédait une maison et un atelier à Sèvres,
pourrait laisser croire à la venue de cette icône
de l'Histoire de France dans ce petit village à
l'ouest de Paris. Mais, selon les historiens, il n'en
est rien. Historiquement, on sait que l'armée
du roi Charles VII partit de Reims avec Jeanne d'Arc
en août 1429. Les troupes se dirigèrent
vers Paris via Château-Thierry, Provins et Compiègne.
À l'assaut des murailles de la capitale, Jeanne
reçut un trait d'arbalète dans la cuisse.
Puis elle fit retraite vers Compiègne en passant
par l'est de Paris. À quelle occasion Jeanne
d'Arc aurait-elle pu passer par Sèvres
?
Les archives de cette époque permettent de suivre
son itinéraire jour après jour et on n'y
trouve aucune trace de ville ou de village du sud-ouest
parisien. Cette région était de plus très
fortement tenue par les Anglais à cause du pont
de Saint-Cloud.
C'était, en aval de Paris, le seul pont pour
traverser la Seine et donc pour communiquer avec la
Normandie.
Cette croyance de la venue de Jeanne d'Arc à
Sèvres
vient du clergé local. Une série de notes
écrite au XIXe siècle par l'abbé
Bainvel fut reprise en 1899 par l'abbé Lefèbvre
dans une parution hebdomadaire du diocèse de
Versailles.
Elle affirmait, tout à fait dogmatiquement, que
Jeanne était passée par Sèvres
en 1429. Avec sa troupe, elle aurait attaqué
un poste anglais installé ---»»
2/2
|
|

Le baptistère est dominé par l'Ecce homo
de O'Hara de Nieuverkerke. |
|

«Jeanne d'Arc à Saint-Romain», 1901.
Tableau de Paul-Hippolyte Flandrin (1856-1921). |
|
Jeanne d'Arc à Sèvres ? (2/2)
---»» à flanc de coteau. Beaucoup
d'Anglais seraient morts, dont leur chef, un dénommé
Bossey. Le reste se serait enfui. Après la bataille,
Jeanne serait allée prier à l'église
pour remercier Dieu de cette victoire. Par la suite,
Bossey aurait donné son nom au lieu-dit de la
Croix-Bosset, un quartier de Sèvres
qui existe toujours. L'abbé Bainvel rapporte
dans ses notes que des ossements humains d'hommes ont
été trouvés à maintes reprises,
lors de travaux de jardinage ou de voirie, dans le lieu
de Croix-Bosset. Il pourrait donc s'agir des restes
de soldats anglais...
Cette histoire branlante ne tient que par la ressemblance
factice des noms. Une histoire comme le XIXe siècle
savait en inventer... En réalité , le
nom de Croix-Bosset viendrait plutôt de «Croix
boissée», c'est-à-dire une croix
ornée de buis. En effet, «(...) le jour
des Rameaux, on ornait de couronnes de buis bénit
le calvaire des cimetières et les croix des carrefours»,
lit-on dans le livret édité par la paroisse.
Quoi qu'il soit, dans les années 1900, mettant
à profit un legs de deux mille francs pour l'acquisition
d'un tableau religieux, la fabrique de Saint-Romain
acheta cette toile et son sujet si équivoque
au peintre Paul-Hippolyte Flandrin.
Dernier détail intéressant : d'après
les témoignages de ses descendants, Flandrin
se serait inspiré des visages des membres de
sa famille pour peindre les figures des personnages.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse, 2009.
|
|
|

Bas-relief «Ecce homo»
Œuvre d'O'Hara de Nieuverkerke, 1849. |

Le bas-côté nord aboutit à la chapelle Saint-Joseph. |

Chemin de croix, IVe station.
Porcelaine de Sèvres, 1873. |

«Le Baptême du Christ»
Haut-relief attribué à Louis-Simon Boizot. |
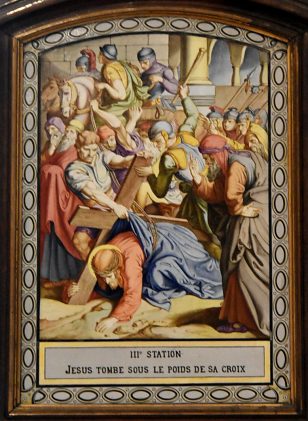
Chemin de croix, IIIe station
Porcelaine de Sèvres, 1873. |

La partie ouest du bas-côté nord est la plus ancienne
de l'église (XIIe et XIIIe siècles).
La pile massive à section à moitié carrée
est née de la
consolidation intervenue en 1688 pour soutenir le clocher. |
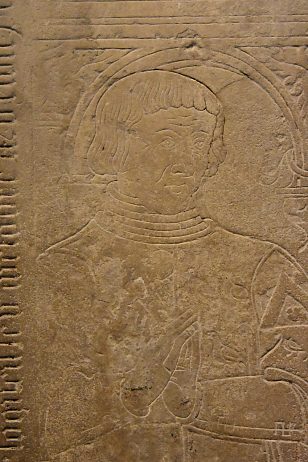
Pierre tombale de Henry de Livres
(mort en 1539), détail. |
|

«La Descente de croix»
Bas-relief en plâtre attribué à Henri-Victor
Roguier. |

Liste des bienfaiteurs de l'église, détail.
Voir plus haut
ce qu'il faut penser
de la référence à l'année 675. |

«Jeanne d'Arc à Saint-Romain», détail.
Tableau de Paul-Hippolyte Flandrin. |

La nef et le bas-côté sud vus depuis l'avant-nef
sud. |
|
Le
Baptême du Christ.
Pendant longtemps, cette œuvre
a été attribuée au sculpteur
Henri-Victor Roguier (1758-1841), élève
de Louis-Simon Boizot et attaché à
la Manufacture de Sèvres.
À l'occasion de récents travaux
de restauration, lit-on dans une note affichée
dans la nef, les spécialistes ont pu l'attribuer
à son véritable auteur : Louis-Simon
Boizot (1743-1809) qui fut chef de l'atelier
des sculptures à la Manufacture de Sèvres
et qui eut donc Roguier parmi ses élèves.
Cette attribution à Boizot est néanmoins
un peu étonnante. Cet artiste était
franc-maçon et détournait son art
de tout sujet lié à la religion
chrétienne et à la Bible.
On lui doit maintes pièces illustrant les
mythes gréco-romains (Diane, Vénus,
Apollon, Cybèle, etc.). On lui doit aussi
une très attachante Marie-Antoinette présentant
le dauphin (avec une reine de France à
la poitrine dénudée comme les déesses).
Bien des attributions à cet artiste ne
sont pas certaines par manque de documents formels.
Lui attribuer un haut-relief sur le Baptême
du Christ doit être fait avec précaution.
Voir un encadré
sur Boizot à l'exposition de porcelaine
de Sèvres donnée au musée
des Beaux Arts de Troyes.
|
|

Le Père céleste dans «Le Baptême
du Christ»
attribué à Louis-Simon Boizot (1758-1809). |
|

Le bas-côté nord et l'escalier médiéval. |

Deux anges tiennent un écusson dans
une console romane du bas-côté nord (XIIe
siècle). |
|
L'escalier
du clocher. La photo ci-contre montre
l'endroit le plus ancien de l'église (quatrième
travée). Le mur gouttereau et son escalier
datent du XIIe siècle. L'arcade en plein
cintre signe le style roman (associé à
une belle console d'un écusson tenu par
deux anges), tandis que l'arcade qui la précède
(au premier plan) est en tiers point, donc de
style gothique. Sur la droite, la grosse pile
de section carrée qui soutient le clocher,
remonte au Moyen Âge, mais elle a été
refaite au XVIIe siècle.
L'escalier est resté longtemps caché.
En 1989, en cognant sur le pilier du mur gouttereau,
on s'est aperçu que le bruit résonnait
creux. Décision fut prise d'ouvrir le pilier...
et l'on découvrit alors cet escalier du
XIIe siècle qui mène aux cloches.
La première marche se situe environ à
1,50 mètre de hauteur et on ne sait pas
comment on l'atteignait. Y avait-il, devant, un
petit escalier de bois ?
|
|
|
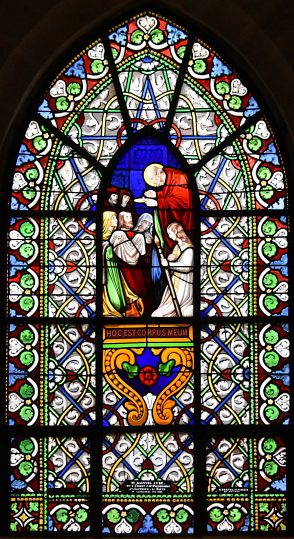
«Hoc est corpus meum»
Vitrail dans le bas-côté nord, 1846.
Atelier de François Fialex à Mayet. |

«Ecce Agnus Dei»
Atelier de François Fialex à Mayet, 1846,
détail. |
|
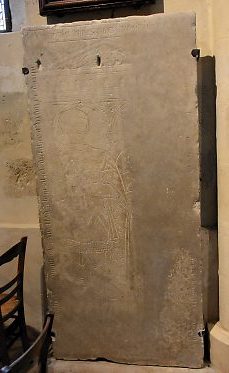
Pierre tombale de Henry de Livres
(mort en 1539). |
Demi-pierre
tombale de «Hue de Sèvres»
(mort en 1339) ---»»»
Les inscriptions ont été effacées
car
cette pierre a servi de pavement dans la nef
à un endroit très passant, contrairement
à celle d'Henry de Livres qui était
posée près d'un mur. |
|
|
|
Pierres
tombales. Les fouilles entreprises
en 1989 dans le sous-sol de la nef ont montré
que l'église Saint-Romain était
une véritable nécropole !
Des centaines de corps y ont été
ensevelis du Moyen Âge à la
Révolution, dont plus de 120 au XVIIIe
siècle. Sur une superficie aussi
réduite, pas de place pour les cercueils
: sauf exception, les corps étaient
enfouis à même la terre, en
creusant un nouveau trou et, s'il le fallait,
en repoussant les ossements qui gênaient...
Qui enterrait-on là? Tout le monde
: les curés de la paroisse, des nobles,
des notables, des domestiques (jardinier,
femme de chambre), bourgeois, meuniers,
marchands de vins, épiciers, etc.
On a néanmoins retrouvé deux
pierres tombales : l'une, entière,
de Henry de Livres, mort en 1539 et l'autre,
brisée, de Hue de Sèvres,
écuyer mort en 1339. Ces pierres
sont exposées dans l'église.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret
édité par la paroisse, 2009.
|
|
 |
|
|
|
| LES VITRAUX ET
L'ORIGINE LÉGENDAIRE DE L'ÉGLISE SAINT-ROMAIN |
|
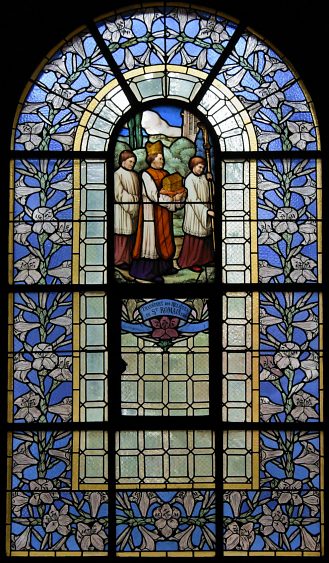
Le Transfert des reliques de saint Romain de Blaye en 1504.
Vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté sud.
Atelier inconnu. |

Saint Germain guérit une jeune fille aveugle.
Détail d'un vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté
sud. |
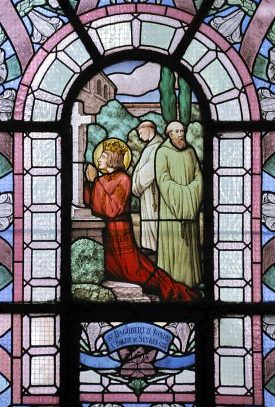
Saint Dagobert II fonde l'église de Sèvres.
Détail d'un vitrail du XIXe siècle dans le bas-côté
sud. |
|
La légende
sévrienne dans les vitraux. Trois vitraux
de l'église, datés du XIXe siècle, relatent
la légende attachée à l'église.
Quel édifice cultuel y avait-il au VIIe siècle
dans ce petit village? Au moins une chapelle car l'évêque
Germain y vint en tournée pastorale et délivra
une aveugle possédée du démon. Celui-ci
empêchait la jeune fille, dénommée Magneflède,
de rentrer dans l'église. Germain fit et refit le signe
de la croix sur le front de la possédée jusqu'à
ce que le démon s'en aille. Une autre légende
veut que Dagobert II ait fondé l'église en 675,
mais il n'en existe aucune preuve. L'épisode est néanmoins
illustré dans un vitrail du bas-côté sud.
L'église Saint-Romain a-t-elle reçu des reliques
de saint Romain de Blaye en 1504 comme l'illustre le vitrail
du XIXe siècle ci-contre? Aucun document ne l'atteste.
Mais, autrefois à Sèvres,
le 22 mai était la fête de la Translation des
reliques. En revanche, en 1790, lorsque la Révolution
fit fermer l'abbaye de Saint-Denis,
l'abbé Gandolphe, curé de Sèvres,
réclama et obtint des reliques de Romain de Blaye.
Le transfert se fit en grandes pompes avec la Garde Nationale.
Ces reliques seront brûlées sous la Terreur,
le 29 janvier 1794.
|
|

L'élévation nord vue à travers une arcade du
côté sud.
La zone sombre dans le bas-côté correspond à l'escalier
du XIIe siècle
mis au jour lors de travaux de 1989. |
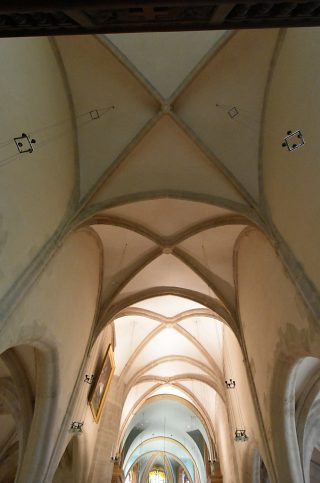
La voûte de la nef
depuis la tribune occidentale jusqu'à l'abside.
La vue est obtenue avec un grand angle. |

Têtes de femme et d'homme sur la clé d'ogive
de la quatrièmre travée (XIIIe siècle). |
 |
|
L'humidité
de l'église.
L'étroite vallée du Ru de Marivel étant
parsemée d'étangs et de marais, l'humidité
a toujours posé un problème au village de Sèvres
et à son église. En 1756, la Manufacture royale
de porcelaine déménagea à Sèvres
dans les bâtiments qui sont actuellement ceux du Centre
International d'Études Pédagogiques (photo ci-contre).
La paroisse du village devint Paroisse Royale. En conséquence,
le roi Louis XV prêta une oreille attentive aux doléances
que les Sévriens adressèrent à ses services.
En 1765, le curé de Saint-Romain adressa un rapport
au sieur Bertin, contrôleur général des
finances, et y souligna deux problèmes : l'humidité
qui est «affreuse» ; ensuite la superficie de
l'église devenue trop petite à la suite de l'augmentation
de la population.
Dans ce rapport, l'humidité est illustrée par
des détails aussi précis qu'amusants : les hosties
du tabernacle se corrompent d'un jour à l'autre malgré
les précautions prises ; le pain qui va servir à
l'Élévation et qui reste sur l'autel pendant
les trois quarts d'heure que dure le prêche (!) devient
comme «un linge mouillé» ; quand vient
l'Élévation, l'hostie tombe et s'enroule sur
le doigt du célébrant, le jetant dans un grand
embarras. Enfin, le clou est pour la fin : «Cette humidité
est si affreuse qu'on a vu des crapauds se promener autour
des marches de l'autel.»
L'église était trop petite. Selon le rapport,
elle pouvait contenir au plus sept cents personnes, mais,
«dans la dernière quinzaine de Pâques,
peut-on y lire, il y eut entre onze cens et douze cens paroissiens».
Enfin, la supplique était accompagnée d'un plan,
dressé par un architecte expert, qui remédiait
à tous ces défauts. Louis XV s'y montra sensible
et accorda trois mille livres. On put ainsi prolonger le chœur
par une abside de style néo-classique et reculer la
grille qui le fermait. Tout l'espace de la travée au
niveau des chapelles des bas-côtés fut ainsi
libéré pour les fidèles.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse, 2009.
|
|

Le Centre International d'Études Pédagogiques au bout
de l'avenue Camille Sée à Sèvres.
Ce bâtiment abritait autrefois la Manufacture de porcelaine.
Un projet de reconstruction prévoyait, en 1868, d'élever
la nouvelle église Saint-Romain
à l'endroit même de l'avenue Camille Sée. |

«L'Adoration des mages» de Jean Restout, 1718.
Tableau vraisemblablement offert à l'église par
la reine Marie Leczinska en 1847. |
|
La
reconstruction de l'église Saint-Romain (2/2).
---»» Le projet consistait à bâtir
l'édifice sur l'actuelle avenue Camille Sée,
c'est-à-dire juste en face de l'entrée
principale de ce qui est maintenant le Centre
International d'Études Pédagogiques.
À l'époque, ce grand bâtiment abritait
la Manufacture de porcelaine. On y aurait adjoint à
gauche et à droite différents bâtiments
(presbytère, vicariat, crèche, asile,
écoles et orphelinat). Toutes ces constructions
auraient pris la place d'un vaste espace de verdure
(qui existe toujours). Les services de l'Empereur assuraient
les fonds : Napoléon III apportait 200 000 francs
pris sur sa liste civile ; le Ministère des Cultes
engageait une subvention d'un même montant ; enfin,
la ville aurait le droit d'augmenter l'octroi, ce qui
devait apporter 300 000 francs.
Le projet ne se fit pas. Est-ce à cause de la
guerre contre la Prusse en 1870 ? Il est néanmoins
vraisemblable que les fonds qu'on avait eu le temps
de récolter ont été utilisés
pour des travaux de réfection de Saint-Romain.
À commencer par la réparation des nombreux
vitraux cassés par des éclats d'obus lors
du siège de Paris.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse en 2009.
|
|
À DROITE ---»»
Depuis l'époque de Louis XIV, la Grande Rue à
Sèvres est au niveau
des toitures de l'église Saint-Romain. D'où
l'idée grandiose,
dans les années 1860, de bâtir une nouvelle
nef au niveau
de la route, l'ancienne étant transformée
en crypte... |
|
|
|
La
reconstruction de l'église Saint-Romain (1/2).
Dans la première moitié du XIXe siècle,
l'église de Sèvres,
dévorée par une humidité pernicieuse,
s'approchait dangereusement de l'état de ruine.
Aucune réparation majeure n'avait été
entreprise depuis 1740. Au sud et à l'ouest,
les maisons surplombaient l'édifice, ce qui le
privait d'air et de soleil. L'eau menaçait partout.
Le chevet voisinait avec une fontaine, et un fossé
entourait partiellement les murs gouttereaux. Mal entretenu,
celui-ci débordait pendant les périodes
de grandes pluies, provoquant l'inondation du caveau
sous le chœur. Les fondations se délabraient,
les fissures se multipliaient, d'où un risque
fatal d'écartement des voûtes. Les charpentes
du clocher ne valaient pas mieux. Comme elles menaçaient
de s'effondrer, on avait cessé de sonner les
cloches. Le sol de la nef n'était plus qu'un
mélange de terre, de restes de corps qu'on y
avait inhumés et de morceaux de briques qui en
constituaient autrefois le revêtement.
En toute saison, l'air qu'on respirait dans l'église
était fétide, malsain ; un froid permanent
y régnait. En 1859, dans une lettre à
l'empereur Napoléon III, le curé Bainvel
rappelait une des causes de ces calamités : «Les
grands travaux entrepris par Louis XIV pour le percement
de la route de Paris à Versailles
ont mis l'église à 10 mètres environ
au dessous du sol, sur lequel elle fut primitivement
construite. Il en résulte que les eaux l'inondent
de toute part et la rendent d'une insalubrité
irrémédiable.»
Cet état de pourrissement faisait fuir les fidèles
: ils s'étaient mis à fréquenter
les églises des communes voisines. Certains Sévriens
en oubliaient carrément la pratique religieuse.
Pis, les enfants qui suivaient le catéchisme
dans l'église subissaient de plein fouet ce froid
vicié et les maladies afférentes. L'abbé
Bainvel écrit ainsi : «Cette année
encore [1859] nous avons eu à pleurer la mort
de trois pauvres enfants du pays, frappés en
pleine église des affections auxquelles ils ont
succombé.»
Il était donc urgent de consolider l'édifice
et de l'assainir. L'abbé Bainvel, qui servit
à la cure de 1832 à 1871, en appela dès
1851 à son évêque à Versailles,
puis, la même année, au maire de Sèvres
et au Conseil municipal. Tout le monde était
d'accord sur les travaux, mais il fallait trouver des
fonds. En désespoir de cause, le maire et le
curé n'eurent d'autre solution que de s'adresser
directement à l'empereur Napoléon III.
Ce qu'ils firent en 1859. L'Empereur y répondit
favorablement et convoqua les intéressés
en août 1860 au château de Saint-Cloud.
Jusque-là, des architectes, consultés
dans les années 1807 à 1850, avaient dressé
de nombreux devis qui sont d'ailleurs conservés
dans les archives de la ville. Mais, avec l'appel à
l'Empereur, les travaux prirent une autre dimension
car les historiens ont découvert, dans ces mêmes
archives, des projets de reconstruction de l'édifice.
Ainsi, dans un rapport daté de 1867, deux possibilités
se dégagent : convertir l'église en crypte
et bâtir au-dessus, au niveau de la route, une
nouvelle nef soutenue par des piliers de fonte ; ou
bien transformer la nef en transept d'un nouvel édifice
à construire en direction du sud, ce qui aurait
orienté l'église du nord au sud et non
plus de l'est vers l'ouest. Chacun de ces projets exigeait
des travaux colossaux. On fit mieux. Un rapport d'août
1868 s'oriente vers la construction en bonne et due
forme d'une nouvelle église dans un autre endroit.
--»» Suite 2/2 à gauche.
|
|
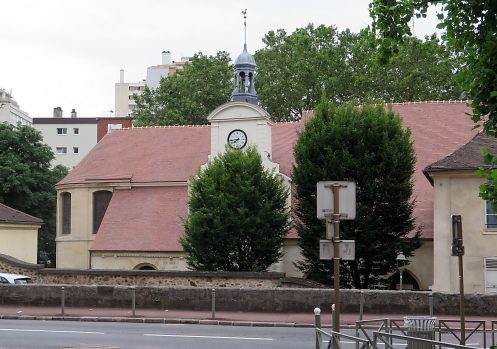 |
|
|
|

Chapelle de la Vierge à l'extrémité du
bas-côté sud. |

La Vierge dans la chapelle de la Vierge. |
|
Les
vitraux de Saint-Romain (2/2).
---»» L'architecte départemental
de la Sarthe, mécontent de la restauration
des vitraux de la cathédrale du Mans par
la Manufacture de Choisy-le-Roi, s'adressa à
Alexandre Brongniart qui dirigeait la manufacture
de Sèvres.
Celui-ci lui envoya François Fialex, peintre
de bordures, qui créa peu après
son propre atelier à Mayet, au sud du Mans.
Le reproche adressé à la Manufacture
de Choisy-le-Roi était de créer
un contraste excessif entre l'ornementation et
les personnages. Mais on finit par faire le même
reproche à Fialex...
Les ateliers de peinture sur verre de Choisy-le-Roi
et de Sèvres formèrent des verriers
comme Gsell, Oudinot, Gérente et Fialex... qui
avaient fini par ouvrir leurs propres ateliers.
La fermeture des ateliers de peinture sur verre
de Choisy-le-Roi en 1848 et de Sèvres en
1854 permit à ces verriers d'accroître
la clientèle de leurs ateliers, leur assurant
une viabilité de plusieurs dizaines d'années.
À Saint-Romain, les vitraux du bas-côté
nord, consacrés à l'Eucharistie,
sont aussi de François Fialex. Quant à
ceux
du bas-côté sud, ils ne portent
pas de signature.
Sources : 1) «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse, 2009 ; 2) «Un patrimoine
de lumière, 1820-2000», Éditions
du Patrimoine, 2003.
|
|

Chapelle Saint-Joseph à l'extrémité
du bas-côté nord
avec son vitrail de la Vie de saint Jean-Baptiste. |
|

«Joseph vendu par ses frères», détail
---»»»
Bas-relief en plâtre d'Henri-Victor Roguier dans le bas-côté
nord. |
| «««--- Le bas-côté
sud aboutit à la chapelle de la Vierge. |
|
|
|
|
|
Architectures.
Tout le charme archéologique de l'église
transparaît dans cette vue à droite des
quatrième et troisième travées
sud. La quatrième travée remonte au XIIIe
siècle, la seconde au XVIe.
À partir de l'arcade, on voit que la colonne
cylindrique au centre laisse la place à une colonne
semi-engagée qui s'élève jusqu'à
la voûte. Mais le plus intéressant, ce
sont les intrados de ces arcades. Au XIIIe siècle
(partie gauche de la photo), l'intrados possède
deux tores séparés par une large arête
plate, ce qui montre une recherche artistique certaine.
L'ensemble rentre en pénétration dans
la pile.
En revanche, l'intrados du XVIe siècle, sur la
droite, a l'aspect d'une grosse moulure assez vulgaire,
comme on le voit d'ailleurs dans toutes les arcades
de la partie occidentale de l'église, partie
entièrement datée du XVIe siècle.
La photo,
donnée plus haut, du côté sud de
la nef le montre clairement.
Visiblement, la fabrique n'a pas voulu faire de dépenses
inutiles. Peut-être se concentrait-on alors sur
l'agrandissement de la nef qui devait demeurer l'objectif
principal.
|
QUATRE PANNEAUX
DES SCÈNES DE LA VIE DE LA VIERGE
ATELIER FRANÇOIS FIALEX
1846. |
|

Arcades du XIIIe siècle et du XVIe siècle dans
la nef. |
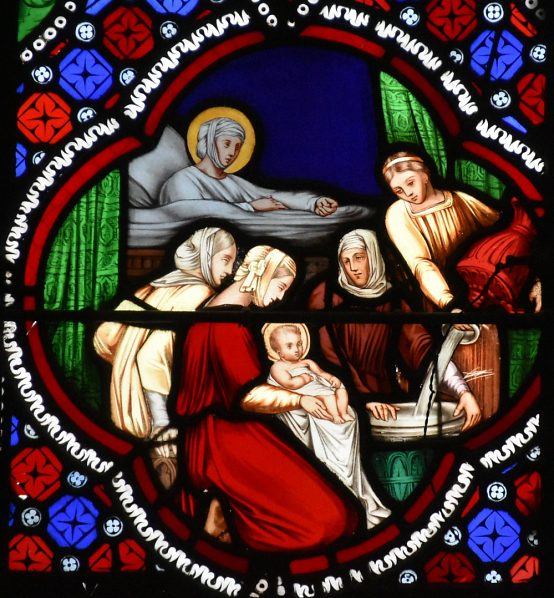
«La Naissance de la Vierge», atelier François
Fialex à Mayet, 1846. |
|

Quatrième travée : l'élévation nord
avec la pile qui soutient
le clocher et les colonnettes du XIIe siècle. |

«Ecce Agnus Dei» (Vie de saint Jean-Baptiste). |

Hérodiade demande la tête de Jean-Baptiste
Vitrail de la Vie de saint Jean-Baptiste. |
|

La voûte de la chapelle Saint-Joseph
est peinte de rinceaux polychromés. |

Mouluration du XIIIe siècle
dans les nervures d'une ogive du bas-côté
nord. |
|
|
Curiosités
intérieures. La photo à gauche
montre l'élévation nord de la quatrième
travée, l'une des plus anciennes de l'église
puisqu'elle remonte aux XIIe et XIIIe siècles,
et donc l'une des plus intéressantes sur le plan
historique. La pile massive, initialement cylindrique,
a été renforcée en 1688 pour soutenir
le clocher jugé en mauvais état à
cette époque. Dans la partie haute de cette élévation,
l'arcade sépare le clocher de la nef. On y voit
des colonnettes jumelées qui s'élèvent
sur une petite longueur. Elles sont datées du
XIIe siècle et ont été mises au
jour lors des travaux de 1989.
À ce sujet, une question se pose aux archéologues.
Aujourd'hui, le clocher n'est visible qu'au nord (voir
photo
plus haut), mais ses éléments architecturaux
sont semblables sur les quatre faces (et donc cachés
sur trois d'entre elles). La toiture était-elle
donc plus basse jadis pour dégager le clocher
sur les quatre points cardinaux? Si c'était bien
le cas, il serait permis de penser que l'église
était plus petite que celle d'aujourd'hui et
limitée à la moitié venant du XIIIe
siècle, c'est-à-dire la partie orientale.
C'est aussi lors des travaux de 1989 qu'on a découvert
que la voûte de la chapelle
de la Vierge et celle de la chapelle
Saint-Joseph étaient peintes d'une série
de rinceaux colorés. L'ensemble a été
dégagé par une artiste spécialisée.
Mais aucune trace de dessin n'a été trouvée
sur les voûtes des bas-côtés. Enfin,
les deux photos d'ogive ci-dessus montrent l'évolution
de la forme des nervures au cours des XIIe et XIIIe
siècles.
Source : «L'église
Saint-Romain de Sèvres», livret édité
par la paroisse, 2009.
|
|
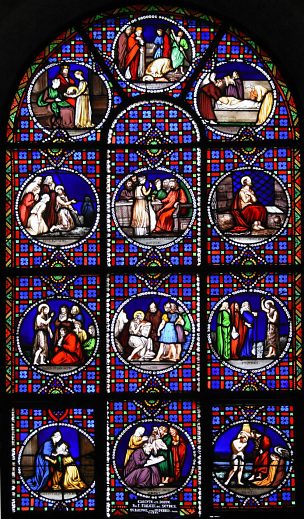
Vitrail de la Vie de saint Jean-Baptiste.
Atelier de François Fialex à Mayet, 1843.
«Jean-Baptiste en prison» ---»»»
(Vie de saint Jean-Baptiste) |

«Appel à la conversion»
(Vie de saint Jean-Baptiste) |
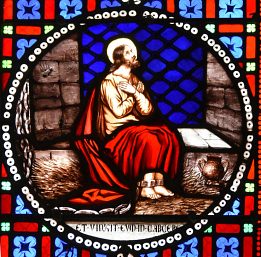 |
|
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-ROMAIN ET SON ABSIDE DU XVIIIe SIÈCLE |
|

Le chœur de l'église Saint-Romain et les chapelles des
bas-côtés.
L'abside de style néo-classique date du règne de Louis
XV.
Le chœur a été entièrement restauré
dans les années 2017-2019. |
|
|

Le chœur de Saint-Romain après les travaux de restauration
de 2017-2019. |
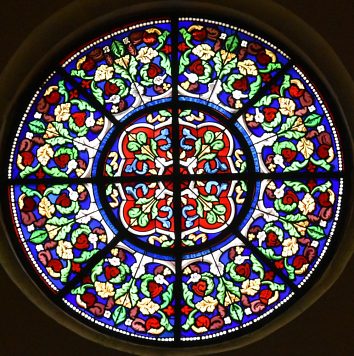
La rose de la façade occidentale est due à François
Fialex (1846). |
|
La
rose de la façade. Elle appartient
à la catégorie des verrières dites
ornementales. La production de ce type d'ouvrages
était facilitée par la répétition
de leur décor qui permettait à l'atelier
créateur de mettre en place un travail quasi
industriel. D'où une diminution importante du
coût. Pour une même surface, une verrière
dite légendaire, c'est-à-dire avec
une scène historique, coûtait en moyenne
quatre fois plus cher. Ce type de vitrail (ici, un décor
végétal) a commencé à sortir
des ateliers français en 1837, notamment celui
de Maréchal de Metz.
Ces verrières, disposées dans les parties
hautes des églises, apportaient une lumière
diffuse qui facilitait la méditation et la prière.
Le clergé voulait en finir avec le verre blanc
du XVIIIe siècle qui inondait les nefs d'une
lumière crue. L'expérience montrait en
effet que l'atmosphère créée ainsi
gênait la dévotion.
D'après le recensement des années 1990,
la rose de Saint-Romain est le premier vitrail décoratif
posé en Île-de-France. Comme bien d'autres
vitraux de l'église, il a été réalisé
par l'atelier de François Fialex à Mayet,
au sud du Mans, en 1846.
Source : Le vitrail
religieux par Martine Callias Bey dans «Un
patrimoine de lumière, 1820-2000», Éditions
du Patrimoine, 2003.
|
|
|

Les trois vitraux du chœur au sein de l'ornementation restaurée
en 2019. |

Le chœur et les bas-côtés vus de la chapelle de
la Vierge. |

La voûte du chœur est en berceau depuis les années
1760. |
|
Sous Louis XV, les travaux entrepris
dans l'église n'ont pas seulement ajouté l'abside,
ils ont aussi transformé la voûte ogivale du
chœur, datée du XIIIe siècle, en une voûte
à berceau ouverte de deux fenêtres à pénétration.
|
|
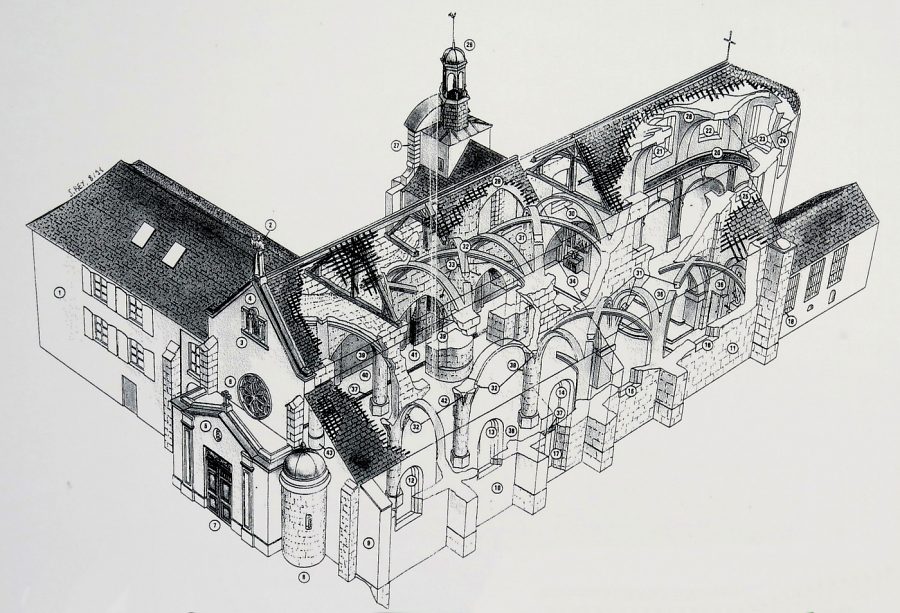
Vue axionométrique échorchée de l'église
Saint-Romain.
Dessin de S. Rey de 1991 affiché durant les travaux de restauration
de 2017-2019. |

La nef vue depuis le chœur.
L'orgue de tribune de Saint-Romain est un instrument électronique
offert par un généreux donateur.
Les anciennes orgues, installées en 1904, étant irrécupérables,
ont été démontées en 1989. |
Documentation : «L'église Saint-Romain
de Sèvres», livret édité par la paroisse,
2009
+ panneaux présents dans l'église
+ Panneaux affichés lors de la restauration de 2017-2019
+ Dictionnaire des églises de France, éditions Robert
Laffont, 1968.
+ «Un patrimoine de lumière, 1820-2000», Éditions
du Patrimoine, 2003. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|