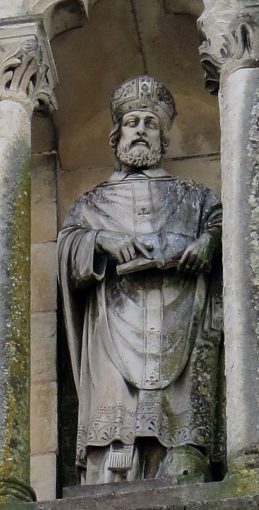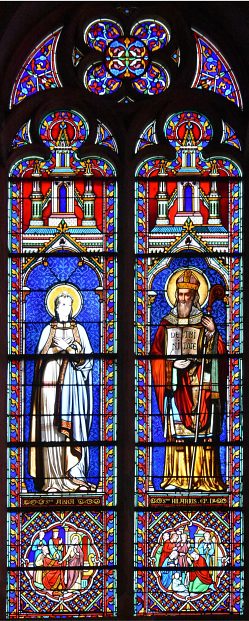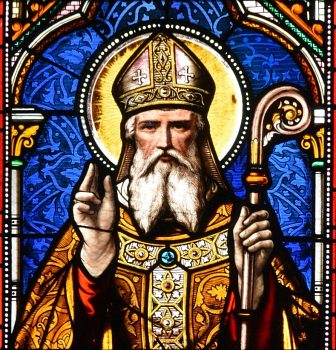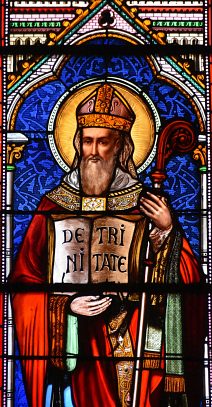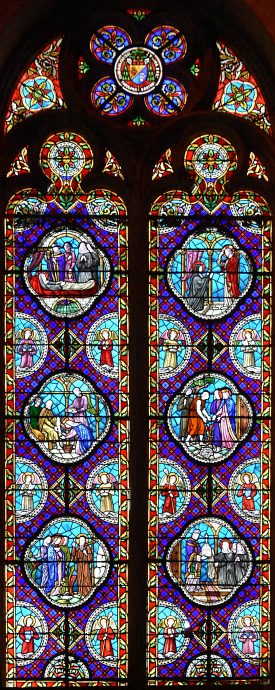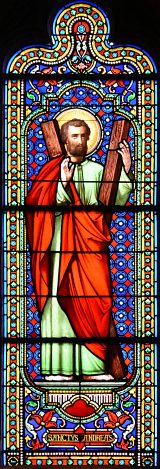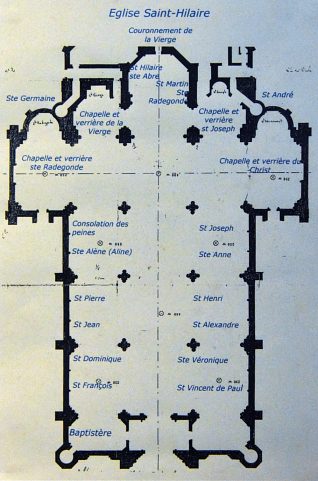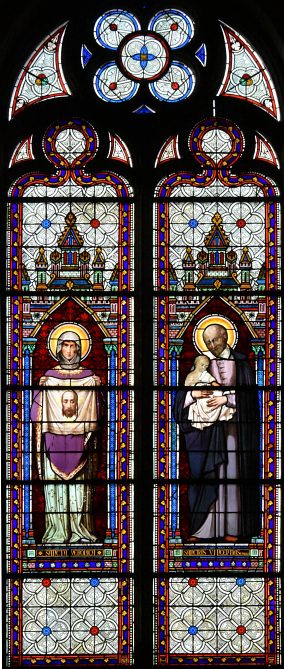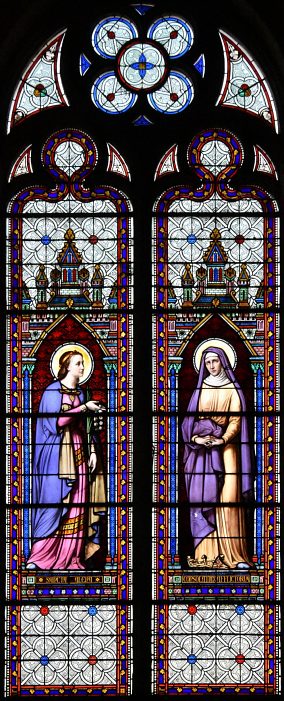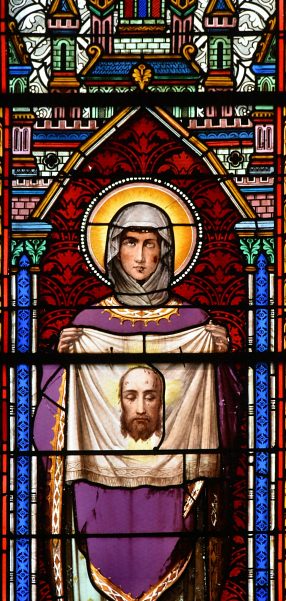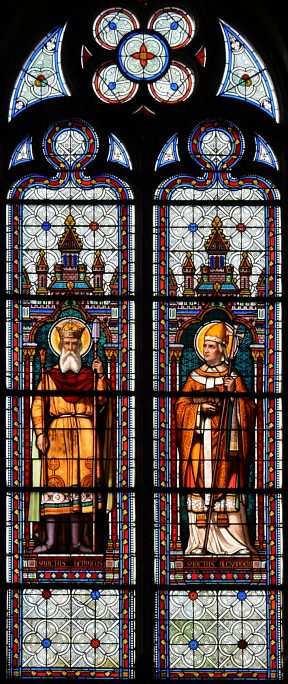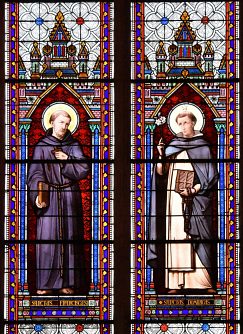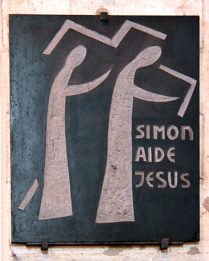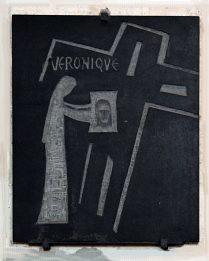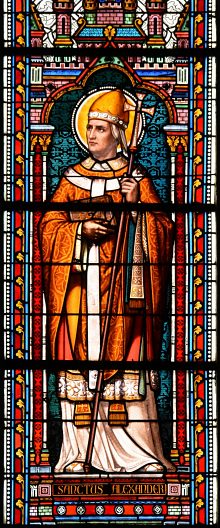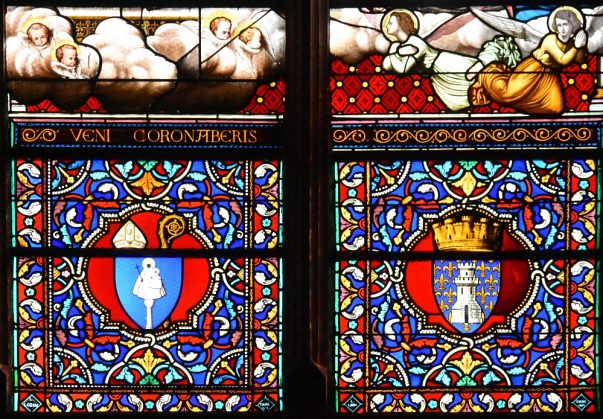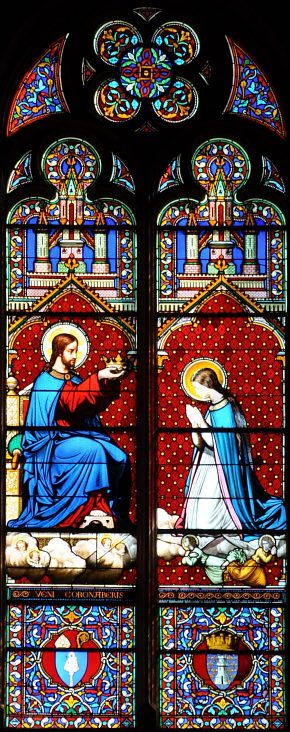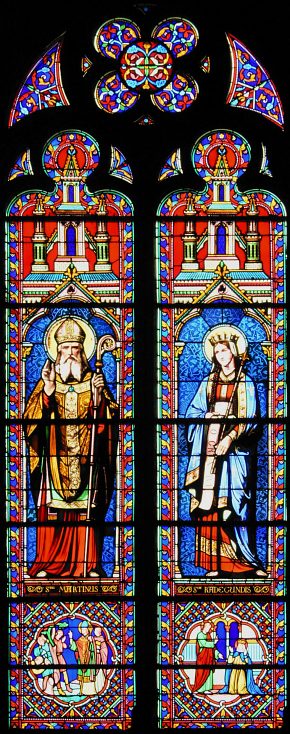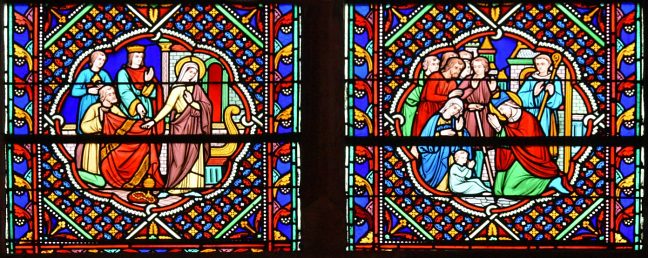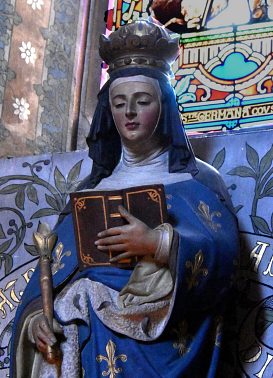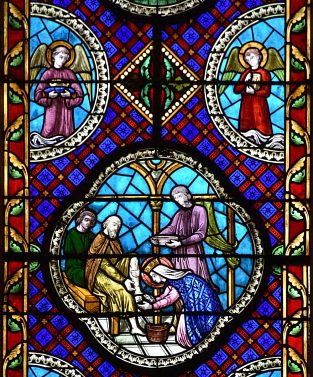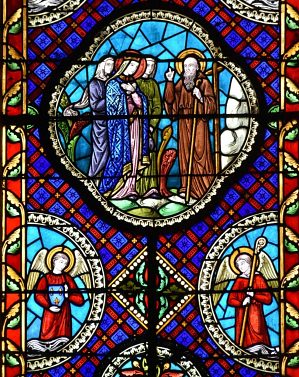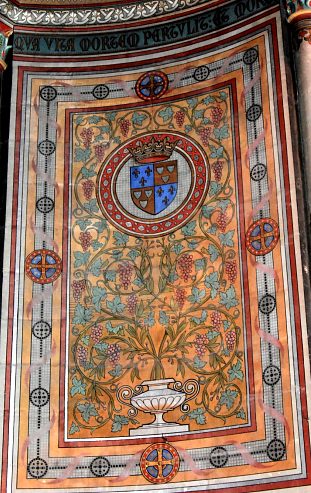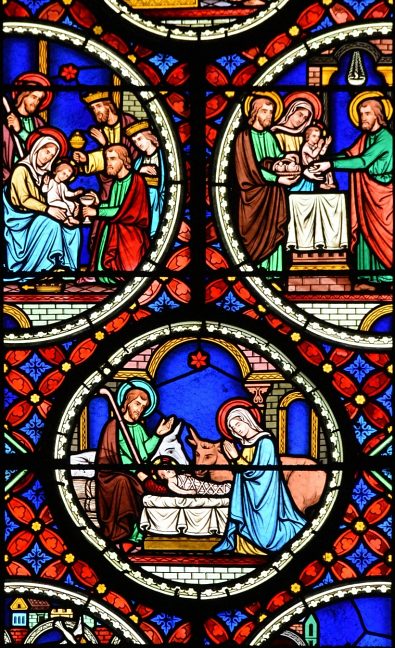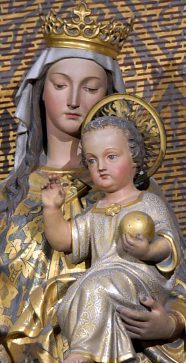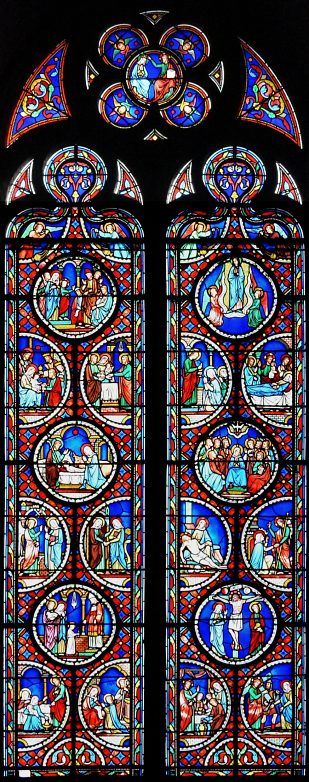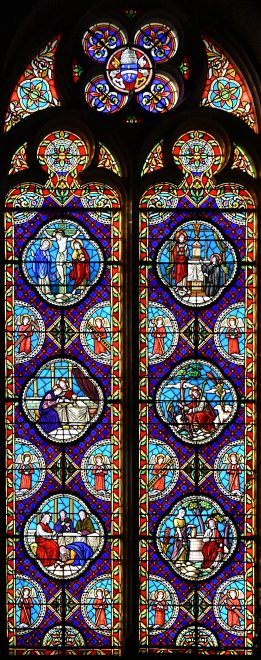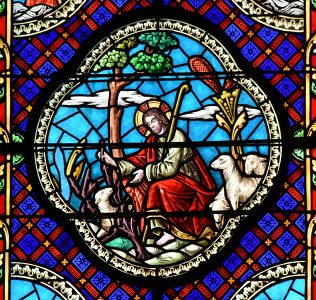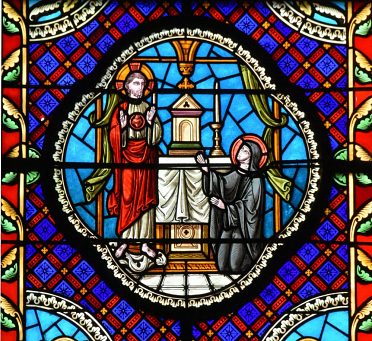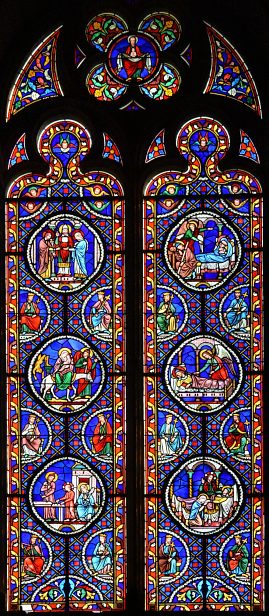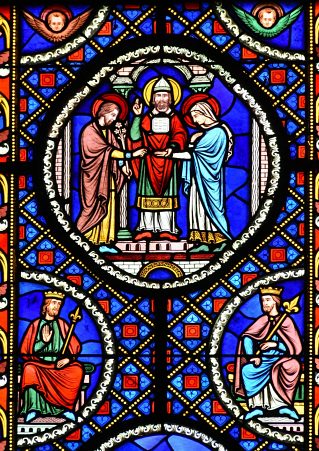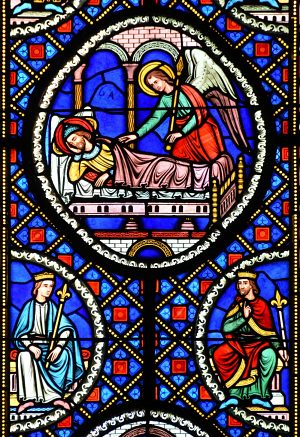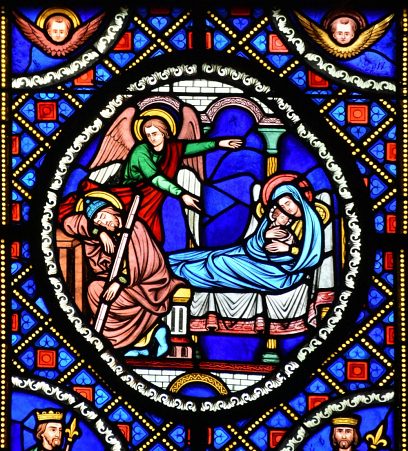|
|
 |
 |
Le Prince-Président Louis-Napoléon Bonaparte
passa à Niort
en octobre 1852. À cette époque, la gare était en construction.
Mgr Louis-Édouard Pie, évêque de Poitiers,
présent lors de la visite présidentielle, savait très bien que l'arrivée
du chemin de fer allait créer autour de la gare un important quartier
populaire. Il fallait donc sans attendre élever une église à proximité
pour anticiper les besoins cultuels. Le futur empereur donna son
consentement. Mais, si la paroisse Saint-Hilaire, reconnue par un
décret impérial avec celle de Saint-Étienne de l'autre côté
de la Sèvre, fut créée dès juin 1853, il fallut près de dix ans
de tractations avant de poser la première pierre de l'église.
La recherche des ressources nécessaires fut de longue haleine.
Pour le Conseil municipal, le coût de l'édification
d'un Hôtel de ville avait la priorité. Puis ce fut
la ligne de chemin de fer Poitiers-La
Rochelle, officialisée par un décret présidentiel
de mars 1852, qui passa devant. Le financement du tronçon
niortais repoussait à plus tard le vote de fonds pour la
nouvelle église. Cependant, dès octobre 1852, le Prince-Président
fit savoir officiellement à Mgr Pie que le Trésor
verserait 100 000 francs, payés sur dix ans, pour l'édifice
(ce qui était une très forte somme). Conséquence
: trois semaines plus tard, le Conseil municipal ne put que voter
l'attribution d'une somme équivalente.
L'année suivante, le choix du lieu se fit dans la difficulté.
Des deux sites possibles, la municipalité opta pour celui
du quartier de la Brèche. Le montant total des expropriations
était du même ordre pour les deux sites, mais le quartier
choisi, dont la configuration serait totalement repensée,
était jugé mieux fréquenté.
La désignation de l'architecte, laissée à l'initiative
du maire, fut rapide : ce serait Pierre-Théophile
Segretain, Niortais bien connu, déjà bâtisseur
de la Préfecture, du Palais de Justice et de la prison.
Arrêter le plan final de l'édifice fut long. La Commission
archéologique du diocèse et le ministère de
l'Instruction publique et des Cultes devaient donner leur accord.
Ce dernier demanda des modifications qui furent refusées
par l'architecte. Le dossier s'enlisait. Segretain avait pourtant
averti : plus on attendait, plus le prix des matériaux enchérissait.
En fin de compte, la mairie de Niort,
l'évêque de Poitiers
et l'architecte comprirent que le ministère faisait traîner
l'affaire - par mauvaise volonté politique. En tant qu'opposant
déclaré au régime, Mgr Pie était mal
vu. Le ministre n'avait-il pas, sans sourciller, donné son
accord pour le lycée à construire non loin de l'église
? Et le préfet avait même reçu l'ordre d'accélérer
les travaux !
Mgr Pie n'avait plus le choix : il s'en alla voir le ministre (novembre
1857) et obtint la promesse d'un accord sous réserve de modifications
mineures. La construction ne démarra pas pour autant car
de nouveaux crédits pour la ligne de chemin de fer Poitiers-La
Rochelle, dont le tracé définitif venait enfin
d'être décidé, passaient avant ! La ligne de
Poitiers
à Niort
fut ouverte en juillet 1856, suivie un peu plus tard du complément
Niort-La
Rochelle.
En 1859, la municipalité put enfin s'activer pour l'église
: les terrains furent acquis ; les expulsés, indemnisés
; les rues, reconstruites. Mais, en décembre 1860, une opposition
de dernière minute surgit, notamment au Conseil municipal.
C'était maintenant le clergé de l'église Notre-Dame
à Niort
qui essayait de ralentir le projet ! Saint-Hilaire serait plus grande
et plus belle que leur église. C'était inacceptable
! Derrière ce masque, le maire et l'évêque furent
d'avis que l'autorité impériale avait soudoyé
des clercs de Notre-Dame
pour faire payer à Mgr Pie son opposition au régime
! (Voir l'encadré
sur l'histoire de cette opposition.)
En avril 1861, avec l'accord de l'évêque, le maire
résolut de braver la mauvaise volonté d'une partie
du Conseil municipal. La commission chargée des travaux de
l'église fut nommée ; le devis de l'architecte Segretain,
adopté ; le vote du Conseil, approuvé par le Préfet
au mois de mai suivant. Peu après, le marché était
signé avec l'entrepreneur. La construction put enfin commencer.
D'inspiration romano-byzantine, l'église fut donc bâtie
de 1862 à 1866. Le plan est rectangulaire avec un vaisseau
central et deux larges bas-côtés. La hauteur sous voûte
est uniforme dans tout l'édifice. Le transept est bordé
par quatre chapelles, tandis que le chevet est semi-circulaire.
Voir le plan plus
bas.
En 1865, la construction était assez avancée pour
organiser dans Saint-Hilaire une exposition
nationale consacrée aux Beaux-Arts et à l'Industrie.
En janvier 1866, l'édifice était ouvert au culte,
puis consacré en juin 1868 par Mgr Pie.
Dans l'église, le visiteur remarquera de beaux chapiteaux
néo-gothiques à thème floral, tous différents
et des verrières dans le style classique de la fin du XIXe
siècle (de nombreux extraits en sont donnés dans cette
page). Certaines sont des pastiches du XIIIe siècle. Les
ateliers Lobin à Tours
et Dagrant à Bordeaux furent sollicités. À l'exception des trois vitraux du chevet, ils furent tous offerts
par des particuliers.
Le peintre niortais Louis Germain a embelli le transept de deux
grandes peintures : la
résurrection de Lazare et la
libération de Pierre par un ange.
|
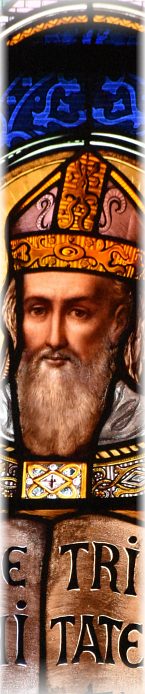 |
 La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée.
La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée. |
|
L'EXTÉRIEUR DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE
|
|

La façade (assez sobre) de l'église et le côté sud.
Trois statues
de Pères de l'église la dominent. Certaines
niches sont nues : elles n'ont jamais reçu la leur. |

Avec ses arcades emboîtées et ses modillons, le
clocher affiche un indéniable aspect néo-roman. |
|
Vie
de Saint Hilaire.
Hilaire devient évêque de sa ville
natale, Poitiers,
en 350. À cette époque, l'Empire romain
est ravagé par les querelles des clercs qui polémiquent
sans fin sur le contenu du dogme de la foi chrétienne
: quelle est la place du Fils par rapport au Père
? ; le Fils est-il Dieu ? ; est-il seulement homme ?...
L'arianisme, qui nie la divinité du Christ, se
répand. Les auteurs païens se font l'écho
en termes amers de cette zizanie.
Hilaire est le défenseur de la rectitude la plus
stricte de la foi, menacée par l'arianisme. Pour
lui, le Fils (qui est aussi homme) est de même
nature que le Père. C'est la proclamation du
Concile de Nicée en 325. Saint Hilaire s'oppose
à l'empereur, ce qui lui vaut d'être exilé
en Phrygie.
Après son retour en Gaule, Hilaire accueille
saint Martin à Poitiers.
Par le biais d'une correspondance active et de ses écrits
savants, il contribue à l'unité des évêques
de la Gaule. Il meurt en 368. Sa dépouille est
enterrée dans la basilique
Saint-Hilaire-le-Grand à Poitiers.
En 1852, Hilaire est promu Docteur de l'église.
|
|
 |
 |
|
Les arcades du portail principal
sont enrichies de deux têtes d'animaux de sacrifice
: le taureau et le bouc.
|
|
|

Le chevet de l'église Saint-Hilaire.
Les tours sont d'inégale hauteur. En 1869, la plus basse
a failli
être rehaussée au niveau de l'autre privée
de sa flèche.
L'histoire mouvementée de la flèche est contée
ci-dessous. |
|
La
flèche du clocher.
Le lundi 27 novembre 1865, la tour du clocher est achevée.
L'armature en fer qui doit former la flèche est
en place ; les lattes attendent leurs ardoises.
Dans la nuit, une violente tempête s'abat sur
Niort.
Au matin, les ouvriers constatent les dégâts
: l'échafaudage est à mal et la charpente
en fer de la future flèche est fortement inclinée
vers le nord. La tempête n'est pas passée
: une brusque rafale de vent brise l'échafaudage
qui s'écroule au sol. En tombant, les débris
de bois, de fonte et de fer tuent un pauvre cheval qui
se trouve à proximité, attelé à
sa charrette.
Heureusement, les dégâts sur le clocher
sont mineurs. La flèche seule est détruite
; quelques clochetons sont écornés ; la
toiture d'une chapelle latérale a un peu souffert.
Il faut reprendre les travaux et achever la flèche.
Au début de 1866 cependant, le Conseil municipal,
sollicité, répond qu'il n'a rien à
voir dans cette histoire. De son côté,
l'entrepreneur se désengage car le devis n'inclut
pas le coût d'un échafaudage plus solide.
De leur côté, les fils de l'architecte
Segretain, décédé en 1864, écrivent
à un ancien architecte de la ville pour qu'il
reprenne le chantier. Sans succès.
Tout n'est pas perdu pour autant car le Conseil municipal
change d'avis et décide de prendre le problème
à bras le corps. On s'aperçoit que les
plans de la flèche ne sont qu'un simple dessin
que son auteur lui-même aurait vraisemblablement
modifié. Pour l'heure, le maire de Niort
charge un architecte d'étudier les causes exactes
du désastre du 27 novembre.
Nous sommes déjà en septembre 1868. Trois
ans se sont écoulés depuis les ravages
de la tempête. Un des fils de l'architecte défunt
craint alors que le Conseil municipal n'opte pour une
seconde tour sans flèche, semblable à
la première. Il écrit à Mgr Pie,
évêque de Poitiers,
et lui demande de bien vouloir intervenir pour faire
respecter les volontés de son père.
Le rôle du prélat n'est pas de trop car,
entretemps, des membres du Conseil municipal et du Conseil
de fabrique avancent une nouvelle idée : rehausser
la première tour à la hauteur de la seconde
quei serait privée de sa flèche. Le père
Ménard, qui relate cette histoire, écrit
en toute honnêteté à ce sujet :
«On comprend sans peine que ce second projet ait
séduit quelques-uns de ceux qui s'intéressaient
aux questions d'esthétique architecturale, et
l'on se demande s'il n'eut pas été préférable
de le voir adopter. Il semble bien que l'effet de ces
deux tours jumelles n'aurait rien laissé à
désirer, en même temps que le coup d'œil
eut été plus gracieux et plus imposant...»
Mais Alexandre Segretain tient absolument au respect
des volontés de son père, à savoir
deux tours d'inégale hauteur, avec une flèche
sur celle qui est au nord.
En 1869, un nouvel architecte, M. Durand, accepta d'achever
la flèche selon les plans initiaux, avec toutefois
quelques modifications sur les fenêtres. La flèche
fera vingt mètres de haut.
Les travaux devaient être achevés en décembre
1869, mais les hommes de l'art demandèrent un
sursis. Finalement, au mois de décembre 1870,
tout était achevé et payé.
Source : Naissance
d'une paroisse par le père Ernest Ménard, curé de
Saint-Hilaire de 1897 à 1909.
|
|
|
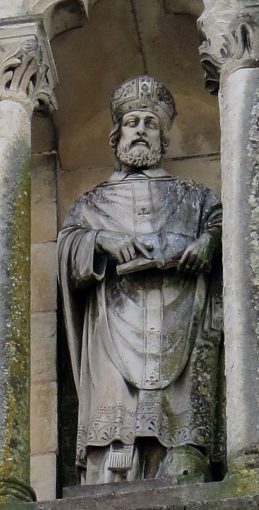
Saint Ambroise de Milan ,
docteur de l'Église d'Occident. |

Sur la partie centrale de la façade : saint Hilaire.
En arrière-plan : le Christ entouré du tétramorphe. |

Saint Athanase d'Alexandrie,
docteur de l'Église d'Orient. |
|
Le tétramorphe est
représenté aussi dans les arcades gauche et droite de la façade
:
|
|

L'ange de Matthieu. |

Le taureau de Luc. |

L'aigle de Jean. |
|
LA NEF DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE
|
|

Vue générale de la nef depuis la chapelle absidiale
Saint-Joseph
dans le bras sud du transept. |
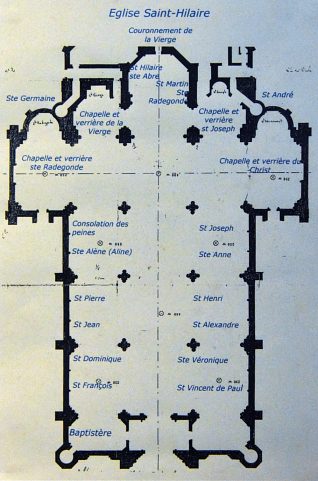
Plan de l'église Saint-Hilaire.
Avec les emplacements des chapelles et des vitraux. |

Le baptistère. |
Le baptistère était
embelli jadis d'un tableau de Louis Germain
représentant le baptême du Christ.
Le jugeant hors de proportions, l'artiste l'a lui-même
retiré en
promettant de le remplacer par une peinture aux dimensions
plus adaptées. Ce qu'il n'a jamais fait.
La décoration de l'arcature est due à Lecoq
d’Arpentigny. |
|
CHAPITEAUX NÉOGOTHIQUES
Ils sont tous à thème floral et tous
différents. |
|
 |
 |
 |
 |
|
|

Saint Joseph et sainte Anne
Atelier Lobin à Tours
Début des années 1880. |
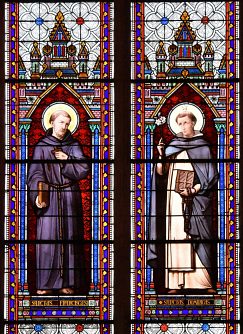
Saint François et saint Dominique, détail.
Atelier Lobin à Tours
Début des années 1880. |
|

Le bas-côté nord aboutit à la chapelle
de la Vierge dans le bras nord du transept. |
|
Vitrail
de saint Alexandre --»»
La présence de saint Alexandre vient vraisemblablement
de la volonté du Conseil de fabrique de rendre
hommage à Côme Alexandre Segretain
(1826-1901), fils de Pierre-Théophile Segretain,
l'architecte de Saint-Hilaire. Le fils se démena
pour défendre l'œuvre de son père
après la destruction du bâti de la flèche
en 1865.
Notons que Côme Alexandre Segretain sortit de
l'École Polytechnique en 1922 dans l'arme du
génie. Présent au siège de Sébastopol en 1853, il participa
à la guerre contre la Prusse et combattit contre les
forces des Communards en 1871.
Il prit sa retraite en 1883 avec le grade de général
de division.
Source : panneau dans l'église.
|
|
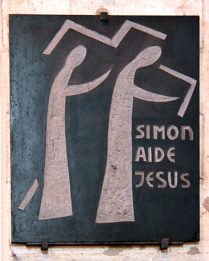
Chemin de croix, station IV :
Simon le Cyrénéen aide Jésus à porter sa
croix. |
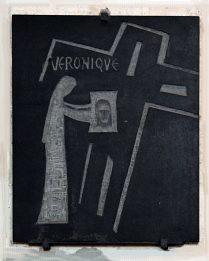
Chemin de croix, station VI :
Véronique essuie la face de Jésus. |
|
Pierre-Théophile
Segretain (1798-1864).
C'est un enfant du pays. Né à Niort
en 1798, il entre à Polytechnique en 1815, mais
s'oriente vers l'architecture. Revenu à Niort,
il est nommé architecte départemental
en 1824. On lui doit les bâtiments de la Préfecture,
du Tribunal et de la prison. Son ami Prosper Mérimée
le nomme architecte des Monuments historiques en 1850. À Niort,
Segretain construit l'église Saint-Hilaire et
restaure l'église Saint-André.
Dans le département des Deux-Sèvres (à
Oiron et à Mauzé), il conçoit d'autres
édifices. À Melle, il entame la restauration
de l'église Saint-Hilaire (classée au
patrimoine mondial de l'Unesco).
Pierre Théophile Segretain était membre
de la Société française d'Archéologie
et membre de la Société centrale des architectes.
À côté de cette activité propre à l'architecture,
il fut aussi en 1835 l'un des co-fondateurs de la Caisse
d'épargne de Niort,
membre de la Société de Secours Mutuel et de la Société
Historique et Scientifique. Il fut terrassé par une
apoplexie en 1864. Source : panneau
dans l'église.
|
|
|
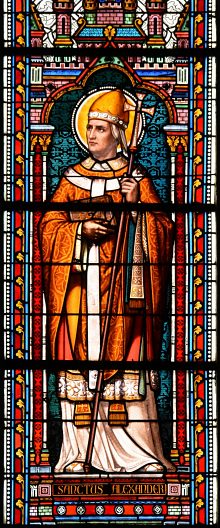
Saint Alexandre
Atelier Lobin à Tours
Début des années 1880. |

Sainte Aline, détail.
Atelier Lobin à Tours
Début des années 1880. |
|
|
LE CHŒUR DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE
|
|

Le chœur a été remanié plusieurs fois.
Au XIXe siècle, il était protégé par une
haute grille.
À gauche, à la place du Christ en croix, se dressait
un grand maître-autel enrichi d'un retable. |

Le chœur de Saint-Hilaire est éclairé par les
trois vitraux
de l'atelier Lobin à Tours.
Datés de 1865, ce sont les premiers vitraux qui ont été
posés dans l'église. |

Un ambon moderne soutient la Bonne parole. |
|
Le
Couronnement de la Vierge.
Les trois vitraux du chœur sont dus à
l'initiative de Mgr Pie, évêque de
Poitiers.
Il paya le tiers du coût total, la municipalité
acceptant de prendre à sa charge les deux
autres tiers.
Le vitrail d'axe représente le Couronnement
de la Vierge : Marie est agenouillée devant
son Fils, dans une attitude que l'évêque
jugeait un peu humiliante. Il fit part de sa préoccupation
aux ateliers Lobin, mais dut renoncer à
sa demande devant les difficultés matérielles
que l'artiste lui objecta.
Source : Naissance
d'une paroisse par le père Ménard,
curé de Saint-Hilaire de 1897 à
1909.
|
|
|
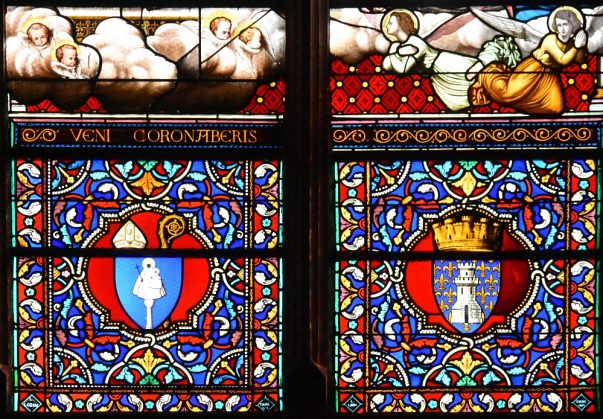
Vitrail central du chœur : le soubassement. À gauche, les armoiries de Mgr Pie, évêque
de Poitiers (la Vierge noire sur sa colonne). À droite, les armoiries de la ville de Niort : une tour
crénelée et casquée avec un semis de fleurs
de lis. |
|
L'Exposition
nationale de 1865.
Dans le cadre d'un concours prévu à Niort
au printemps 1865, il fut décidé qu'une exposition artistique
et industrielle se tiendrait à l'intérieur de l'église
Saint-Hilaire et sur les parvis extérieurs. À
cette époque, l'édifice est pratiquement achevé, mais
pas encore ouvert au culte. Étant regardé comme
la plus vaste église de la ville, sa superficie se prêtait
bien à ce genre d'événement : 690 m2 pour la nef
; 504 m2 pour le transept
et le chœur.
La nef
et les bas-côtés accueillirent les produits
et créations 'industriels ; le transept
et les chapelles attenantes, les Beaux-Arts. Statuaire
et peintures prirent place au chevet. À l'extérieur,
«une exposition horticole et forestière
ajoutait au charme des yeux et à l'agrément
des visiteurs», écrit le père Ménard
dans son histoire de l'église. Il relate une
idée intéressante appliquée lors
de l'exposition : pour adoucir le contraste trop cru
entre les œuvres d'art et «une pierre trop
blanche et récemment taillée», les
commissaires habillèrent toute l'élévation
du transept
d'une vaste draperie verte.
La partie Beaux-Arts exposait les œuvres de Louis
Germain, peintre niortais, des eaux-fortes et plus de
deux cents tableaux de grands maîtres envoyés
par Paris. Sans compter les pastels, les miniatures,
les dessins et les bustes. Le père Ménard,
étonné de cette profusion, confesse :
«Il est rare, si nous en croyons les gens du métier,
de rencontrer dans une exposition de province de pareils
et de si nombreux éléments.» L'exposition
a d'ailleurs été saluée avec chaleur
par la presse niortaise.
Autour de l'église, d'agréables squares
furent implantés. Ils conduisaient, d'une part
à une annexe avec des machines agricoles et industrielles,
d'autre part à un chalet où se trouvait
une exposition forestière. Ces squares ont par
la suite été remplacés par des
pelouses parsemées d'arbres.
L'exposition fut ouverte du 1er mai au 7 juin 1865.
Lors des trois derniers jours, précise le père
Ménard, «l'entrée en fut absolument
gratuite» (en gras dans le texte) pour que
tous les Niortais pussent en profiter.
Notons que, parmi les lauréats du concours, se
trouvait le peintre Louis Germain, récompensé
pour l'ensemble de ses travaux exposés.
Un dernier point, assez humoristique : le père
Ménard termine sa relation en ajoutant que les
commissaires «avaient admirablement tout réglé
pour que rien ne fût une occasion de désordre
et d'accident.» Par exemple, il était interdit
de fumer dans l'enceinte de l'exposition et une police
d'assurance contre l'incendie avait été
souscrite.
Source : Naissance d'une
paroisse par le père Ernest Ménard,
curé de Saint-Hilaire de 1897 à 1909.
|
|

Soubassement du vitrail de saint Martin et sainte Radegonde
dans le chœur.
À gauche : un arbre sacré païen doit être
abattu. Saint Martin a accepté de rester sous l'arbre pendant
son abattage pour
montrer que ce dernier ne recèle aucun pouvoir magique. L'arbre
est tombé de l'autre côté. À droite : apparition
du Sacré-Cœur
à la reine Radegonde. Pour l'amour du Christ, celle-ci
renonce aux honneurs.
Atelier Lobin à Tours, 1865. |
Saint Martin et sainte
Radegonde ---»»»
Atelier Lobin à Tours, 1865.
Sainte Radegonde est habillée en reine avec couronne,
sceptre et fleurs de lys. |
|
|
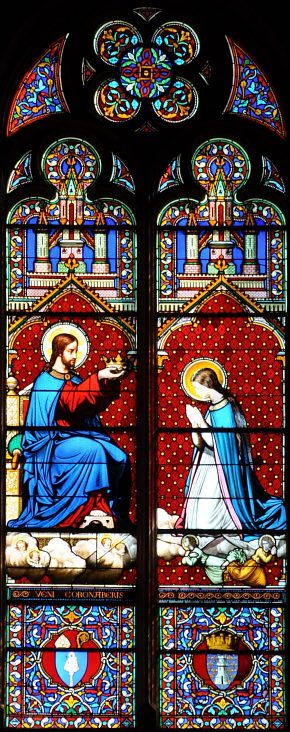
Vitrail central du chœur : le Couronnement de la Vierge
Atelier Lobin, Tours
Vitrail posé en avril 1865. |

Ornementation du chœur, détail. |
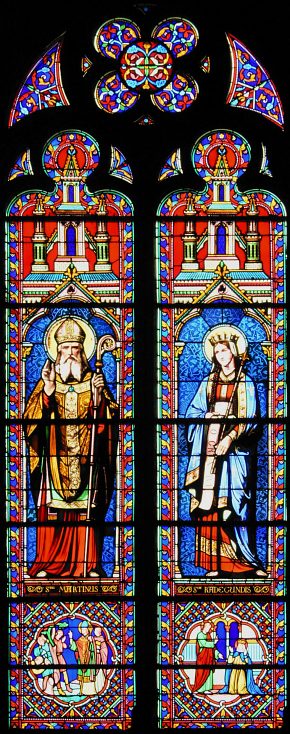
|
|
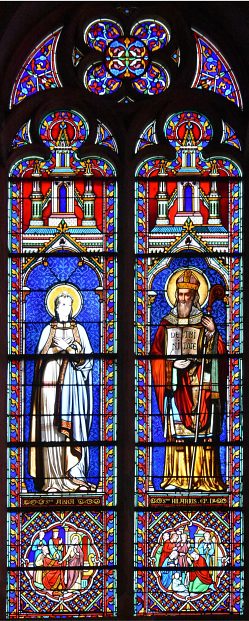
Sainte Abre et saint Hilaire (son père).
Atelier Lobin à Tours
Année 1865.
Le détail du soubassement est donné à droite. |
|

Le bas-relief du maître-autel représente la Cène.
Seconde moitié du XIXe siècle. |
|
Monseigneur
Pie, évêque de Poitiers, contre Napoléon
III.
Sous le Second Empire, de nombreux prélats ultramontains
s'opposèrent à Napoléon III à
cause de sa politique italienne. Ce vaste problème
diplomatique se révélait d'une complexité
insoluble. L'Empereur des Français soutenait le Piémont
contre l'Autriche, mais pas contre le pape. La France devait,
d'une part, honorer la parole impériale d'aider le
voisin italien dans sa lutte pour l'indépendance ;
d'autre part, ne pas s'opposer ouvertement au pape pour ne
pas mécontenter les catholiques français. Un
pape qui, lui, s'opposait au Piémont...
Dans son récit sur l'histoire de l'église Saint-Hilaire, le
père Ménard rappelle la position combative de Mgr Pie. L'évêque
fit parler de lui par sa lettre pastorale du 22 février 1861,
largement diffusée et commentée. Il y condamnait le louvoiement
de Napoléon III dans sa position vis-à-vis de Rome et du pape.
Rappelons que, en septembre 1860, l'armée sarde a battu les
troupes pontificales à la bataille de Castelfidardo, puis
envahi les états du pape. Les Marches et l'Ombrie vont tomber
dans l'escarcelle de Victor-Emmanuel II, roi de Piémont-Sardaigne.
Et le pape ne restera plus qu'avec le seul état du Latium
dont la capitale est Rome. Pour l'évêque, c'est à cause
de l'indécision de l'Empereur que les Piémontais ont tenté
l'invasion des états pontificaux. Dans sa lettre, Mgr Pie
jeta un «Lave tes mains, Pilate !» qui irrita
fort Napoléon III. Dès le 28 février, l'évêque fut déféré
comme abus à la juridiction du Conseil d'État. Le 27
mars, il était condamné par le Conseil.
Mgr Pie revint à la charge le 30 juin suivant, cette
fois en chaire, à la cathédrale de Poitiers.
Il parla d'un Hérode III qui condamna le Christ. Ce
qui fut interprété comme une allusion claire
à Napoléon III. C'en était trop. Il était
urgent d'affaiblir la position de ce prélat retors.
Aussi le gouvernement chercha-t-il à démembrer
le diocèse de Poitiers
en créant un nouveau diocèse à Niort.
L'évêque en appela à Rome et à
la volonté de ses ouailles, opposées à
ce projet. Devant le tumulte, l'idée fut abandonnée.
.En revanche, le gouvernement fit passer un ordre clair :
interdiction à tout fonctionnaire d'entrer en relation
avec l'évêque. Et bien sûr, opposition
directe ou indirecte à la construction de l'église
Saint-Hilaire...
Source : Naissance d'une
paroisse par le père Ernest Ménard, curé de Saint-Hilaire
de 1897 à 1909.
|
|

Sainte Radegonde, détail.
Atelier Lobin à Tours, 1865. |
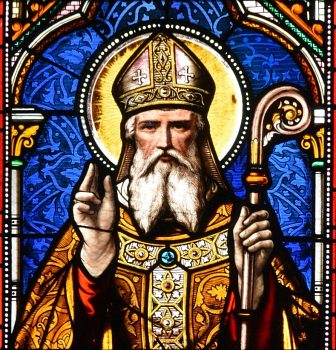
Saint Martin dans un vitrail du chœur.
Atelier Lobin à Tours, 1865. |

Soubassement du maître-autel : la Cène, détail.
Jésus est au milieu des apôtres. |

Soubassement du maître-autel : la Cène, détail.
Les apôtres s'interrogent : «Est-ce moi, Seigneur ?»
Judas, reconnaissable à la bourse qu'il tient en main, est
à droite. |
|
La Cène.
Jésus prend un dernier repas avec les apôtres.
Quel est le moment que l'artiste a choisi de représenter
?
Sans doute, il s'agit du plus connu et du plus chargé
de sens. Jésus vient d'annoncer : «L'un d'entre
vous me trahira.» «Est-ce moi, Seigneur ?»,
demandent ses disciples. Ceux-ci, interloqués, se regardent
les uns les autres, parfois d'un air soupçonneux, parfois
la main sur le cœur.
Dans le gros plan donné ci-contre, on voit Judas sur
la droite. Il a l'air absent, baisse les yeux et tient à
la main la bourse qu'il va recevoir pour prix de sa trahison.
|
|
Saint Hilaire ---»»»
dans un vitrail du chœur.
Atelier Lobin à Tours, 1865.
|
|
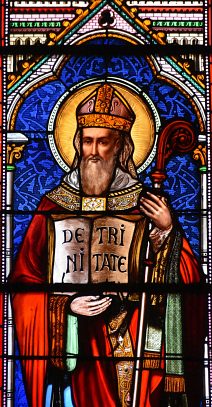 |
|
LE TRANSEPT ET SES CHAPELLES
|
|

La nef et le bras nord du transept vus depuis le bras sud.
Le bras nord est éclairé par le vitrail de sainte
Radegonde. |
|
Sainte
Radegonde et le vitrail de l'atelier Dagrant.
Radegonde (vers 520-587) était une princesse
thuringienne, contrainte en 536 d'épouser Clotaire,
roi de Neustrie. Restée dans l'Histoire comme
une nonne plutôt que comme une reine franque,
elle est en quelque sorte le pendant de Louis VII dont
Aliénor d'Aquitaine, sa femme, disait : «j'ai épousé un moine».
Avec l'aide de Clotaire, Radegonde fait construire l'abbaye
de Sainte-Croix à Poitiers
et s'y retire. En 569, elle y reçoit un fragment
de la sainte Croix envoyé par l'empereur byzantin
Justin II.
Sa vie et sa légende regorgent de faits édifiants
: mortifications (elle portait un cilice), nourriture
frugale ; prières en recluse, soin des pauvres,
miracles. De son vivant, elle fut regardée comme
une sainte.
En 1899, pour réaliser le vitrail des scènes
de sa vie, l'atelier bordelais Dagrant a sélectionné
six épisodes, dont deux sont intéressants
: la libération d'un prisonnier (Radegonde est
leur protectrice) et la réception du fragment
de la sainte Croix en 1569. Parmi les autres saynètes,
on note : apparition du Sacré-Cœur à
Radegonde ; elle lave les pieds des pauvres ; elle rencontre
un ermite ; son décès en 587. Selon le
Dictionnaire des saints et grands témoins
du christianisme, Radegonde a été
proclamée mère de la patrie en
1921 «par l'inscription de sa fête au propre
national français».
Sources : 1) Dictionnaire
des saints et grands témoins du christianisme,
CNRS éditions; 2) panneau affiché dans
l'église.
|
|
|
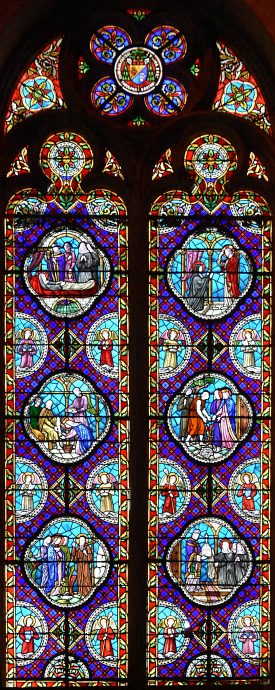
Vitrail des scènes de la Vie de sainte Radegonde
Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899. |

Le bras sud du transept.
La chapelle Sainte-Radegonde est surmontée de la
fresque de Louis Germain : saint Pierre est libéré
de sa prison par un ange. (donné plus
bas). |

Sainte Radegonde reçoit les reliques de la sainte Croix
des mains de l'évêque de Tours, Mgr Euphrone.
Détail du vitrail de sainte Radegonde
Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899. |
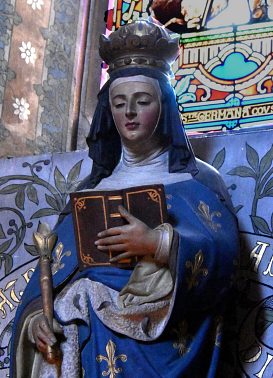
Statue de sainte Radegonde, détail. |
|
Pourquoi
un vitrail de sainte Germaine dans la chapelle dédiée
à sainte Radegonde ? (1/2)
L'explication se trouve dans le récit du
père Ernest Ménard, curé de Saint-Hilaire
de 1897 à 1909, Mémoire d'une paroisse.
Lorsque Mgr Pie, évêque de Poitiers,
entra pour la première fois dans l'édifice,
il remarqua qu'il n'y avait aucun autel dans l'actuelle
chapelle Sainte--Radegonde. Il exprima le désir
que l'autel soit dédié à sainte
Germaine de Pibrac. L'évêque avait une
grande dévotion pour cette humble bergère
de la fin du XVIe siècle, béatifiée
en 1854. Il avait d'ailleurs prononcé son éloge
à Pibrac même, dans la région toulousaine,
peu auparavant. De plus, cette bergère, dont
le vrai nom était Germaine Cousin, venait d'être
canonisée (1867).
--»» Suite 2/2 à droite.
|
|
|
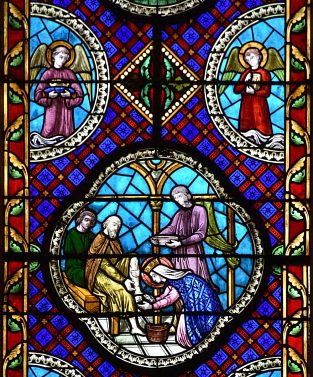
Sainte Radegonde lave les pieds des pauvres
Détail du vitrail de sainte Radegonde
Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899.
|
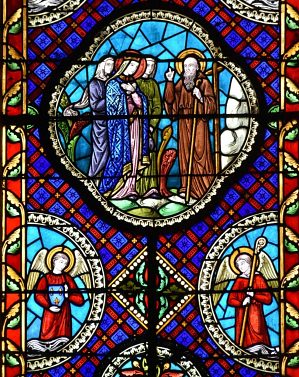
Sainte Radegonde rencontre un ermite
Détail du vitrail de sainte Radegonde
Atelier Dagrant, Bordeaux, 1899. |
|

La chapelle Sainte-Radegonde est éclairée
par un vitrail dédié à sainte Germaine. |
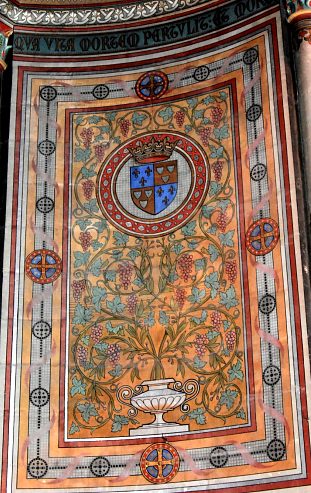
Peinture murale avec armoiries dans la chapelle Sainte-Radegonde. |
|

Vitrail de sainte Germaine de Pibrac. |

«La Libération de saint Pierre par l'ange»
Peinture de Louis Germain au-dessus de la chapelle Sainte-Radegonde.

|
Pourquoi
un vitrail de sainte Germaine ? (2/2)
---»» Les paroissiens firent savoir
à l'évêque que la dédicace
de la chapelle s'était déjà portée
sur Radegonde, reine de France, patronne de Poitiers
et que l'autel était en outre déjà
payé. Le prélat revit son vœu à
la baisse et demanda simplement que le vitrail de la
chapelle rappelât le souvenir de sainte Germaine.
Comme sainte Élisabeth de Hongrie, Germaine de
Pibrac est représentée par l'atelier Lobin
à Tours
lors de l'épisode du miracle des roses. La seconde
épouse de son père, une marâtre
qui la martyrisait, accusa un jour Germaine de voler
du pain pour les pauvres. Elle poursuivit la jeune fille
et l'obligea à ouvrir son tablier. Au lieu des
pains qu'elle pensait y trouver, elle ne vit qu'une
brassée de roses.
|
|
|
|
LA CHAPELLE DE LA VIERGE (BRAS NORD DU TRANSEPT)
|
|

La chapelle de la Vierge avec le vitrail des scènes de la Vie
de la Vierge. |
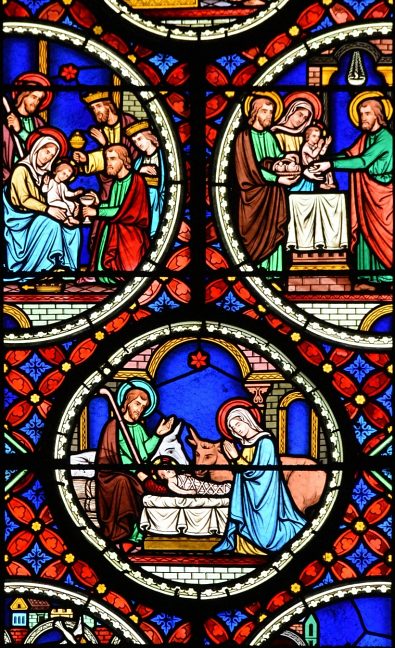
Vitrail des scènes de la Vie de la Vierge, détail.
Atelier Lobin à Tours, 1867. |

Deux litanies encadrent l'autel dans la chapelle de la Vierge.
Ici, Domus Aurea (Maison du Ciel). |
|
|
|
|

Le chœur et le bras sud du transept.
Le bras sud est éclairé par le vitrail du Sacré-Cœur. |

Avec ses arcades sur deux de ses côtés, le bras sud du
transept
affiche un très net aspect néo-roman. |
|
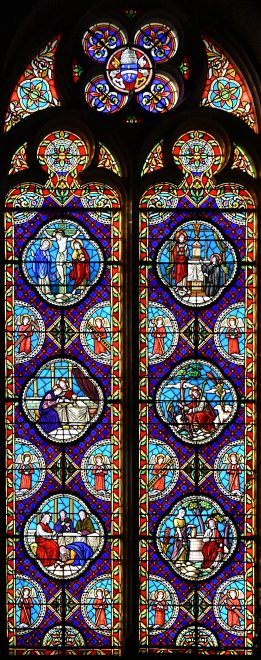
Vitrail du Sacré-Cœur.
Atelier Dagrant à Bordeaux, 1899.
La partie centrale du tympan contient les armoiries
du pape Léon XIII (1878-1903).
|
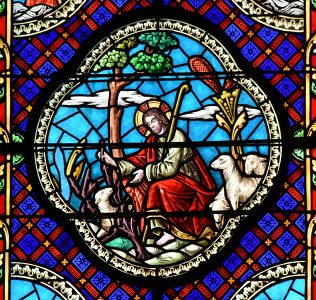
Jésus est le Bon Pasteur
dans le vitrail du Sacré-Cœur.
Atelier Dagrant à Bordeaux, 1899. |

Marie-Madeleine au pied de Jésus
dans le vitrail du Sacré-Cœur.
Atelier Dagrant à Bordeaux, 1899. |
|
|
|
|
|

La chapelle du Sacré-Cœur dans le bras sud du transept. |

La chapelle Saint-Joseph dans le bras sud du transept. |
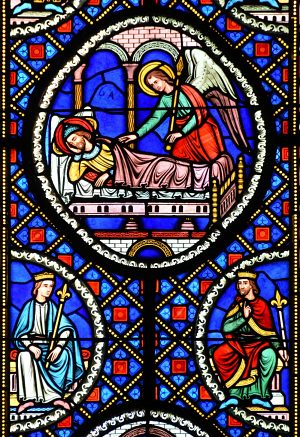
Troisième songe de Joseph : un ange l'informe de la mort d'Hérode.
Lui et sa famille peuvent retourner en Israël.
Vitrail des scènes de la Vie de saint Joseph.
Atelier Lobin à Tours, 1868. |
|
|
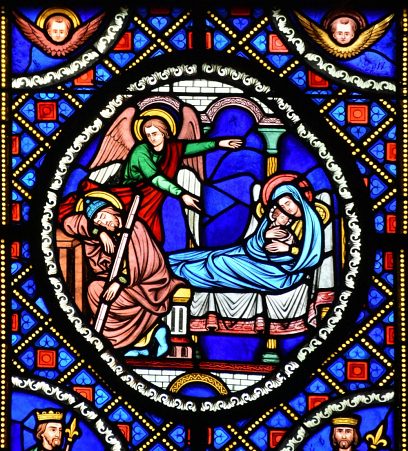
Deuxième songe de Joseph : un ange l'avertit qu'il doit fuir en
Égypte
avec Marie et l'Enfant pour échapper à la colère d'Hérode.
Vitrail des scènes de la Vie de saint Joseph, détail.
Atelier Lobin à Tours, 1868.
|
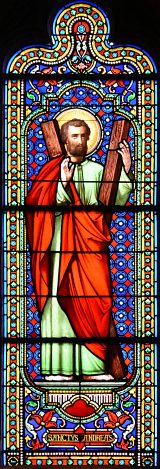
Vitrail de saint André
Chapelle du Sacré-Cœur
Atelier Lobin, Tours. |

L'orgue de tribune est un Debierre de taille fort modeste.
Construit en 1840, il a été acheté et installé
en 1914. |

La nef de Saint-Hilaire vue depuis le chœur. |
Documentation : Panneaux affichés dans
l'église
+ «Naissance d'une paroisse» par le père Ernest Ménard, curé de Saint-Hilaire
de 1897 à 1909 (brochure disponible dans la nef). |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|




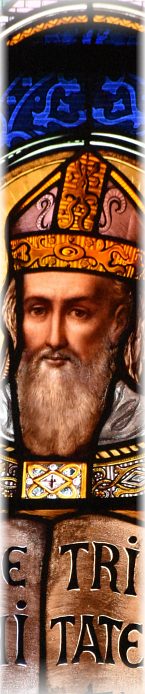
 La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée.
La nef et le chœur de Saint-Hilaire vus depuis l'entrée.