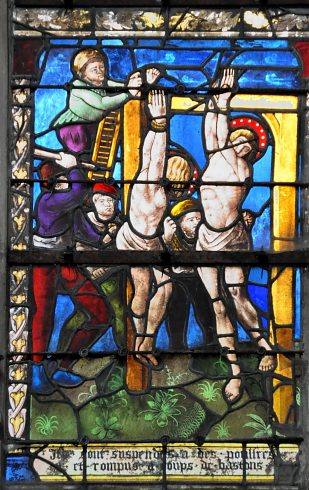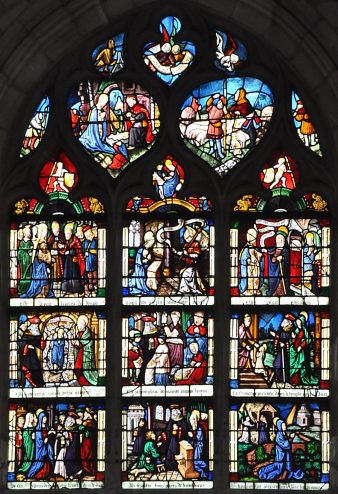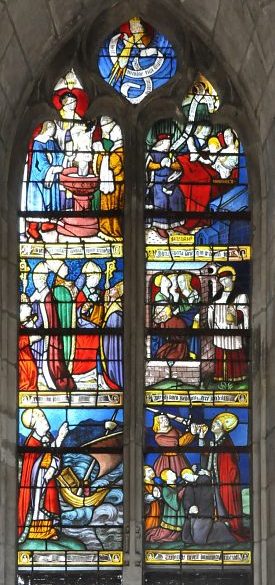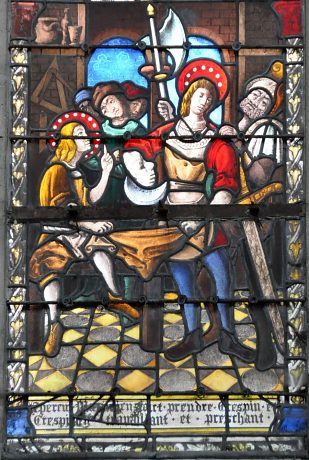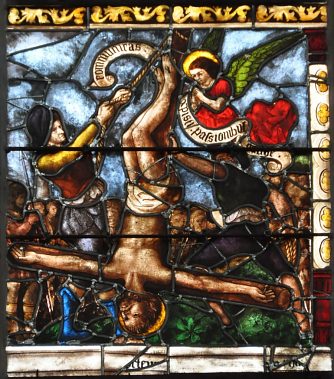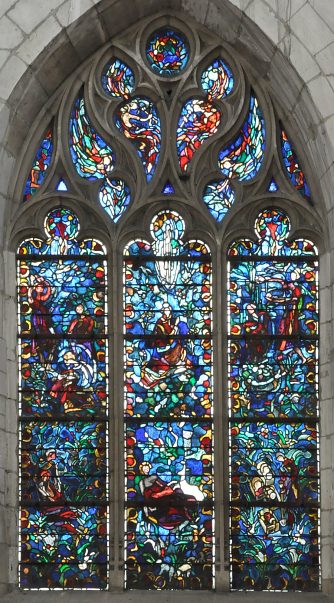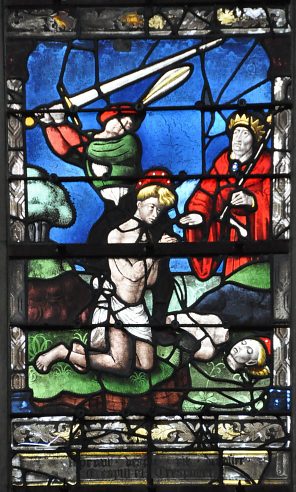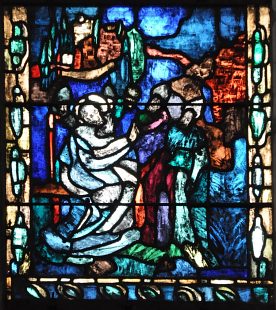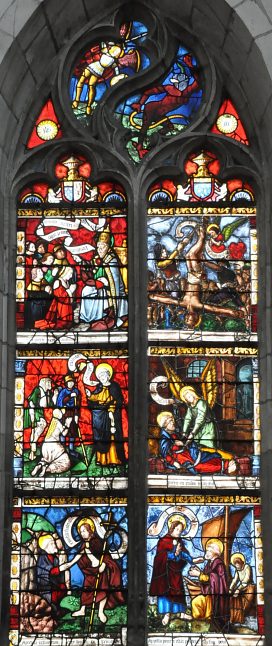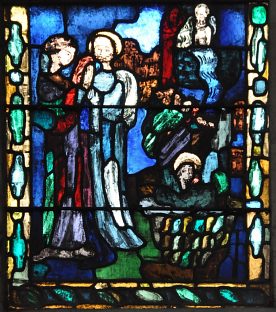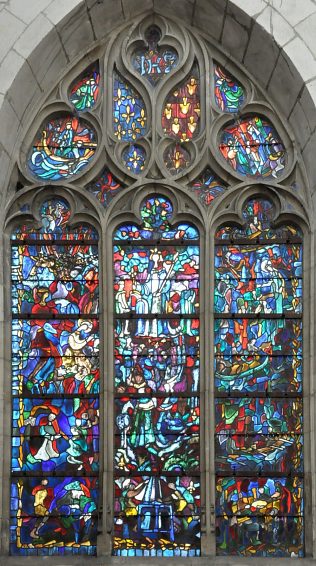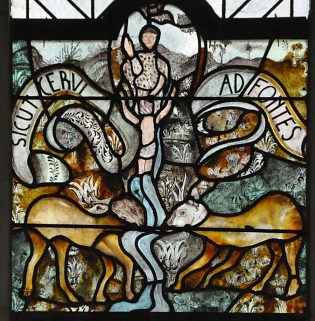|
 |
L'église Saint-Étienne
d'Arcis-sur-Aube a été construite dans les premières
années du XVIe siècle. Les sources nous apprennent
que c'est le seigneur de Mailly et bâtard d'Arcis, Jean de
Poitiers, qui en posa la première pierre. L'architecture
du monument, de style gothique, reste assez sobre : nef avec deux
collatéraux et abside en saillie ; des piliers massifs
sans chapiteau soutiennent l'élévation jusqu'à
la voûte ogivale. Le portail occidental, bien usé par
les ans, est d'un beau gothique flamboyant. L'église Saint-Étienne
a été classée monument historique dès
1840. Les sources ajoutent encore que l'édifice a succédé
à un premier lieu de culte, sans doute roman, dont il ne
reste rien. Au cours des âges, de graves incendies ont failli
détruire l'église Saint-Étienne, surtout celles
de 1625 et 1727. Plus dommageable encore : le bombardement du 14
juin 1940 n'en a laissé que les murs et les piliers. Entièrement
restaurée et la voûte reconstruite, elle n'a été
rendue au culte qu'en décembre 1974.
Sobre en architecture, l'église l'est aussi en objets d'art
: on n'y compte qu'un Christ
en croix moderne au-dessus du chœur et une Vierge
à l'Enfant du XIVe siècle. En revanche, la verrière
de l'abside et des deux absidioles vaut le détour. De
beaux vitraux du XVIe siècle rappellent qu'Arcis n'est
qu'à trente kilomètres au nord de Troyes, ville riche,
à la Renaissance, de ses ateliers de peintres verriers. Les
vitraux de l'église Saint-Étienne sont parfois mêlés
à des créations du XIXe siècle. Enfin, le maître-verrier
Jean-Jacques Gruber a enrichi quelques fenêtres d'œuvres
figuratives ou historiées, tâche accomplie au titre
des dommages de guerre dans les années 1970. Cette page donne
un très large extrait de la verrière de l'église
Saint-Étienne.
|
 |

Vue d'ensemble de la nef de l'église Saint-Étienne.
Longueur : 43 mètres, hauteur de la voûte : 14 mètres
; largeur : 18 mètres
Les vitraux de la nef sont en verre blanc, ce qui donne à l'église
une très grande luminosité. |

Vue de l'église depuis la place de la République. |

Le portail principal en gothique flamboyant (1503). |

La statue de saint Étienne
sur le trumeau du portail principal
date de 1863. |
|

La façade avec ses deux portails date de 1503.
La tour est surmontée d'un dôme enrichi de cinq
lanternons à colonnettes. |

Sculpture d'un animal tenant un serpent
dans sa gueule (portail principal).
À DROITE ---»»»
Sculpture de pampres dans les voussures
du portail principal. |
 |
|

Baignés par leur frange de verdure, l'église et son
clocher, vus depuis le chevet,
ont presque une allure de porte-avions avec son îlot. |

L'élévation dans la nef est à deux niveaux.
Une colonne engagée s'élance de chaque pilier, alternativement
cylindrique ou ondulé. |

Le bas-côté nord avec l'absidiole. |

Vitrail de baie 3 - XVIe siècle : L'entrée dans l'arche. |

Chemin de croix : Jésus tombe une première fois.
À DROITE ---»»»
Vitrail figuratif dans la chapelle absidiale sud
(Jean-Jacques Gruber, années 1970). |
 |
|
| BAIE 3 -
XVIe SIÈCLE : HISTOIRE DE NOÉ |
|
|

Vitrail de la baie 3 - XVIe siècle.
Partie historiée du vitrail
Apparition de Dieu à Noé, construction de l'Arche,
le Déluge.
|

Vitrail de baie 3 - XVIe siècle : Construction de l'arche. |
|
Jean-Jacques
Gruber était le fils de Jacques Gruber,
membre éminent de l'École de Nancy qui
a lancé l'Art nouveau dans les années
1880. Pour l'église Saint-Étienne d'Arcis,
Jean-Jacques Gruber a réalisé des vitraux
figuratifs comme ceux de gauche et du bas de page et
des vitraux historiés en s'appliquant à
ce que leur aspect s'intègre convenablement dans
l'environnement des vitraux Renaissance de l'abside.
Voir la vie de Jacques
Gruber à la page de l'église du Saint-Sépulcre
à Montdidier.
|
|
|
| BAIE 4 - XVIe
SIÈCLE : COURONNEMENT DE LA VIERGE, MORT ET ASSOMPTION
DE LA VIERGE |
|

Vitrail de baie 4 - XVIe siècle : Couronnement de la Vierge, Mort
et Assomption de la Vierge. |

L'absidiale nord avec ses vitraux de Gruber et ses vitraux Renaissance. |

Vitrail de baie 4 - XVIe siècle : La Mort de la Vierge. |

Vitrail de baie 4 - XVIe siècle : Les visages des apôtres dans
le panneau de la Mort de la Vierge. |

|

Vue de la nef avec ses piliers massifs et ses fenêtres hautes
sans ornementation.
«««--- À GAUCHE, Vitrail de baie 4 - XVIe
siècle
Ce premier panneau qui montre un repas (Hérode et Hérodiade?)
n'a pas de rapport avec la vie de
la Vierge. Le XIXe siècle a décidé de l'arrangement
des panneaux de l'église. Et quand les vitraux,
déposés en 1940, ont été remis en place,
cet arrangement a été scrupuleusement respecté. |

La voûte de la chapelle absidiale nord. |
| BAIE 6 -
XIXe SIÈCLE : VIE DE SAINT NICOLAS |
|
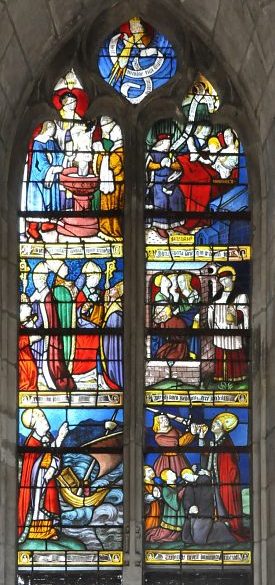
|
|

Clé de voûte : Écusson avec fleur de lys. |

Clé de voûte avec écusson. |
«««---
À GAUCHE
Baie 6 - XIXe siècle
Scènes de la vie de saint Nicolas. |
|

Vitrail de la baie 6 - XIXe siècle, détail.
Saint Nicolas donne son or pour que les trois filles d'un noble
sans fortune ne soient pas livrées à la prostitution.
Ce pastiche de la Renaissance est rendu d'une excellente manière. |

Vitrail de la baie 6 - XIXe siècle
Le bourreau. |
|
Dans le domaine du vitrail,
le XIXe siècle était passé maître
dans l'art du pastiche.
L'église Saint-Étienne en donne un bel
exemple avec la baie 6 qui illustre la vie de
saint Nicolas. Les créations des grands ateliers
de peintres verriers du XIXe, qui jouxtent les vitraux
Renaissance dans l'abside et les deux absidioles, pourraient
passer pour des vitraux des années 1500 tant
les couleurs et les grisailles sont travaillées
pour redonner vie au style de cette époque. L'agrandissement
de la baie 6 (du XIXe siècle) donné ci-dessus
montre des couleurs et des visages porteurs d'une grisaille
typique de la Renaissance.
À part la baie 6, qui est présentée
comme entièrement du XIXe siècle, la notice
de l'église indique que les vitraux des baies
14 (Vie
de la Vierge et Enfance du Christ) et 16
(Scènes de la vie de sainte Anne et Joachim)
relèvent à la fois de l'époque
Renaissance et du XIXe siècle. Il est intéressant
de se livrer sur eux à un exercice savant, mais
difficile : essayer d'y reconnaître les parties
qui ont été ajoutées ou restaurées
au XIXe siècle. L'exercice vaut aussi pour la
baie 9,
un mixte des XVIe et XXe siècles. On donne plus
bas des agrandissements de certains panneaux de ces
baies avec l'époque probable à laquelle
ils sont rattachés.
|
|
|
|
La vie
de saint Nicolas dans la Légende
dorée nous donne l'explication du panneau
de gauche. Nicolas a hérité de parents
riches. Il vit à Patras et cherche à employer
sa fortune «pour la gloire de Dieu». Il
apprend que l'un de ses voisins, homme noble mais sans
fortune, va livrer ses trois filles à la prostitution
pour vivre avec l'argent que la débauche leur
rapportera. Horrifié par cette nouvelle, Nicolas
enveloppe de l'or dans un linge qu'il jette la nuit
par une fenêtre de la maison de son voisin et
s'en retourne chez lui. Au petit matin, l'homme découvrit
l'or, rendit grâce à Dieu et s'enquit d'un
mari pour l'aîné de ses filles. Quelques
jours plus tard, le même processus se déroula
au bénéfice de la puînée,
mais le père se jura d'être attentif pour
trouver qui était son bienfaiteur. Enfin vint
le tour de la benjamine. Saint Nicolas jeta un linge
contenant beaucoup d'or par la fenêtre de la maison
du père. Cette fois, alerté par le bruit,
celui-ci sortit, poursuivit Nicolas qu'il finit par
rattraper, et se jeta à ses pieds. Refusant ses
remerciements, le saint lui fit promettre de garder
le secret.
|
|

Vitrail de la baie 6 - XIXe siècle : Saint Nicolas apaise la
tempête. |
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE |
|

Le chœur de l'église Saint-Étienne et ses vitraux
des XVIe, XIXe et XXe siècles. |
|
|
| BAIE
8 - XVIe SIÈCLE : VIE DE SAINT CRÉPIN
& SAINT CRÉPINIEN |
|

Le Martyre de saint Crépin et saint Crépinien.
Baie 8 - XVIe siècle. |

Baie 8 - XVIe siècle : Un soldat et sa belle grisaille. |
|

Le chœur et l'abside.
Les vitraux du niveau supérieur sont des œuvres
figuratives
de Jean-Jacques Gruber (années 1970). |
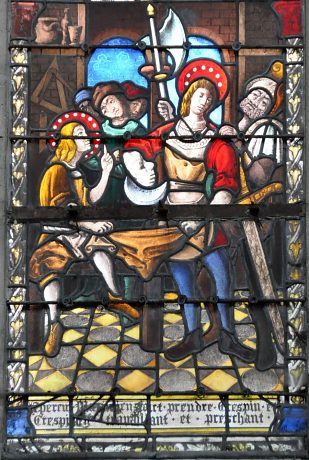
Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : Panneau de l'arrestation
de
saint Crépin et de saint Crépinien dans
leur atelier de cordonnerie. |
|

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : L'arrestation des
deux saints, détail. |

Statue moderne en bois
d'un saint dans le chœur. |
|
|
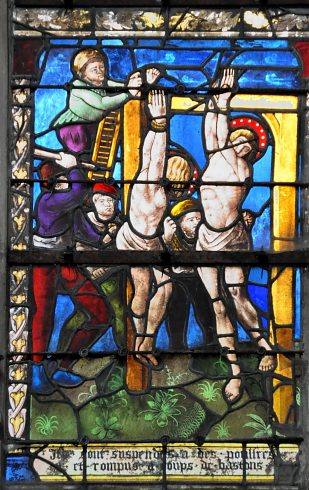
|

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : Le Martyre de saint Crépin
et saint Crépinien, détail
(À gauche et ci-dessus). |

Vitrail de la baie 8 - XVIe siècle : le visage d'un païen à
côté du supplice
Panneau du Martyre de saint Crépin et saint Crépinien. |

La voûte du chœur
(refaite après la dernière guerre). |

Baie 8 - XVIe siècle : Le Martyre de saint Crépin et
de saint Crépinien. |

Baie 8 - XVIe siècle, le Martyre des deux saints : le préfet
Rictiovarus. |
| BAIE 9 -
XVIe ET XXe SIÈCLE : VIE DE SAINT PIERRE |
|

Baie 9 : Panneau de l'Appel de Pierre.
Ce panneau est-il du XVIe siècle? Les visages du Christ
et
de Pierre font plutôt pencher pour le XXe. |
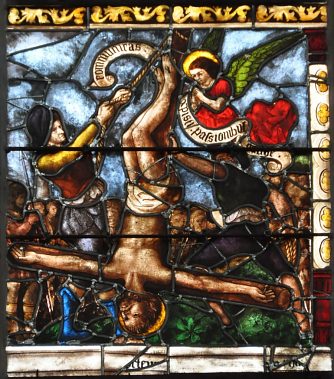
Baie 9 : Panneau du Martyre de saint Pierre.
On pourrait attribuer ce panneau au XVIe siècle,
avec peut-être des retouches du XXe siècle. |
| BAIE 10
- XXe SIÈCLE, JEAN-JACQUES GRUBER |
|
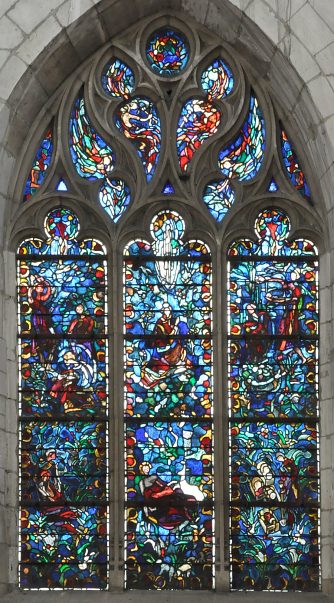
Lapidation de saint Étienne, Résurrection et Ascension du Christ
Baie 10 - années 1970.
Vitrail de Jean-Jacques Gruber.
|
|

Baie 8 - XVIe siècle : Le Martyre des deux saints, détail. |

Baie 8 - XVIe siècle : La Décollation
Détail : L'empereur Maximien. |
|
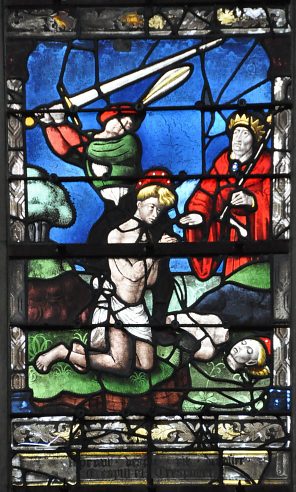
Baie 8 - XVIe siècle : Panneau de la Décollation des deux
saints. |

Baie 8 - XVIe siècle : La Décollation, détail. |
|

La chapelle axiale. |
| BAIE 9 -
XVIe ET XXe SIÈCLES : SCÈNES DE LA VIE DE
SAINT PIERRE |
|
|
|
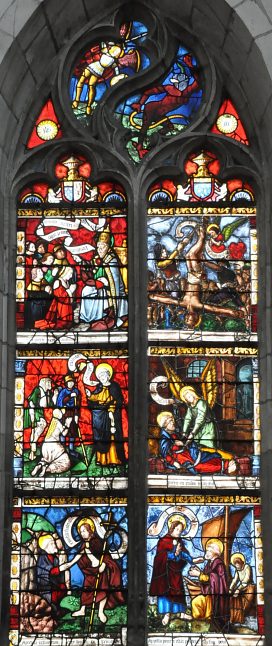
Baie 9 - XVIe et XXe siècles.
Scènes de la vie de saint Pierre. |
| BAIE
11 - XXe SIÈCLE, JEAN-JACQUES GRUBER |
|

Scènes de la vie de saint Paul
Baie 11 - années 1970
Vitrail de Jean-Jacques Gruber. |
|
|
|
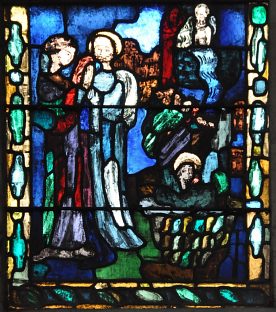
Baie 11 - XXe siècle : Vie de Paul (saint Pierre avec
saint Paul?) |

Le bas-côté sud et l'absidiole. |
| BAIE 14
- XVIe et XIXe SIÈCLES : VIE DE LA VIERGE |
|

Baie 14 - XVIe et XIXe siècles
Vie de la Vierge et Enfance du Christ. |
|
| BAIE 12
- XXe SIÈCLE, JEAN-JACQUES GRUBER |
|
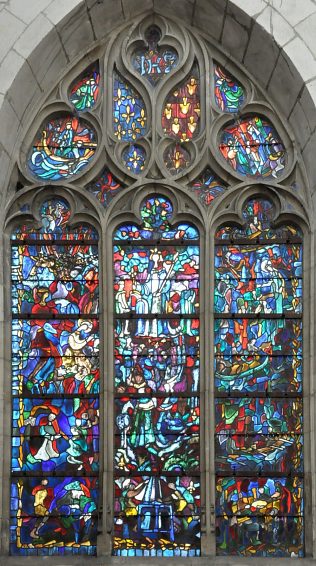
Baie 12 : Saint Balsème, saint Louis et sainte Geneviève
Jean-Jacques Gruber, années 1970. |
| BAIE 14
- XVIe et XIXe SIÈCLES : VIE DE LA VIERGE |
|

Baie 14 : Voyage à Jérusalem.
Panneau vraisemblablement du XVIe siècle
avec des retouches du XIXe. |

La Vierge à l'Enfant
Pierre, XIVe siècle, détail. |
|

La chapelle axiale et ses vitraux. |

Chapelle absidiale sud
avec la statue de la Vierge du XIVe siècle. |

Baie 14 : «Il s'enquit d'eux où le Christ devait naître», détail
Trop parfaite, on sera tenté d'attribuer cette tête
d'un
conseiller du roi Hérode au XIXe siècle plutôt
qu'au XVIe. |

Baie 14 : «Il s'enquit d'eux où le Christ devait naître», détail.
|
|

La Vierge à l'Enfant - Pierre, XIVe siècle. |
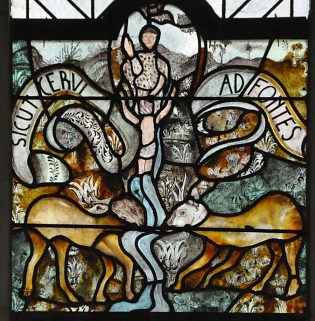
Panneau «Sicut servi ad fontes» (Jean-Jacques Gruber, années
1970). |
|

Baie 14 - XVIe et XIXe siècles : Les rois mages, détail.
Panneau que l'on peut attribuer au XVIe siècle. |

Baie 14 - XVIe et XIXe siècles : L'Adoration des mages.
Les visages de la Vierge et de l'Enfant font pencher immédiatement
pour le XVIe siècle.
Le visage de Joseph et du mage debout sont peut-être des
restaurations du XIXe siècle. |
|
| BAIE 16 - XVIe
& XIXe SIÈCLES : SCÈNES DE LA VIE DE SAINTE
ANNE ET DE SAINT JOACHIM, NAISSANCE ET VIE DE LA VIERGE |
|
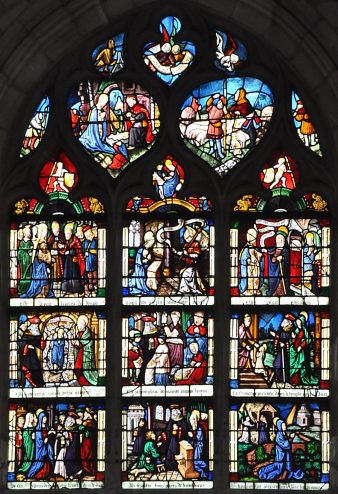
Baie 16 - XVIe et XIXe siècles : Scènes de la vie d'Anne et de Joachim,
Naissance et vie de la Vierge, Annonciation et Visitation. |

Baie 16 - XVIe et XIXe siècle : Panneau : «Elle devient l'épouse
de Joseph».
Il est difficile d'attribuer ce panneau au XVIe ou au XIXe siècle
tant les peintres verriers du XIXe
étaient passés maîtres dans l'art du pastiche.
Toutefois les différences de coloris dans la tunique de
Joseph, son visage ainsi que le réseau des plombs font pencher
pour le XVIe siècle. |

La nef vue depuis la chapelle axiale. |

Baie 13 - XXe siècle, Jean-Jacques Gruber. |
Documentation : Feuillet d'information disponible
dans l'église et dans la mairie d'Arcis-sur-Aube. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |