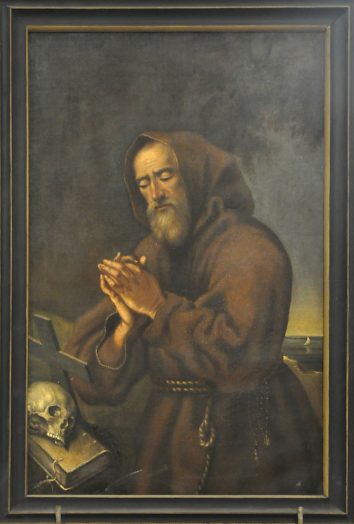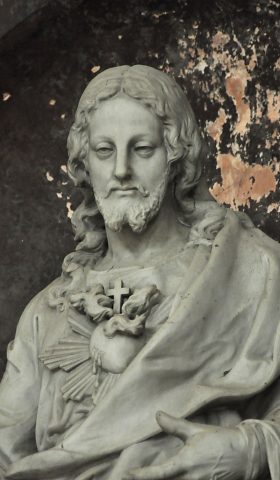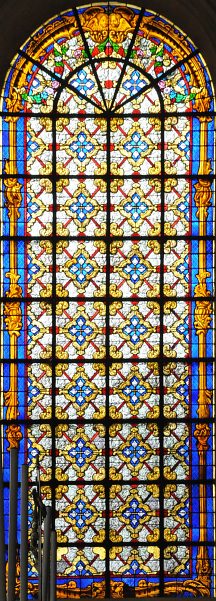|
|
 |
 |
L'église Saint-Jacques de Lunéville
est un édifice récent, lié à l'existence
de l'ancienne abbaye Saint-Remy toute proche. Cette abbaye de moines
bénédictins, fondée par un comte de la maison
de Metz, Fulmar-le-Vieil, en 999, remonte aux origines de l'histoire
de la ville. En 1034, les bénédictins laissent la
place à des moniales, remplacées à leur tour
par des chanoines réguliers de Saint-Augustin en 1135. L'histoire
de Lunéville est ensuite très agitée : guerres
entre Bourguignons et Lorrains, catholiques et réformés,
Bourbons et Habsbourgs. Lors de multiples campagnes, la soldatesque
passe dans la ville ou sous ses remparts, s'enferme dans le château,
le libère, évacue la cité ou l'assiège.
Lunéville change de maître au son du canon. En 1641,
elle est aux mains de Louis XIII, mais Charles IV, duc de Lorraine,
fait bientôt son retour. Dans l'Histoire des villes de
France, l'historien Aristide Guilbert écrit : «Cependant,
une misère horrible était répandue partout
au milieu de ces cruelles vicissitudes de la guerre. Aux environs
de la ville, les loups dévastaient la campagne, et, à
l'intérieur, une famine si affreuse en décimait chaque
jour la population, qu'on déterrait les cadavres pour les
dévorer.» Pour fermer le ban, en 1678, l'armée
française envahit le duché. Louis XIV fit démanteler
les fortifications et raser le château.
Évidemment, au cours de cette période tumultueuse,
la discipline du monastère Saint-Remy se relâcha. En
1622, l'évêque de Toul y envoya Pierre
Fourier pour la reprendre en main et lui imposer, dans le cadre
de la réforme catholique, la réforme des chanoines
dont les règles avaient été édictées
par Pierre
Fourier lui-même. Saint-Remy sera la première maison
de la Congrégation de Notre-Sauveur, approuvée par
Rome en 1625 et agent dynamique de la Contre-Réforme.
En 1703, les Français occupèrent Nancy.
Conséquence : Lunéville devint une capitale et le
château ducal fut entièrement rebâti. Cette mesure
entraîna un renouveau architectural qui vint se greffer sur
la frénésie de reconstruction dont faisait preuve
le clergé lorrain depuis le début du XVIIIe siècle.
À ce titre, François III étant duc de Lorraine,
la première pierre d'un nouvel ensemble monastique fut posée
à Lunéville le 19 juillet 1730. Mais, faute d'argent,
le chantier fut interrompu.
En 1737, le roi Stanislas Lezsczynski fut l'un des vaincus de la
guerre de Succession de Pologne. En compensation de la perte de
son trône, un règlement européen lui offrit
les duchés de Lorraine et de Bar (tandis que François
III devenait grand-duc de Toscane). La politique du nouveau duc
fut bienveillante. En 1743, s'intéressant à l'abbaye,
il proposa d'y transférer l'église paroissiale Saint-Jacques,
l'ancienne étant très délabrée. La nouvelle
église serait donc à la fois abbatiale et paroissiale.
Mais beaucoup doutèrent de cette possibilité : comment
faire concilier deux offices différents? Sans oublier le
partage des tours et des cloches : une tour pour les moines, une
tour pour la paroisse... Pour faire taire les réticences,
Stanislas ouvrit sa bourse et fit détruire l'ancienne paroissiale.
La nouvelle église Saint-Remy-Saint-Jacques, de style baroque
et dont l'abside était enserrée dans les bâtiments
de l'abbaye, fut consacrée en octobre 1745.
À la Révolution, l'abbaye fut supprimée. L'église
perdit son appellation d'abbatiale et devint simplement «Saint-Jacques».
Dans son état actuel, l'édifice, coloré d'un
beau jaune Marie-Thérèse, est assez sobre. La décoration
rocaille de ses chapiteaux et des pendentifs de sa croisée
lui apporte une touche artistique d'agréable facture. Signalons
la présence de nombreux tableaux des XVIIIe siècle
et postérieurs, abondamment reproduits dans cette page. L'église
Saint-Jacques possède encore ses grandes verrières
du XVIIIe siècle que les guerres du XXe n'ont pas endommagées.
Enfin, on notera qu'Émilie
du Châtelet, mathématicienne et maîtresse
de Voltaire, repose dans l'entrée de l'église.
|
 |

Vue de la nef et du chœur de Saint-Jacques.
Dès l'entrée, le visiteur est frappé par la couleur
jaune Marie-Thérèse qui domine dans l'intérieur
de l'édifice. |

La façade de l'église Saint-Jacques.
Les tours de 58 mètres de haut dominent la ville. |

Le côté sud de l'église et ses grandes fenêtres
en plein cintre. |
|

L'Hôtel de ville de Lunéville (anciens bâtiments
de l'abbaye Saint-Remy) cache en grande partie le chevet de
l'église. |

Statue de saint Népomucène sur le clocher.
Œuvre de Barthélemy Guibal (XVIIe siècle). |
|
Architecture
extérieure. Au premier coup d'œil,
la façade de l'église Saint-Jacques paraît
bien ramassée par rapport à la hauteur
des deux tours qui la surmontent. Cette façade,
très sobre, suit un ordre colossal ionique. Bien
que soulignée par un avant-corps, elle semble
être tout d'une pièce. En fait, elle annonce
l'organisation spatiale interne : celle d'une église-halle.
Le fronton,
orné d'aigles et d'étendards sculptés,
est porté par deux colonnes jumelées.
Quant au groupe de l'horloge qui remplit le vide entre
les deux tours, il n'a été érigé
qu'en 1749. Et aux frais des habitants de la ville,
alors que la plus grosse partie de la construction a
été financée par le roi Stanislas.
La consécration de l'édifice a eu lieu
le 2 octobre 1745 - les ouvriers s'activaient encore
à la construction des tours. Les lanternons qui
les coiffent - et qui culminent à 52 mètres
- sont inspirés de ceux de la cathédrale
de Nancy,
mais dans une version rocaille.
La conception initiale de l'église - et de la
façade - est due à Nicolas Jennesson.
Celui-ci a ensuite été supplanté
par Emmanuel Héré, dans des conditions
restées obscures. Héré a remplacé
les clochers bulbeux du plan initial par des lanternons.
C'est également sur ses directives que les statues
de saint Michel et de saint Jean Népomucène
ont pris la place de celles de la Foi et de l'Espérance,
prévues dans le plan initial pour le couronnement
des tours. Les statues ont été ciselées
par Barthélemy Guibal (1699-1757), sculpteur
né à Nîmes et qui s'était
fixé à Lunéville en 1720. Source
: Congrès archéologique
de France, Nancy & Lorraine méridionale,
article sur l'église Saint-Jacques de Lunéville
par Pierre Sesmat, 2006
|
|
|

Le fronton de la façade.
Surmonté de quatre angelots, il est orné d'emblèmes
guerriers : aigles, faisceaux, étendards. Il rappelle le fronton
de l'Hôtel de ville de Nancy. |
| LA NEF ET SES
GRANDES FENÊTRES |
|

La nef et le bas-côté sud avec ses colonnes cylindriques
très sobres et ses grandes fenêtres. |
|
Architecture
intérieure. L'église
Saint-Jacques se compose de deux parties distinctes
: 1) le chœur et le transept forment un ensemble
cohérent de trois absides à peu
près identiques (la travée droite
du chœur étant un peu plus profonde
que celles des croisillons nord et sud) ; 2) la
nef et ses deux bas-côtés constituent
à eux trois une nef-halle. Si le vaisseau
central accuse une hauteur imposante de 19,30
mètres, c'est néanmoins la largeur
des trois vaisseaux qui retient l'attention. Vaisseau
central : 10 mètres, bas-côtés
: 6 mètres. Cette largeur des allées
latérales donne l'impression que les murs
gouttereaux ont été rejetés
le plus loin possible vers l'extérieur.
Conséquence : les fenêtres sont insérées,
entre les piles qui servent de contreforts, dans
un large ébrasement concave qui assure
un maximum de lumière, une lumière
que les vitraux en verre blanc n'obstruent pas
(voir plus
bas). Autre point remarquable : vaisseau central
et collatéraux n'utilisent qu'un seul type
de voûtement, une voûte en pendentifs
scandée d'arcs-doubleaux peints en jaune
Marie-Thérèse. De la sorte, la différence
de hauteur entre vaisseau central (19,30m) et
collatéraux (16,70m) passe inaperçue.
L'historien Pierre Sesmat écrit dans son
étude de l'église pour le Congrès
archéologique de France tenu à
Nancy en 2006 : «Ainsi Saint-Jacques paraît
juxtaposer deux types d'architecture différents.
C'est que, lors de sa conception, les bâtisseurs
ont vraisemblablement voulu concilier deux références.
Le dispositif du chœur et du transept est
visiblement inspiré de la cathédrale
de Nancy et met en valeur le statut de Saint-Remy-Saint-Jacques
comme principale église de Lunéville,
capitale politique. Quant à la nef-halle,
sa référence se trouve dans les
grandes abbatiales lorraines des ordres réformés
dont les chantiers viennent de s'achever et qui
n'ont pas manqué d'impressionner par leur
nouveauté.» Pierre Sesmat fait référence
à l'abbatiale Saint-Clément de Metz,
l'abbatiale de Saint-Mihiel, celle d'Autrey et
surtout celle des Prémontrés
à Pont-à-Mousson.
À propos ---»»
|
|

La Piéta du monument aux morts. |
|
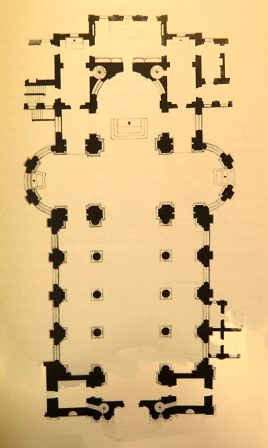
Plan de l'église Saint-Jacques. |
|
--»»
de la nef-halle, l'historien questionne : «On
doit s'interroger sur les motifs qui ont poussé
les promoteurs religieux de tous ces édifices
à adopter l'église-halle : s'agit-il
d'un simple phénomène de mode ou
bien ne pourrait-on pas émettre l'hypothèse
que le type spatial de la halle fonctionne comme
une sorte d'emblème propre aux religieux
lorrains des siècles classiques, comme
un signe d'appartenance à la réforme
catholique? En tout cas, cette double référence
à des édifices majeurs lorrains
démontre clairement l'ambition du projet
de Saint-Remy-Saint-Jacques».
Au niveau artistique, les six colonnes ioniques
qui bordent le vaisseau central sont surmontées
de chapiteaux baroques (voir un exemple plus
bas), fortement inspirés par le style
en vogue en Europe centrale : on y reconnaît
sans conteste le goût artistique du roi
Stanislas. Il en va de même dans le chœur
et le transept.
Source : Congrès
archéologique de France, Nancy & Lorraine
méridionale, article sur l'église
Saint-Jacques de Lunéville par Pierre Sesmat,
2006.
|
|
|

Le tympan du monument aux morts : un ange veille sur un mort
de la Grande Guerre.
(Sculpteurs Huel, Wolf et Martin). |
|
|
|
Les
verrières de l'église Saint-Jacques.
L'église de Lunéville a la particularité
de posséder encore ses vitraux du XVIIIe siècle
(à part deux vitraux des années 1870 dans
le chœur, voir plus
bas). Ces vitraux du XVIIIe sont remarquables à
plus titre. En effet, ils illustrent la volonté
des chanoines de l'époque de tirer un trait sur
les vitraux historiés plus ou moins opaques.
Les clercs veulent de la lumière dans leur église
afin de pouvoir y lire bréviaires ou Bible. Ce
phénomène français s'est soldé,
en partie, par la dépose des vitraux anciens
et, en partie aussi, par leur destruction pure et simple.
Les nouveaux vitraux étaient en verre blanc,
caractérisé par un circuit de plomb multipliant
les dessins géométriques savants. Les
deux photos ci-dessous en donnent un bon aperçu.
Seul le bord du vitrail pouvait faire l'objet d'une
certaine recherche artistique. La frise accueillait
fleurs, coquilles, rinceaux et médaillons qui
se mariaient les uns aux autres, en se gardant bien
de trop déborder sur la partie vive de la verrière.
Parfois, le haut du tympan bénéficiait
d'un décor plus travaillé, comme le montre
le visage du chérubin donné ci-contre.
La conséquence fut rapide : le savoir-faire français
dans l'art du vitrail s'appauvrit, puis disparu.
Au XVIIIe siècle, les verrières en place
à la cathédrale
Notre-Dame de Rouen
obéissaient à cet impératif du
verre blanc. Quand la seconde guerre mondiale éclata,
les services municipaux et ceux du Patrimoine ne jugèrent
pas utile de les déposer : la tâche aurait
été trop fastidieuse pour la perte artistique
toute relative qu'on acceptait de subir. Et, de fait,
ces vitraux ont bel et bien été tous détruits
par le souffle des explosions lors des combats de l'été
1944...
Si les vitraux du XVIIIe siècle inondaient de
lumière les nefs et les chapelles, on s'aperçut
bien vite qu'ils ne favorisaient en aucun cas le recueillement
et la prière des fidèles. Le clergé
en arriva souvent à installer des rideaux pour
atténuer cette lumière envahissante. Au
fil des décennies, évidemment, l'état
de ces étoffes se dégrada.
Avec l'arrivée de maîtres verriers anglais
(chapelle
royale des Orléans à Dreux,
églises Sainte-Élisabeth
et Saint-Laurent
à Paris), la première moitié du
XIXe siècle vit le renouveau du vitrail en France.
On en revint alors à la pratique des vitraux
colorés figuratifs.
|
|

Vitrail du XVIIIe siècle :
la priorité est donnée à la lumière. |

Vitrail du XVIIIe siècle
la frise rocaille du bord. |
|
Saint
Pierre Fourrier (1565-1640) est l'un des
saint lorrains les plus importants par son œuvre
monastique et la part qu'il prit à l'édification
de la Réforme catholique. Au XVIe siècle
et jusqu'au début du XVIIe, à une époque
de famines et de peste, la région de Lunéville
est en plus frappée par le passage fréquent
de la soldatesque : les armées des Bourbon guerroient
sans cesse contre celles des Habsbourg. La discipline
du monastère Saint-Rémy se relâche.
Pierre Fourier y est envoyé par l'évêque
de Toul en 1622 pour réformer l'abbaye : elle
deviendra la première maison de la Congrégation
de Notre-Sauveur.
|
|
|

Tympan d'un vitrail du XVIIIe siècle.
Le sommet du tympan bénéficie d'une décoration
rocaille que l'on retrouve au bas du vitrail et sur les côtés.
C'est le maximum que l'on puisse faire pour ne pas boucher le
passage de la lumière. |

Autel secondaire Saint-Joseph dans le bas-côté
nord. |

Cénotaphe du roi Stanislas Leszczynski
dans le bas-côté nord.
L'inscription indique :
«À Stanislas Leszczynski.
Roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar.
Décédé à Lunéville le 23
février 1766.
Les entrailles de ce bon roi,
surnommé le Bienfaisant,
ont été déposées dans ce monument.» |

«Saint Pierre Fourier»
Tableau anonyme, 1731.
|
 «Saint
Bruno» «Saint
Bruno»
Tableau de F. Bilet ou Bilge, 1732. |
|
|

Statue de saint Joseph par Seyer, fin du XIXe siècle
Autel secondaire Saint-Joseph. |

«Le Christ au jardin des Oliviers», détail.
Le regard du Christ, à la fois dirigé vers l'ange
et vers le Père,
confère à ce tableau une force tragique exceptionnelle. |
|

Chapiteau ornant un pilier dans le goût du baroque d'Europe
centrale. |

Le baptistère avec un toile du baptême du Christ
(anonyme, XVIIIe siècle). |

On trouve une réplique de ce tableau à l'église
Saint-Gengoult
de Toul
dans l'autel des Agonisants. |
|

«Annonciation»
Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |
|
Le
Christ au jardin des Oliviers.
Ce tableau du XVIIIe siècle, qui reste anonyme,
peut être regardé comme un chef-d'œuvre.
C'est une toile imposante de 2 mètres sur 1,50
mètre.
Le questionnement tragique du Christ, soutenu par un
ange, rappelle le tableau d'Eugène Delacroix
à l'église Saint-Paul-Saint-Louis
de Paris. Delacroix a peint un Christ déchiré
entre son devoir divin et son supplice à venir
en tant qu'être de chair.
Dans la peinture anonyme ci-contre, le caractère
à la fois tragique et pathétique de la
scène vient du fait que le Christ détourne
son regard du calice qui vient d'apparaître, à
contre-jour, sur le rocher. Comme il le sait lui-même,
ce calice est destiné à recevoir son sang,
dans une des symboliques les plus fortes du christianisme.
L'ange qui le soutient lui rappelle doucement son devoir
en désignant ce calice d'un doigt de sa main
gauche.
Le gros plan à gauche permet de mieux appréhender
le puissant regard du Christ qui, levant les yeux vers
le Ciel, interroge son Père. Dans la toile de
Delacroix à l'église Saint-Paul-Saint-Louis,
le peintre a choisi une autre posture : le Christ, pratiquement
couché, accepte son sort en levant un bras vers
son Père, tout en baissant la tête, résigné.
Ici, la symbolique du calice, futur réceptacle
de son sacrifice pour sauver l'humanité, dégage
plus de force. Et ce symbole est encore accentué
par la lumière qui illumine le visage du Christ
et l'épaule de l'ange : cette lumière
vient tout entière du calice qui se dresse sur
le rocher.
Selon la base Palissy, la toile a été
restaurée peu avant 1935.
|
|
«««---
À GAUCHE
«Le Christ au jardin des Oliviers»
Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |
|
|

La chaire à prêcher de François Vallier,
1745. |

«Décapitation de saint Jacques»
Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |
|

Guirlandes et têtes de chérubins ornent l'abat-son
de la chaire à prêcher.
La chaire, créée par François Vallier,
date de 1745. |
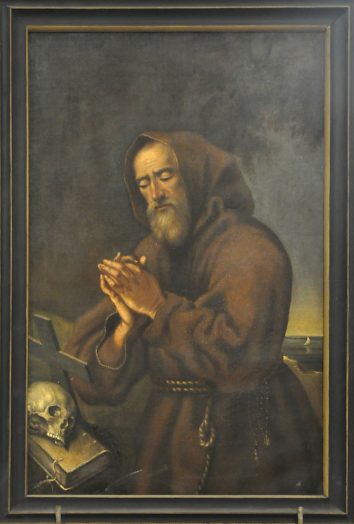
«Saint François de Paule»
Tableau anonyme du XVIIIe siècle. |

Détail de la sculpture en stuc sur un pilier de la croisée. |
À DROITE ---»»»
Saint Ambroise
Cuve de la chaire à prêcher (1745). |
|
|

Saint Jérôme
Cuve de la chaire à prêcher (1745). |

Saint Augustin
Cuve de la chaire à prêcher (1745). |
 |
|
| LE TRANSEPT ET
SA DÉCORATION EN STUC |
|

Le transept avec l'autel de messe et le retable du croisillon sud
(dédié au Sacré-Cœur).
Le haut des piliers et des pilastres est orné d'un décor
baroque rappelant le style en vogue en Europe centrale. |

«Christ en croix»
Tableau de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle). |

Le taureau de Luc (stuc)
sur la voûte de la croisée. |
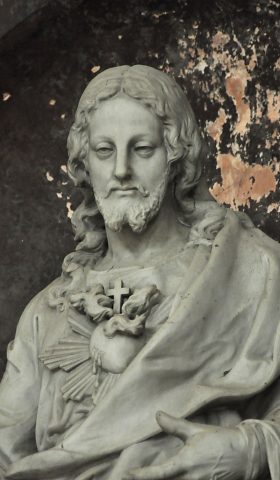
La statue du Sacré-Cœur, détail
Œuvre de Victor Hue (fin du XIXe siècle). |

La Vierge à l'Enfant
Statue de Victor Huel (1886) dans le croisillon nord. |
À DROITE
---»»»
«Le Christ apparaissant à saint Jean
de la Croix»
Tableau de Charles Mulnier, 2e moitié du
XVIIIe siècle. |
|
|
|

La croisée, le chœur et le croisillon sud. |
|

«Institution du Rosaire»
Tableau attribué à Van Schuppen (vers 1730). |

Les instruments du culte, en stuc
décorent la voûte du croisillon sud du transept. |

«Stanislas , roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar»,
Écusson dans la voûte de la croisée. |

«Calvaire»
Tableau de Franz-Pieter Grebber (1630). |

La croisée et le croisillon nord du transept. |

La Vierge à l'Enfant, détail.
Statue de Victor Huel (1886) dans le croisillon nord. |
|

«Trinité et Sainte Famille»
Tableau anonyme. |

«Saint Joseph portant l'Enfant Jésus»
Tableau de Jean Girardet, 1ère moitié du XVIIIe siècle. |

«Saint Joseph portant l'Enfant Jésus», détail
Tableau de Jean Girardet, 1ère moitié du XVIIIe siècle. |
|
|

L'autel de messe à la croisée et le chœur de l'église
Saint-Jacques. |

«Sainte Famille et saint Ignace»
Tableau anonyme (début du XVIIIe siècle). |

«Sainte Catherine d'Alexandrie défendant sa foi
devant les docteurs»
Fresque de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle). |
 |
|
|
Le
chœur se présente sous la même
forme que les croisillons nord et sud : une travée
droite couverte d'une voûte en pendentifs et une
extrémité semi-circulaire. Si les croisillons
possèdent trois ouvertures assez lumineuses,
l'abside du chœur n'en possède que deux.
Encore sont-elles mal éclairées car elles
donnent sur des cours étroites. De plus, l'Hôtel
de ville, sur le chevet, fait obstacle à la lumière.
La baie axiale accueille une peinture de Jean Girardet
: Le
Baptême de Clovis. Les deux autres baies reçoivent
les deux seuls vitraux historiés de l'église,
relatant deux épisodes de la vie de saint Jacques,
apôtre (atelier Maréchal de Metz), vers
1870.
Artistiquement, le chœur est d'essence baroque,
scandé de grandes bandes verticales peintes en
jaune Marie-Thérèse. Les lambris et les
stalles qui encadrent le maître-autel sont l'une
des richesses de l'édifice. Ils ont été
créés par François Vallier, vers
1745. En revanche, le maître-autel est plus ancien.
C'est même la seule partie du mobilier qui vienne
de l'ancienne église Saint-Jacques, détruite
vers 1746. Il est en marbre et a été réalisé
par Renoult en 1713.
|
|

Détail des boiseries du chœur.
Elles sont l'œuvre de François Vallier, vers
1745. |

«Le Christ et sa mère, Piéta»,
détail.
Pierre polychrome XVe siècle. |
|

«Le Christ et sa mère, Piéta»
Pierre polychrome XVe siècle. |

Détail des boiseries du chœur. |
|

«Saint Hyacinthe»
Tableau anonyme du XVIIIe siècle
(Hyacinthe sauve la Sainte Réserve et la statue
de la Vierge
lors de la prise de Kiev par les Tartares.) |
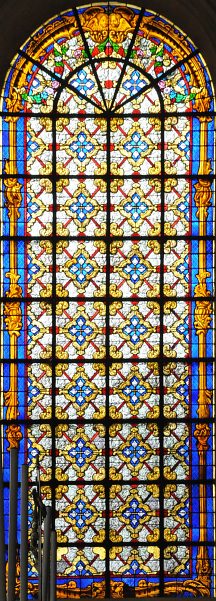
Vitrail du XVIIIe siècle
à formes géométriques. |
|
Saint
Hyacinthe est un moine dominicain du
XIIIe siècle qui reçut la charge
d'évangéliser les peuples de l'Europe
de l'Est. Dans la toile ci-dessus, les Tartares
attaquent Kiev. Une partie de la ville est en
flammes. Hyacinthe sauve la Sainte Réserve
et une statue de la Vierge qui aurait eu la particularité
d'être plus lourde que lui.
Cette histoire n'est guère traitée
en Europe occidentale où saint Hyacinthe
est quasiment ignoré. Cependant, il est
vénéré en Pologne. C'est
sans doute au fait que Stanislas Leszczynski avait
pu continuer à porter le titre de roi
de Pologne durant son exil en Lorraine que
l'on doit la présence de cette toile dans
l'église Saint-Jacques.
|
|
|
«««---
À GAUCHE
Le chœur est éclairé par deux vitraux
au nord et au sud.
Une fresque de Jean Girardet (Le Baptême du Christ)
remplace le vitrail axial. |
|
|

«Saint Antoine de Padoue»
Tableau de 1653.
Les armoiries d'Étienne de la Tour (1621-1692), fils du peintre,
sont visibles sur la droite. |

Le maître-autel de 1713 et les boiseries de 1745. |

«Saint Rémy baptisant Clovis»
Fresque de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle).
Cette fresque occupe la baie axiale du chœur. |

«La Vocation de saint Jacques»
Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz
(vers 1870). |

«La Vocation de saint Jacques», détail.
Vitrail de l'Atelier Maréchal de Metz (vers 1870). |

«Saint Augustin et les religieuses de la congrégation
Notre-Dame»
Tableau anonyme de 1730. |

«L'Arrestation de saint Jacques», détail.
Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz, vers 1870.
Saint Jacques est l'un des deux apôtres vénérés
à Compostelle. |

«La Vierge et l'Enfant avec saint Jean-Baptiste»
Tableau anonyme du XVIIIe ou XIXe siècle. |

La croisée et la nef. |
|
|
|
Les
vitraux XIXe siècle. L'atelier Maréchal
de Metz a réalisé les deux vitraux de
l'abside vers 1870. Ils sont consacrés à
deux épisodes de la vie de saint Jacques : sa
vocation et son arrestation. Les gros plans donnés
dans cette page montrent que ce sont des vitraux-tableaux
: une scène de grande ampleur est découpée
par un quadrillage régulier de barlotières.
On notera que l'atelier a respecté le style rocaille
de l'église dans les tympans des verrières.
Le gros plan donné plus
bas en donne une illustration.
Détail pratique : la présence de l'Hôtel
de Ville contre le chevet (voir
plus haut) perturbe totalement la mesure colorimétrique
calculée par les appareils photos numériques.
Le haut est surexposé alors que le bas est plongé
dans la pénombre.
|
|

«L'Arrestation de saint Jacques»
Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz
(vers 1870). |
|

«La Vocation de saint Jacques», le tympan du vitrail reproduit
le style rocaille de l'église.
Vitrail de l'atelier Maréchal de Metz (vers 1870). |

«Saint Rémy baptisant Clovis», détail
Fresque de Jean Girardet (milieu du XVIIIe siècle). |
|
|

L'orgue de tribune et l'entrée ouest. |
|
L'orgue
de tribune. Orgue et buffet ont été
exécutés entre 1749 et 1751. Le buffet,
qui n'a aucun tuyau apparent, a été imaginé
par Emmanuel Héré. Cette dissimulation
de l'orgue derrière un décor de théâtre
est unique en Europe. L'instrument en lui-même
a été installé par le facteur d'orgue
Nicolas Dupont (1714-1781). La fresque en trompe-l'œil,
œuvre d'André Joly, représente
les portes du paradis. L'orgue possède 3880 tuyaux.
Remanié en 1823, il a été transformé
en orgue romantique en 1852 par Jean-Nicolas JeanPierre
(1811-1873). La dernière restauration a eu lieu
en 2003. Source : Document sur
l'église disponible dans la nef.
|
|
|

Le haut-bois. |

Le violon. |
| ANGES MUSICIENS EN STUC DANS
LE BUFFET D'ORGUE |
|

La mandoline ou le Luth. |

La flûte. |
|
|
|
|
|
|

L'orgue de tribune est caché par un somptueux décor
baroque en trompe-l'œil qui réprésente les portes
du paradis. |

Les armoiries de Stanislas Leszczynski
trônent au centre du buffet d'orgue. |

La nef et l'orgue de tribune vus depuis le chœur. |
Documentation : «Congrès archéologique
de France, Nancy & Lorraine méridionale», article
sur l'église Saint-Jacques de Lunéville par Pierre Sesmat,
2006
+ «Dictionnaire des églises de France», éditions
Robert Laffont, 1971
+ Feuillets de présentation de l'église disponibles
dans l'église Saint-Jacques. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|




























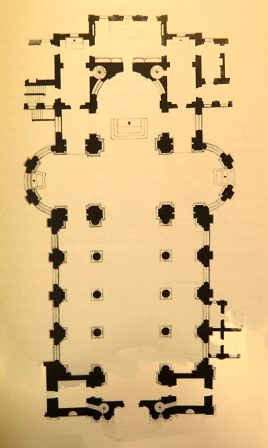










 «Saint
Bruno»
«Saint
Bruno»