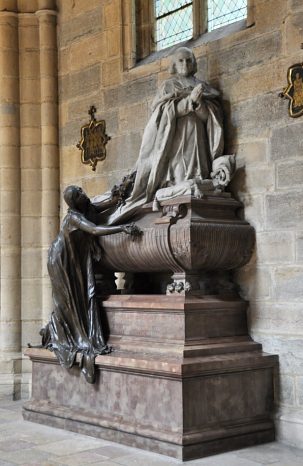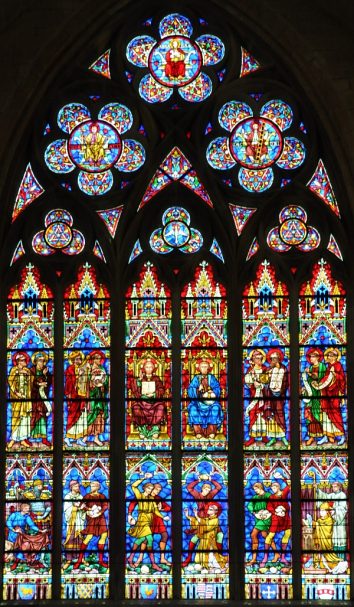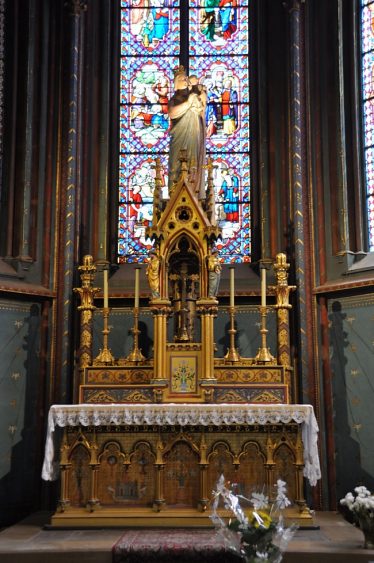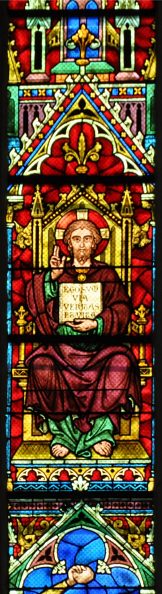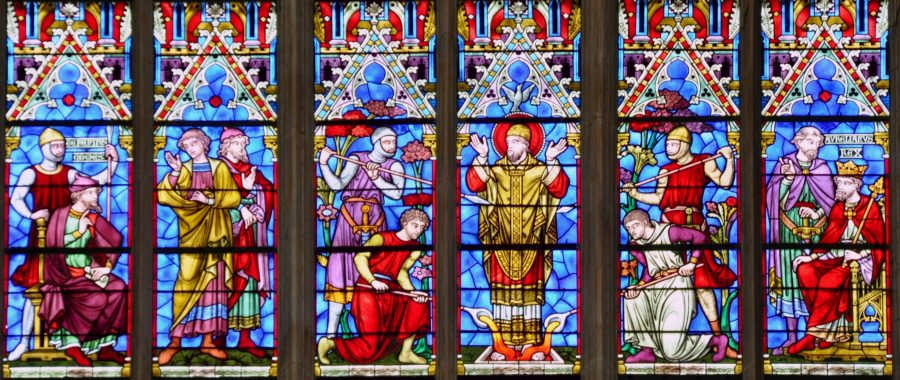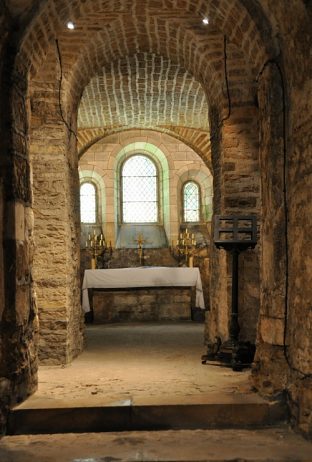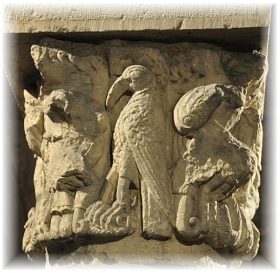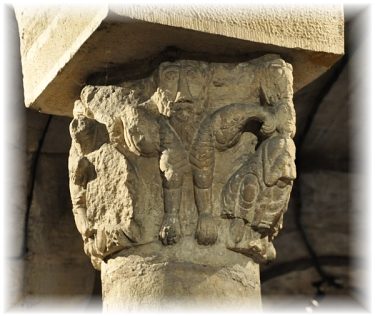|
|
 |
 |
Une première basilique, dédiée
à saint Bénigne (martyrisé vers la fin du IIe
siècle), est construite au VIe siècle sous l'autorité
de saint Grégoire. Délabrée et insuffisante
pour l'afflux des pélerins venus se recueillir sur la tombe
du martyr, l'évêque Isaac fit bâtir une basilique
carolingienne plus vaste (vers 870), tout en imposant aux moines
de l'abbaye la règle austère de saint Benoît.
Au début du XIe siècle, l'italien Guillaume de Volpiano
est nommé abbé de Saint-Bénigne. Il s'engage
dans la construction d'une troisième basilique dite «lombarde»
(car inspirée des églises de Lombardie).
Après l'incendie de 1137 qui détruisit presque toute
la ville, le nouvel abbé, Pierre de Genêve, fait rebâtir
la partie de la basilique qui a le plus souffert en église
romane. Église que le destin frappa en 1271 quand une tour
s'écroula sur elle. On réussit en quelques années
à recueillir les fonds nécessaires à l'édification
d'une basilique gothique. Le chœur fut construit entre 1280
et 1287, le reste achevé en un demi-siècle. Mais l'état
du bâtiment se dégrade dangereusement par manque d'entretien.
Coup supplémentaire : les pillages de la Révolution
la vident complètement (hormis l'orgue du XVIIIe). En 1819,
une commission en recommande même la destruction. Malgré
tout, des travaux de restauration s'engagent en 1830. Suivis d'une
nouvelle campagne en 1884 sous la responsabilité de Charles
Suisse. Depuis 2003, avec la création d'un nouvel archevêché
(région de Bourgogne), Saint-Bénigne est devenue cathédrale
métropolitaine.
|
|

Vue générale de la nef et du chœur. |
|
Architecture.
La première chose qui frappe le visiteur qui rentre
dans la cathédrale Saint-Bénigne est la différence
de couleur entre la nef et le chœur. Les sources indiquent
que, au Moyen Âge, la pierre du chœur était
ocre. Aussi, lors de la dernière restauration (1988-1995),
a-t-on essayé de reconstituer cette couleur.
Le chœur se caractérise par de grandes colonnes
qui montent sans interruption jusqu'à la voûte,
assurant un effet d'élancement vers le ciel assez réussi.
Le chœur, comme la nef, possède trois niveaux
d'élévation : fenêtres basses, triforium
et fenêtres hautes. Le triforium est partout encadré,
en haut et en bas, par un bandeau mince en forte saillie qui
coupe l'élancement des élévations. Les
colonnes du sanctuaire - d'une seul tenant - et leur effet
ascensionnel n'en ressortent que plus fortement.
|
On observe dans le
chœur un large parement entre le triforium et les fenêtres
hautes : c'est une particularité de Saint-Bénigne.
La nef, avec sa pierre en couleur naturelle, est de style
gothique bourguignon. Une des spécificités du
style dit «bourguignon» est le passage situé
au-dessus du triforium à la base des fenêtres
hautes. On s'en aperçoit mieux sur la photo de la nef
vue de biais ci-dessous. Les piliers qui soutiennent les
grandes arcades sont coupés de manière assez
heureuse par un tailloir qui reçoit une statue d'Apôtre.
Enfin, un détail que l'on voit aisément sur
la photo du haut : la cathédrale Saint-Bénigne
est inondée de lumière car la verrière
des fenêtres hautes est en verre blanc.
Saint-Bénigne est cathédrale métropolitaine
(archevêché), mais ses dimensions sont assez
modestes : 68 mètres de long, 29 de large et 26 mètres
de hauteur sous la voûte.
|
|

La façade très sobre de la cathédrale vue depuis
la rue Mariotte à Dijon
La flèche, refaite au XIXe, culmine à 93 mètres.
Depuis le faîte du toit, elle fait 55 mètres.
|

Les statues à la base de la flèche (XIXe siècle) |
| |

Statue sur le portail ouest (XIXe siècle) |

Statue à la base de la flèche (XIXe siècle) |

Tympan du portail ouest : «La Lapidation de saint Étienne»
par Edme Bouchardon (1698-1762). |
|

Le porche de la façade ouest a été restauré
au XIXe siècle.

|
Sur le portail ouest, le
tympan initial a été détruit
en 1794. En 1813, on le remplace par un bas-relief représentant
la lapidation de saint Étienne, œuvre d'Edme
Bouchardon (1698-1762), provenant de l'ancienne église
Saint-Étienne de Dijon (l'actuelle chambre de commerce).
Pour être intégré dans la surface disponible,
le bas-relief a été réaménagé
et complété.
|
|

Élévations de style gothique bourguignon dans
la nef. Les grandes verrières du troisième niveau
inondent la cathédrale de lumière.

Les piliers de la nef sont ornés des bustes des Apôtres
---»»» |

«La Pentecôte» d'après Giorgio Vasari
Ce tableau, suspendu près de la chapelle du Saint-Sacrement,
pourrait être une copie du XVIIe siècle. |

Vitrail central de l'abside
Œuvre d'Édouard-Amédée Didron
Les vitraux de l'abside illustrent les saints bourguignons,
Cliquez sur le vitrail.
Ici, (rangée du bas), de gauche à droite :
saint Andoche, saint Bénigne et saint Thyrse
Rangée du haut : la Vierge, le Christ et saint Jean |
|
Les tableaux
que l'on peut admirer dans la cathédrale Saint-Bénigne
sont, pour l'essentiel de saisies révolutionnaires,
c'est-à-dire qu'ils proviennent des églises
et des couvents voisins. Ils datent tous des XVIIe,
XVIIIe et XIXe siècles. Beaucoup sont des copies
réalisées par des grands noms de la peinture.
|
|
|

Dans la nef :
Buste de saint Pierre en pierre d'Asnières
Œuvre de Jean Dubois (1625-1694) |

Dans la nef :
Buste de saint Jean en pierre d'Asnières
Œuvre de Jean Dubois (1625-1694). |

Clé de voûte dans un bas-côté |

Clé de voûte dans un bas-côté |
|

Le bas-côté nord. Au centre, le tombeau de Mgr Rivet, Au fond, la
chapelle du Saint-Sacrement (XIXe siècle)
À DROITE ---»»»
Tombeau de Monseigneur Rivet, évêque de Dijon de 1838 à 1884
Il a été érigé en 1900 sur un carton de
Charles Suisse, directeur des travaux de restauration au XIXe siècle |
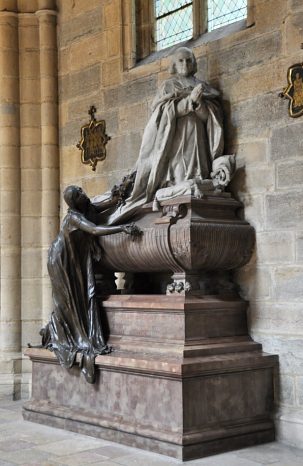
|
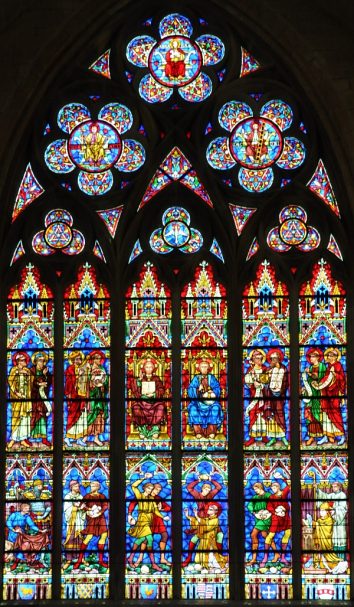
|

Bras nord du transept avec ses statues (saint Jean l'Évangéliste
et saint André) que surplombent des tableaux (copies) de
«La Déposition de croix» d'après Jouvenet
et du «Mariage de la Vierge»
«««--- Vue d'ensemble du vitrail du transept sud,
œuvre du maître verrier parisien Édouard Didron
(Le Martyre de saint Étienne) |

Tableau dans le sanctuaire
«L'Ascension»
attribué à Jean-François Barnou
(seconde moitié du XVIIIe siècle) |
 |
 |
 |
CI-DESSUS Tombeau de Jean
de Berbisey, baron de Vantoux
et président au Parlement de Bourgogne, mort en 1697.
De part et d'autre, statue de la Religion et de la Justice.
Le tombeau provient de la chapelle des Carmes |
| «««---
À GAUCHE, Clé de voûte dans un bas-côté |
À DROITE ---»»»
Tableau «La Transfiguration» attribuée à Benoît
Dubois, 17e siècle
Le dessin s'inspire du tableau de Raphaël.
Cette huile sur toile provient de l'église des Cordeliers. |
|

La nef, le bas-côté sud et le chœur
Dans le chœur, on notera le large «parement» entre
le triforium et les grandes verrières. C'est une particularité
de Saint-Bénigne.
|

La chaire à prêcher (style Louis XIV) a été
mise en place en 1897 |

Tableau «Le Repas chez Simon», d'après Jean-Baptiste Jouvenet
Copie de Franz-Anton Krauze, 1736 |
|

La cuve de la chaire à prêcher (fin XIXe siècle) |

Le sanctuaire de la cathédrale Saint-Bénigne |

Vitrail du XIXe siècle dans l'abside (mis en place en 1894)
Il illustre le culte de saint Bénigne (apparition, translation
du
sarcophage, construction de l'église). Œuvre d'Édouard
Didron. |

Bas-relief en bronze doré du maître-autel
Œuvre de Claude-François Attiret (1728-1804)
Le thème en est la Mise au tombeau. |

Chapelle de la Vierge
Elle a été restaurée entre 1868 et 1872 et, à
nouveau, en 1990.
A gauche, il y a deux décors en trompe l'œil (on en un
sur les deux). Ils datent de 1994.
Cliquez sur les vitraux pour les afficher en gros plan. |

Le retable en pierre calcaire
de la chapelle du Saint-Sacrement (XIXe siècle)
Voir d'autres vitraux de Didron en grisaille à l'église
Saint-Louis
d'Antin à Paris |
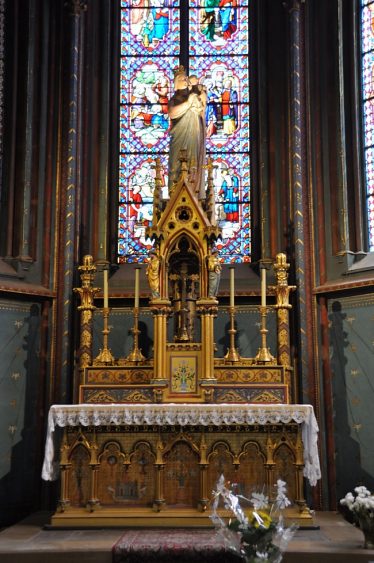
Le retable de la
Chapelle de la Vierge (XIXe siècle)
L'autel et la statue de la Vierge sont dus à Jacques-Ange Corbelle,
sculpteur parisien.
|

Tableau visible près de la chapelle de la Vierge :
«L'Annonciation» de Martin de Vos (1532-1603), peintre d'Anvers.
Hormis le spectacle presque bucolique des angelots qui accompagnent
la colombe du Saint-Esprit,
on note la présence amusante d'un chat qui assiste placidement
à la scène.
La présence de ce chat est typique des écoles du nord. |

Les fonts baptismaux
Ils s'inscrivent dans le réaménagement de l'église
au XIXe siècle
La cuve est due au ciseau de Xavier Schanosky (1867-1915) |

L'ange suspendu des fonts baptismaux (XIXe siècle)
Il a été fondu d'après un modèle de Paul
Gasq (1860-1944) |

Statue de saint Étienne dans le bas-côté sud
Œuvre de Jean Dubois (1625-1694) |

Priant de Marguerite Brulart, épouse de J.B. Legoux
Œuvre de Guillaume Berthelot (1576 ou 1580 - 1648)
Le priant vient de l'église des Cordeliers |

Tableau «Le Mariage mystique de Sainte Catherine de Sienne»
par le peintre dijonnais Philippe Quantin (c. 1600-1636)
Quantin est un des représentants du caravagisme en Bourgogne.
Ce tableau provient du couvent des Jacobins. |

Priant de J.B. Legoux, seigneur de la Berchère et premier
président du Parlement de Bourgogne, décédé
en 1631.
Œuvre de Guillaume Berthelot (1576 ou 1580 - 1648)
Le priant vient de l'église des Cordeliers |

«La Présentation au temple» |

CI-DESSUS, Tableau dans le
croisillon nord du transept :
«Le Mariage de la Vierge» copie ancienne d'après Gerhard Seghers |
À DROITE, Vitrail
dans le transept sud ---»»»
Le Christ (œuvre d'Édouard-Amédée
Didron) |
|
«««--- À GAUCHE,
Tableau «La Présentation au temple»
C'est une copie inversée d'un tableau de Jouvenet (1644-1717),
exécutée par Franz-Anton Krauze (1705-1752)
|
|
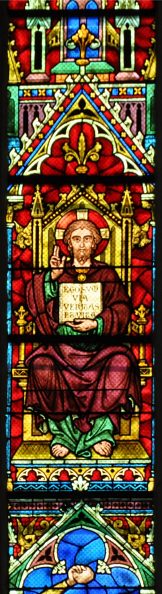
|
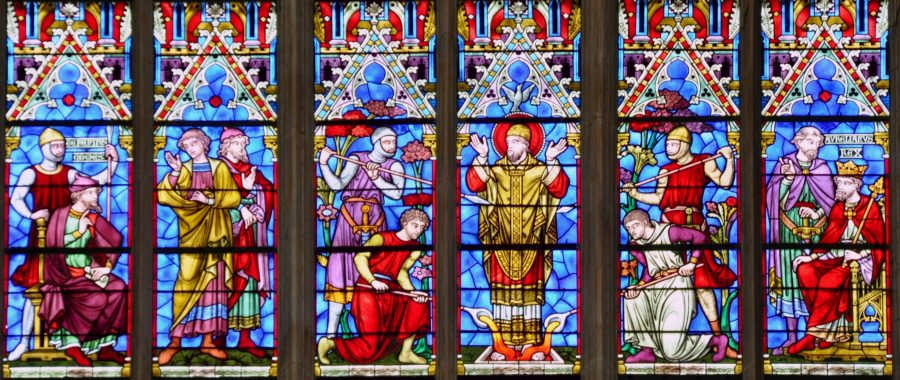
Vitrail dans le transept nord : Le martyre de saint Bénigne
Œuvre du maître verrier parisien Édouard-Amédée
Didron (fin du XIXe siècle) |
|
Saint
Bénigne. Bénigne vient du latin Benignus
: «le Bien bon». Selon la tradition, Bénigne
est venu en Gaule depuis Smyrne, envoyé par Polycarpe,
lui-même disciple de saint Jean l'Évangéliste.
Après Autin, il passe à Dijon, puis à
Langres. En revenant vers Dijon, il est arrêté,
conduit devant le gouverneur Térence en poste à
Dijon et est supplicié («subit le martyre»
disent les érudits). Ces faits se situent vers la fin
du deuxième siècle et le début du troisième.
La raison de sa mise à mort est tout à fait
simple : en repoussant le culte des dieux tutélaires
et celui de l'empereur de Rome (gage de stabilité de
la société), son attitude risquait d'ébranler
le corps social. Sous l'Empire romain, le refus de se soumettre
et de faire allégeance à l'empereur était
puni de mort. C'est pour la même raison que, aux temps
médiévaux du christianisme triomphant, ceux
qui osaient dévier de la foi officielle et remettaient
en cause le dogme étaient brûlés vifs.
Leur comportement d'opposition et de refus menaçait
l'ordre social.
Dans le vitrail ci-dessus, on voit deux bourreaux verser du
métal en fusion sur les pieds de Bénigne. La
tradition rapporte les termes du supplice. Bénigne
fut percé
|
de deux lances à
travers le corps ; on lui enfonça des poinçons
sous les ongles ; une barre de fer lui fracassa la tête.
L'histoire ne dit pas s'il était insensible à
la douleur... comme saint Crépin et saint Crépinien,
savamment martyrisés par l'empereur et le préfet,
dans un vitrail de l'église Saint-Pierre
de Dreux.
Bénigne fut enterré à Dijon dans un sarcophage
discret à une époque où les persécutions
allaient redoubler. Saint Grégoire, évêque
de Langres (506-539), vint bientôt s'établir
à Dijon, ville plus sûre. Il mit en doute les
prétendus miracles qui se produisaient sur la tombe
du martyr, mais finalement se laissa convaincre. On dégagea
le sarcophage et une petite crypte fut bâtie, en 511,
pour l'abriter. S'ensuivit la construction d'une basilique
dédiée à saint Bénigne, devenue
bientôt trop petite pour l'afflux des pèlerins.
On construisit alors un oratoire, puis une deuxième
basilique dite carolingienne (vers 870) qui bénéficia
des largesses de Charles le Chauve. Vers 877, celle-ci était
achevée.
Source : «Cathédrale
Saint-Bénigne de Dijon» édité
par la paroisse Saint-Bénigne
|
|
| LE GRAND ORGUE DU XVIIIe SIÈCLE |
|

Le grand orgue du XVIIIe siècle frappe le visiteur par son
ampleur |
|
Le
grand orgue de Saint-Bénigne. Les premiers
orgues de l'église se trouvaient sur le jubé.
En 1740, les moines bénédictins décident
d'installer un orgue dans la nef ; ils firent donc construire
une tribune (on en voit la partie supérieure dans la
photo ci-dessus : un bas-relief du roi David jouant de la
harpe à gauche, sainte Cécile à droite).
Simultanément, la construction de l'orgue est confiée,
en 1740, au facteur Karl-Joseph Riepp (1710-1775) et à
son frère Rupert. Le tout sera mis en valeur par un
somptueux buffet commandé aux menuisiers et sculpteurs
dijonnais Edme et Guillaume Marlet. Les cariatides (ou atlantes),
les panneaux ornés d'attributs musicaux, les angelots
qui dansent, les anges qui soufflent dans les trompettes,
associés à des dimensions plus que respectables
donnent à ce meuble en chêne, de style Louis
XV, une stature et une vigueur que l'on voit rarement dans
une église. À sa création, c'était
l'instrument le plus imposant que l'on pouvait admirer en
province.
En 1788, les goûts musicaux avaient changé. On
modifia donc l'orgue. La tâche fut confiée à
Jean Richard de Troyes. Vint la Révolution et ses exigences
ubuesques :
|
les patriotes de la
section de Saint-Philibert exigèrent le métal
de l'instrument (sans doute pour le fondre). Dominique Parin,
titulaire de l'instrument, réussit à le sauver
en s'engageant à jouer des airs patriotiques pour le
peuple.
La tourmente une fois passée, c'est en 1846-47 qu'eut
lieu la première restauration du XIXe siècle.
L'orgue est transformé en instrument romantique. En
1860, avec Joseph Merklin, l'aspect symphonique est accentué.
Enfin, en 1953, c'est la maison Roethinger de Strasbourg qui
harmonise le grand orgue de Saint-Bénigne dans le style
néo-classique. Marcel Dupré inaugure le nouvel
instrument en 1955. En 1987, une nouvelle reconstruction de
l'orgue est confiée au facteur allemand Gerhard Schmid
de Kaufbeuren. Il aura désormais 6000 tuyaux, 73 jeux
et cinq claviers. L'inauguration a lieu en mars 1996.
Si vous n'avez pas l'habitude d'entrer dans une église,
faites une exception pour Saint-Bénigne à Dijon,
rien que pour admirer cet orgue imposant.
Source : «Cathédrale
Saint-Bénigne de Dijon» édité
par la paroisse Saint-Bénigne
|
|

|

Angelot se dandinant sur le buffet d'orgue
«««--- Les atlantes qui soutiennent l'orgue ---»»» |

|

Ange souffleur de trompette sur une tourelle au centre du buffet |

Angelots au sommet de la tourelle droite |
|
|

La rotonde |

Le sarcophage de saint Bénigne |
|
La
crypte. Il ne faut pas manquer la crypte de la
cathédrale Saint-Bénigne. Malgré des
travaux intempestifs au XIXe siècle (vilipendés
par Proper Mérimée), elle a su garder un cachet
roman assez intimiste. Construite avec la troisième
abbatiale (dont les travaux démarrent en 1001), la
crypte se compose principalement d'une rotonde, dite «chapelle
Saint-Jean-Baptiste», soutenue par des colonnes rondes
ornées de chapiteaux qui ne sont pas d'origine, mais
du réemploi (photo ci-dessus). À l'origine,
cet endroit était éclairé par des fenêtres
latérales (bouchées au cours des siècles
par des remblais). La rotonde servait de lieu de circulation
aux nombreux pélerins venus se recueillir devant le
tombeau de saint Bénigne. Celui-ci (ou ce qu'il en
reste) est accessible tout près.
|
En 1137, une partie
de la ville de Dijon est détruite par un incendie.
La charpente de l'église n'y résiste pas. Elle
est reconstruite tout comme une partie de la rotonde. Enfin,
en 1270, la tour qui domine l'église s'écroule
sur l'édifice (sans dommage pour la crype). À
la suite de quoi, une église gothique prend la place
de l'église romane.
En 1789, les révolutionnaires cassent en partie la
crypte qui, finalement, se trouve comblée et finit
par sortir des mémoires. Enfin, en 1843, lors du creusement
de la fosse d'un paratonnerre, on en met à jour les
premiers vestiges. Le XIXe siècle va non seulement
restaurer cette très belle crypte du XIe siècle,
mais aussi la reconstruire, éliminant par là
des vestiges millénaires (voir les réflexions
de Mérimée plus bas).
Source : «Cathédrale
Saint-Bénigne de Dijon» édité
par la paroisse Saint-Bénigne
|
|
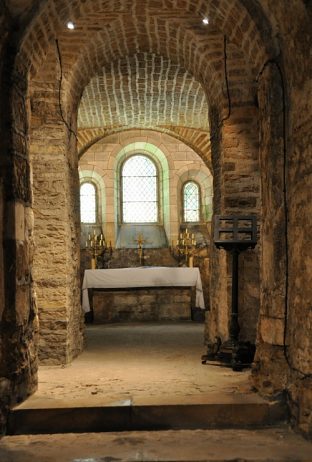
Chapelle mortuaire
Cette chapelle dans la crypte date probablement du VIe siècle.
Elle a été «reconstruite» au XIXe siècle.
Le chapiteaux présentés sont postérieurs à
la construction
de la chapelle Saint-Jean-Baptiste (avant l'an 1000).
Ils sont dits de «réemploi». |

Chapiteau avec bonhomme aux yeux exorbités. |
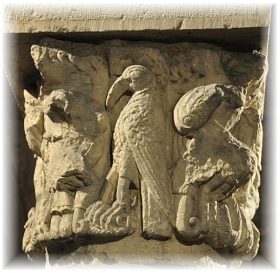
Chapiteau avec oiseau. |

Chapiteau avec animaux monstrueux |

Chapiteau avec «guerrier» ou animaux monstrueux |

|

Chapiteau avec monstre ailé
«««--- À GAUCHE, Crypte et petit autel |
|
En 1846, Prosper
Mérimée passe à Dijon et inspecte
les travaux dans la crypte de Saint-Bénigne. La restauration
de la crypte créa un violent conflit entre la commission
des Monuments historiques et la commission des Antiquités
de la Côte d'Or. Les Monuments historiques avaient accordé
3 000 francs pour la crypte et Mérimée
estime qu'elle s'est fait flouer. ll se confie à Ludovic
Vitet, le président de la commission des Monuments
historiques : «Croyez que nous avons été
indignement et complètement mystifiés. La société
archéologique de Dijon après avoir fait la découverte
et obtenu quelques fonds pour la suivre, a remis ses pouvoirs
et ses dossiers à un Mr Petit, architecte du département
qui, me dit-on, n'a voulu en faire qu'à sa tête
et a tout construit sans prendre conseil de personne. C'est
dans un jardin appartenant à l'évêché
que l'on a trouvé l'entrée de cette crypte.
L'architecte désirant conserver le jardin, faisait
étayer à mesure qu'il creusait. Puis il a fait
faire des voûtes bien solides, ma foi, puis des murs
latéraux, des colonnes et des chapiteaux, le tout bien
entendu avec notre argent. L'histoire de Bourgogne de Dom
Planchais où je trouve un plan de cette crypte lui
servait à cette restauration ou plutôt à
cette reconstruction. En descendant dans la crypte par un
magnifique soupirail avec une margelle de puits, où
la pierre de taille n'est pas épargnée, je n'ai
|
trouvé que
des murs neufs (...).
« Mr Petit, qui a fait nombre d'énormités
analogues a été congédié par le
Préfet il y a quelques temps. Mais la société
archéologique qui l'a laissé faire sans nous
avertir, subsiste encore, et lui trouvera un digne successeur,
je n'en doute pas (...).
«J'ai fait grand bruit comme vous pouvez penser, de
la dilapidation de notre argent. Mais il n'y a plus de coupable.
On rejette le crime sur Mr Petit qui a fait un trou à
la lune. Chacun des membres de la commission archéologique
l'avait averti, et pas un seul ne s'était avisé
de nous écrire à ce sujet.»
Prosper Mérimée termine ses réflexions
sur Saint-Bénigne en étalant son courroux contre
les mauvais architectes restaurateurs : «Ma conclusion
est que nous sommes volés par la province, qu'il ne
faut plus nous fier à ses archéologues ni à
ses architectes, qu'il faut diviser la France entre Questel,
Leduc et Bœswillwald et les charger de toutes nos affaires
petites ou grandes.»
Source : «La naissance
des Monuments historiques, la correspondance de Prosper Mérimée
avec Ludovic Vitet (1840-1848)», Éditions
du Comité des travaux historiques et scientifiques,
Ministère de l'Éducation nationale.
|
|
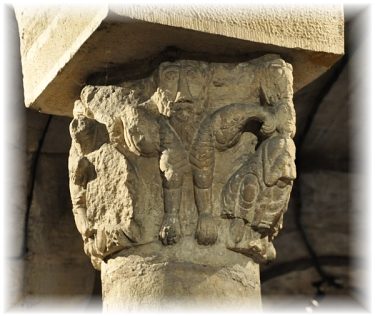
Chapiteau avec monstre |

La rotonde avec vue sur l'emplacement du sarcophage |

Vue de la nef et du grand orgue depuis la croisée du transept |
Documentation : «Cathédrale Saint-Bénigne
de Dijon» édité par la paroisse Saint-Bénigne
+ panneaux affichés dans la cathédrale |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|