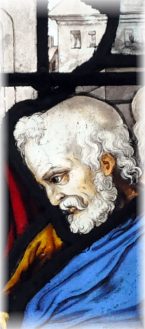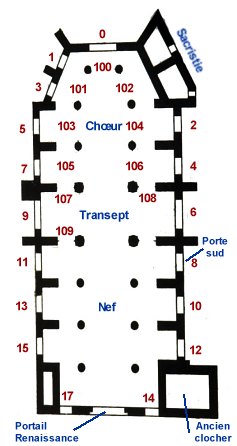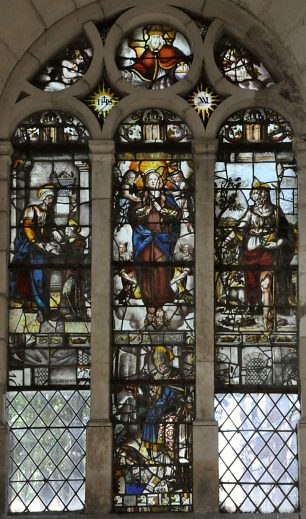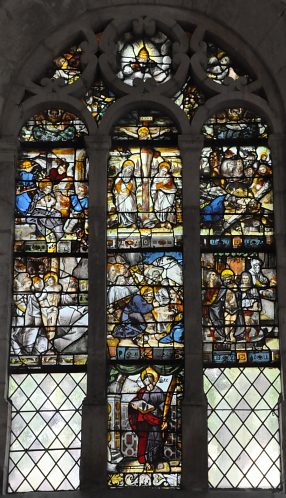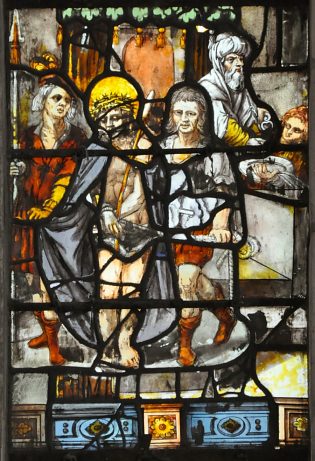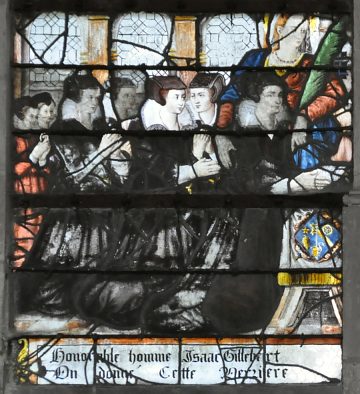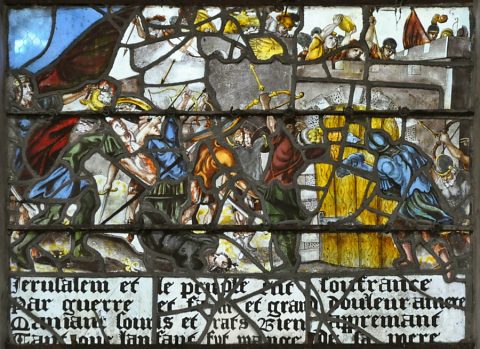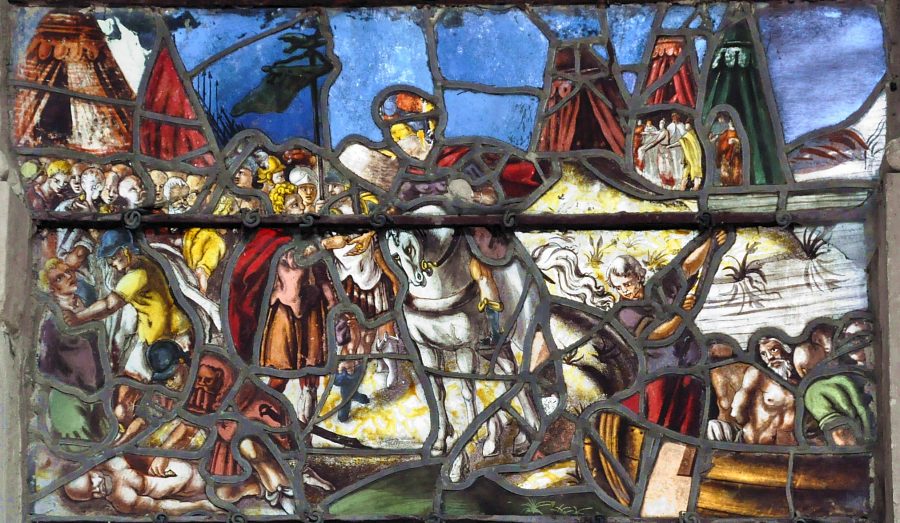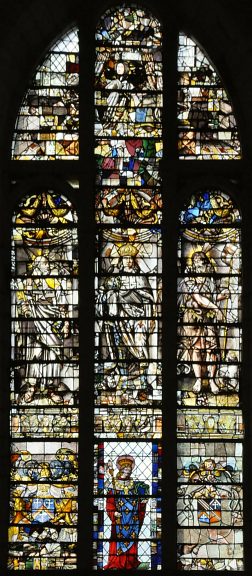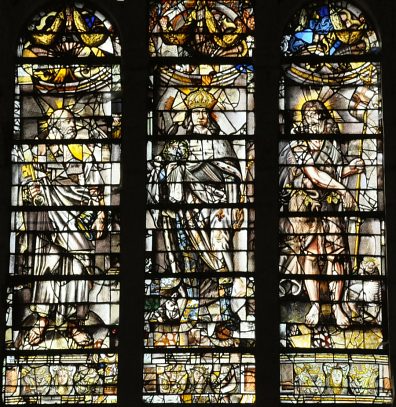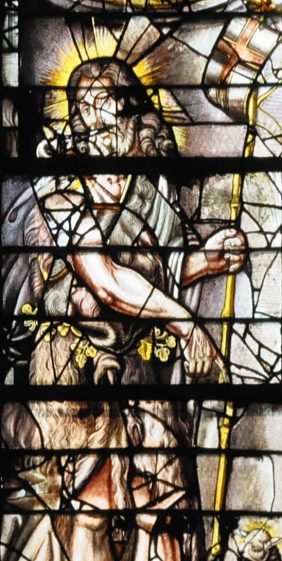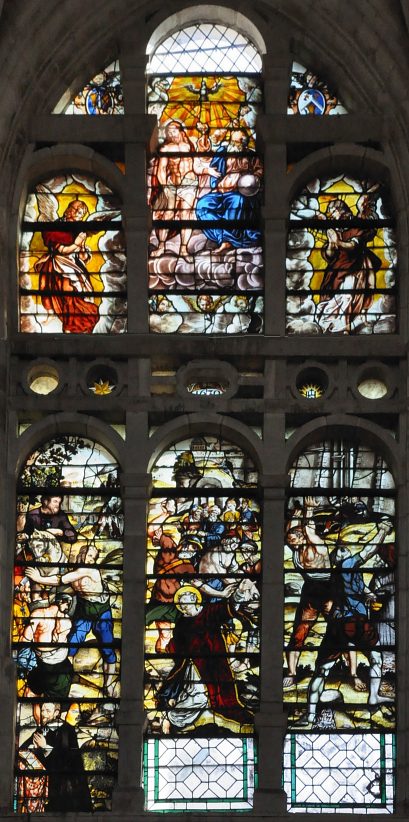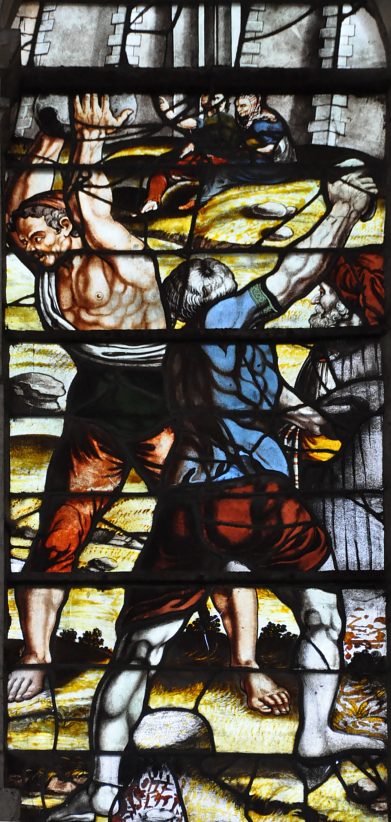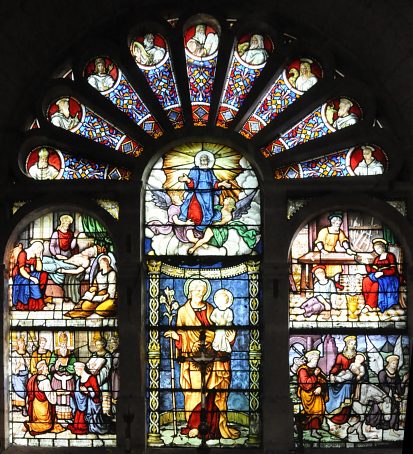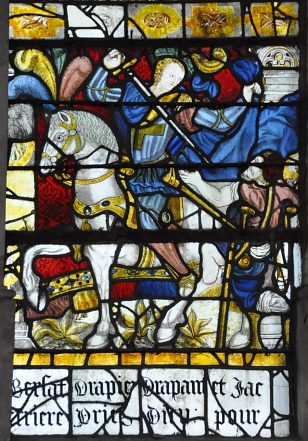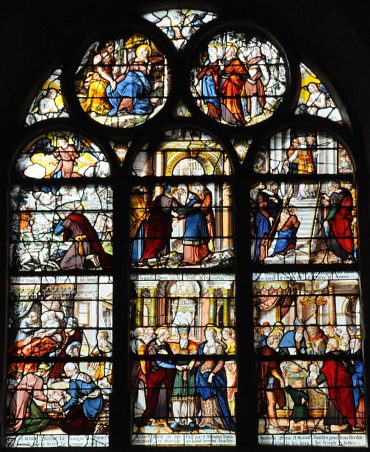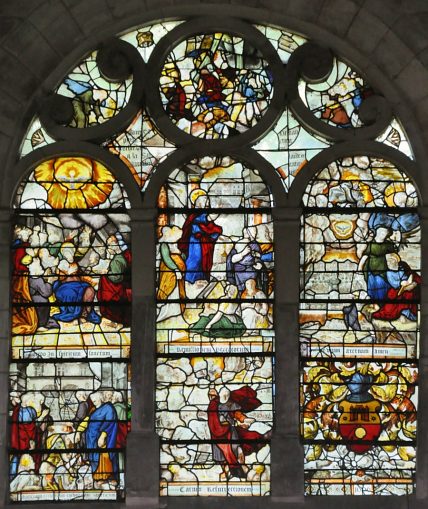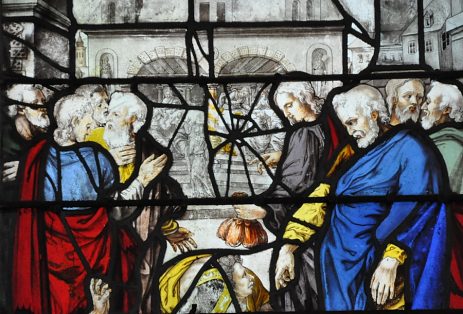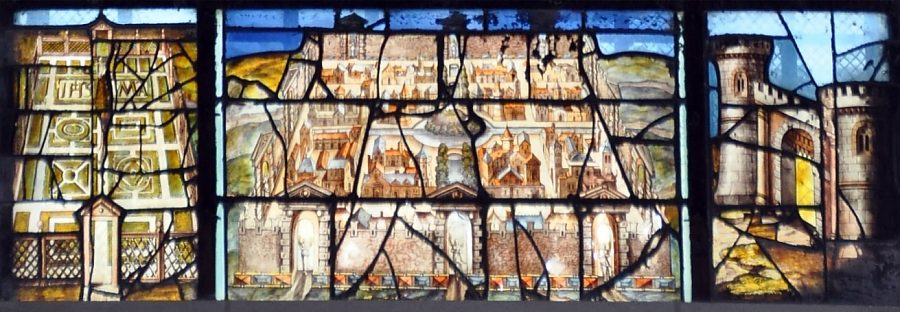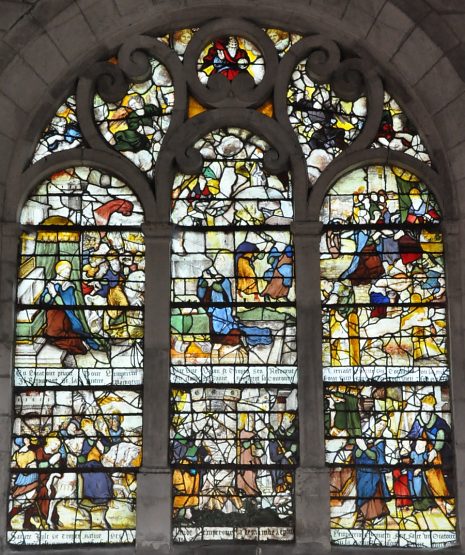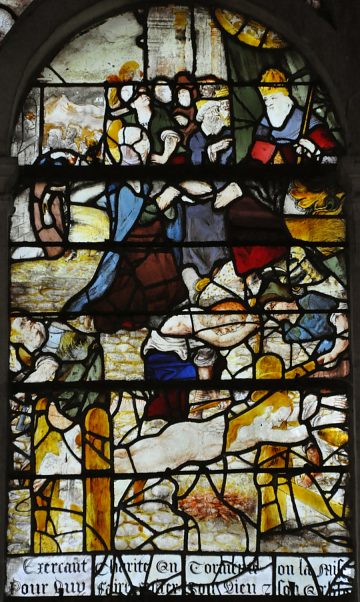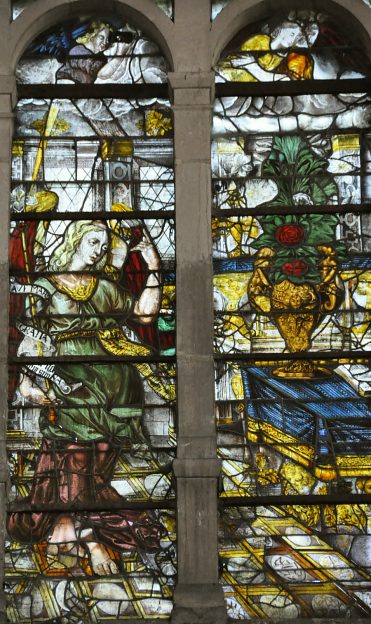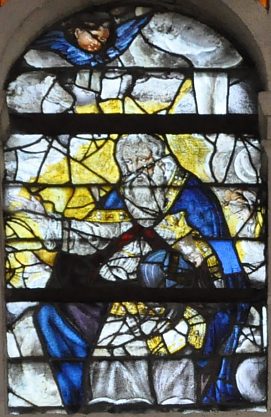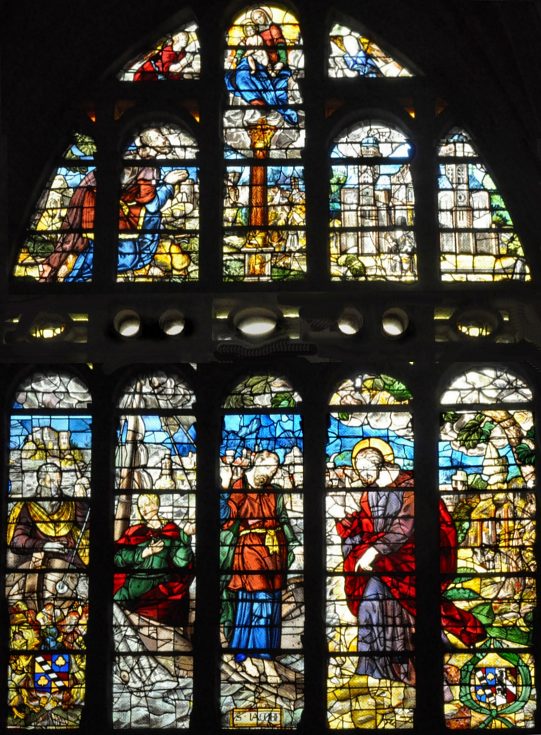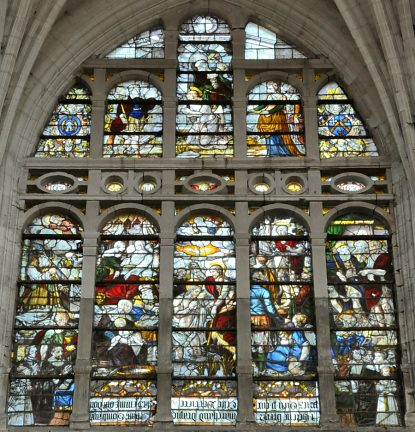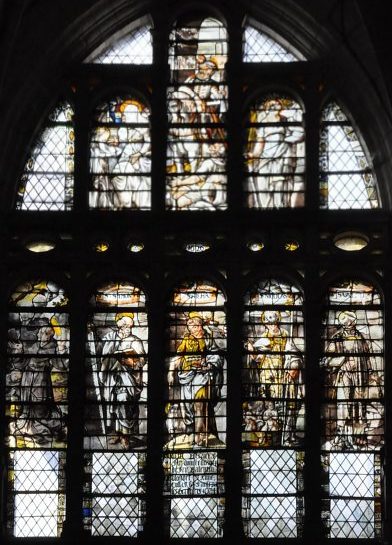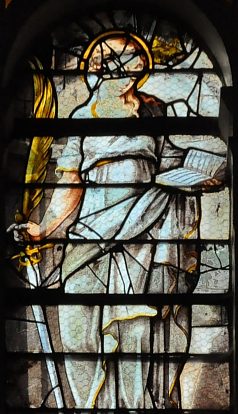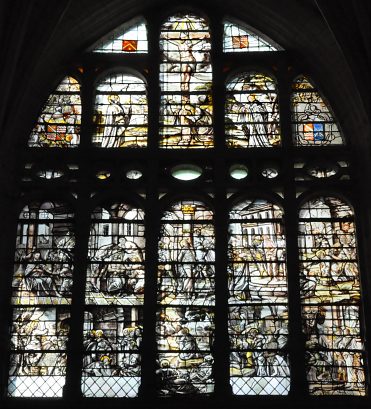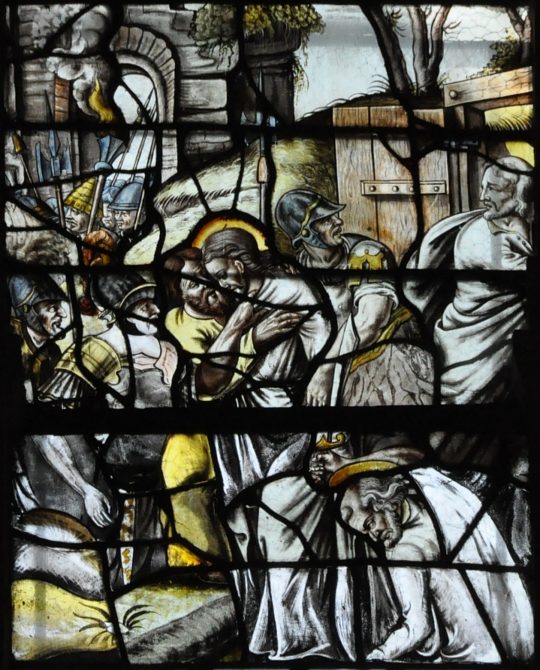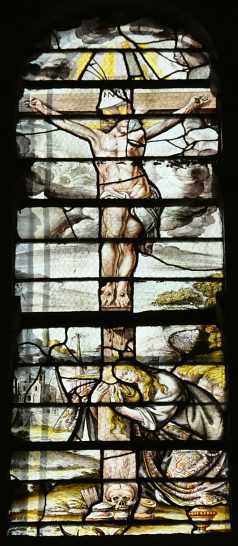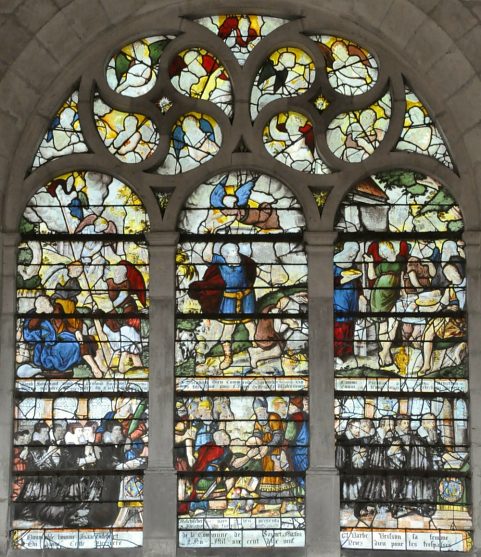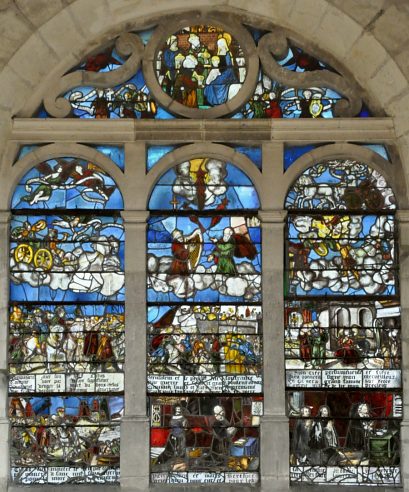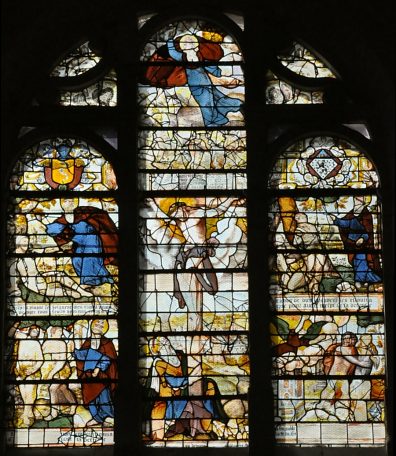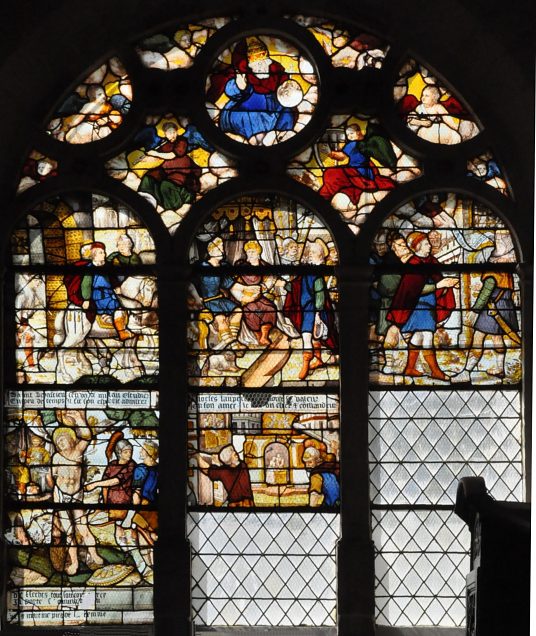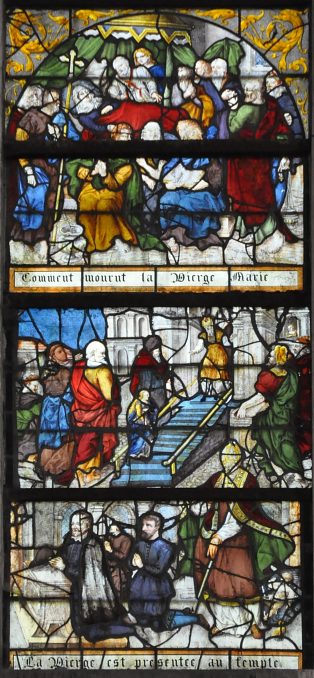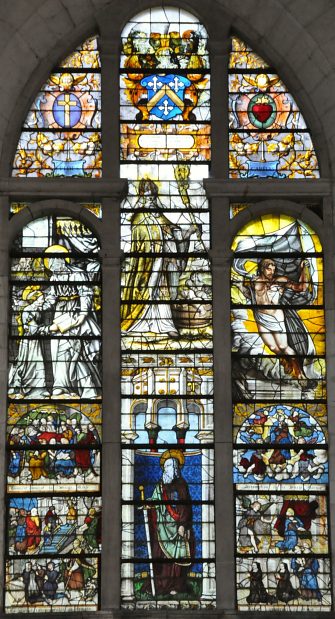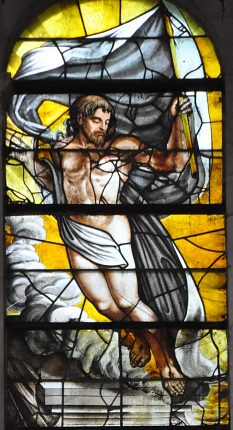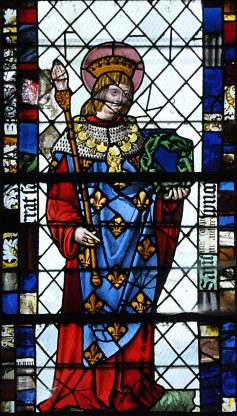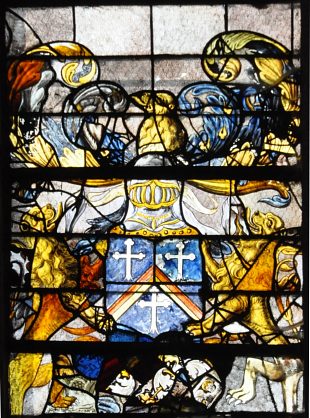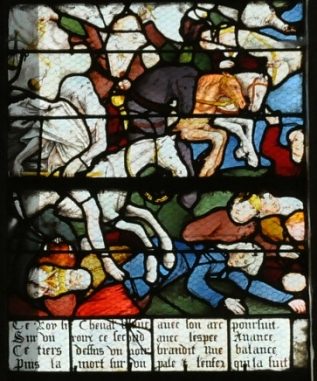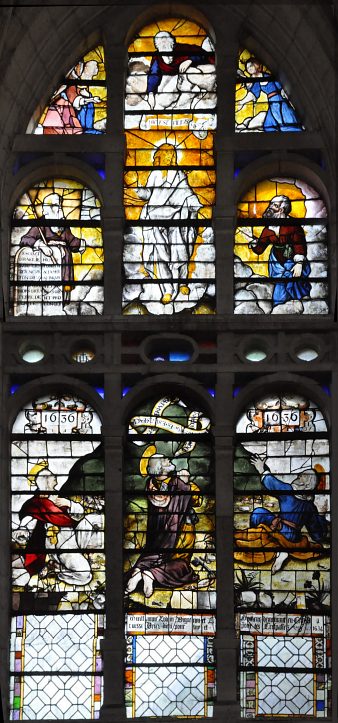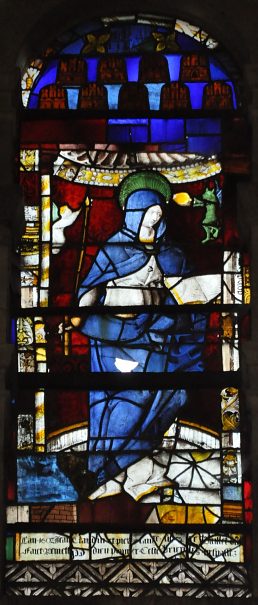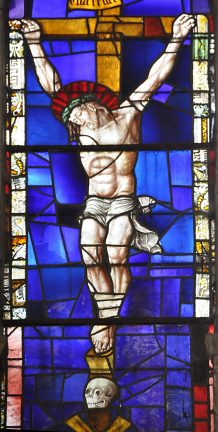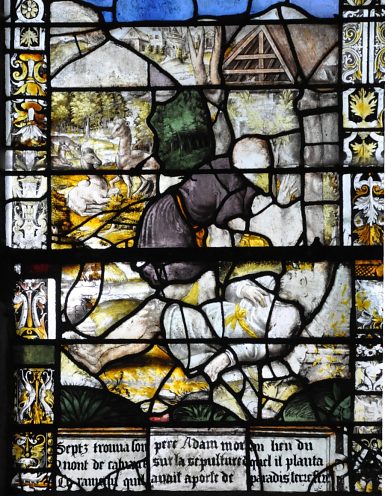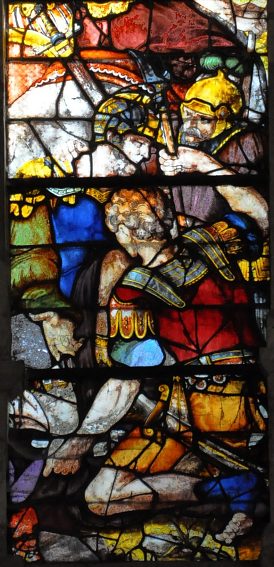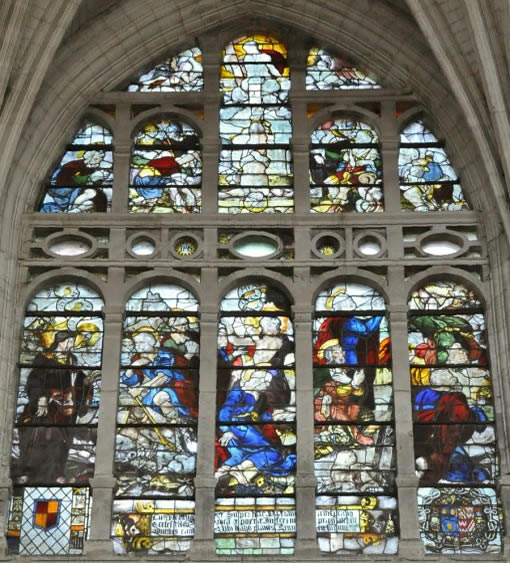|
|
 |
 |
En 1584, au cours des guerres de Religion,
la Ligue prit possession de Troyes.
À l'époque, l'église Saint-Martin s'étendait à l'extérieur de la
ville, au nord-ouest. En avril 1590, redoutant une attaque des partisans
d'Henri IV, la municipalité décida de faire raser tous les bâtiments
pouvant servir de points d'appui à une attaque extérieure. Une partie
des faubourgs de Troyes
fut donc détruite. Tout comme l'église malgré l'opposition des marguilliers.
Néanmoins, on en démonta soigneusement les vitraux, les gargouilles
et la cloche pour les réemployer dans un futur édifice cultuel à
bâtir.
Cette construction commence en 1593 et va s'accélérer en 1594 quand
Troyes
reconnaît Henri IV comme roi de France. «En 1597, l'abside, le sanctuaire
et une partie du chœur
sont probablement terminés», lit-on dans l'historique de l'édifice
proposé en 1959 par Françoise Bibolet, archiviste-paléographe. Le
transept est terminé
en 1611. Sur l'élévation sud de l'église, la porte,
de style Renaissance, est ornée de la date de 1610. Les piliers
du chœur sont achevés
en 1619.
Peu après, les travaux s'arrêtent et on se met à rebâtir ce qui
existe déjà : il est vraisemblable que la nef
et le transept
ont été agrandis.
La nef est construite avant 1641, mais elle est encore revêtue d'une
charpente en bois, tout comme les bas-côtés.
Après avoir consolidé quelques piliers en prévision de la couverture
de pierre, un marché est passé en 1641 pour la construction des
voûtes ogivales. Par décision des marguilliers, celles qui doivent
couvrir les deux premières travées de la nef attendront l'achèvement
du portail ouest. Dans les faits, l'an 1689. La construction des
voûtes se sera donc étalée sur cinquante ans. La sacristie, bâtie
à l'est, date de 1709 ; l'ancien clocher près de la façade (voir
plan), est de 1747.
On pourra dater du XIXe siècle, mais sans certitude, le clocher
actuel qui s'élève à la croisée du transept.
En 1856, Saint-Martin-ès-Vignes devient paroisse de Troyes.
Le bâtiment, les vitraux ainsi que la plupart des statues et des
tableaux sont classés monuments historiques.
L'édifice offre des éléments artistiques de trois époques : art
gothique, Renaissance et art classique. L'essentiel de sa richesse,
cependant, repose dans ses magnifiques vitraux
émaillés des XVIe et XVIIe siècles, dont une série a été créée par
l'atelier des Gontier et sa maîtrise de la technique nouvelle de
l'émaillerie
sur verre.
Les amateurs de vitraux ne sont malheureusement pas gâtés : l'église
n'est ouverte que le dimanche matin pour l'office.
|
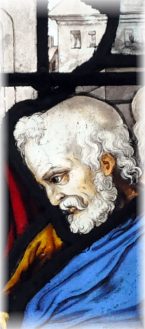 |

La nef de l'église Saint-Martin-ès-Vignes, au nord de Troyes.
La longueur de l'église est de 52,50 mètres.
La voûte de la nef, du chœur et du transept culmine à 15 mètres de
haut. |
| ARCHITECTURE EXTÉRIEURE
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |
|

La façade occidentale de Saint-Martin cachée par les arbres. |

Le portail méridional, terminé en 1610, est encadré de deux
colonnes corinthiennes. |

Fenêtres à remplage Renaissance sur le côté nord. |
|

Le chevet de l'église et ses imposants contreforts très dépouillés. |
|
Architecture extérieure.
La façade de l'église, datée de 1681, est de style classique.
Le portail en plein cintre est surmonté d'un péristyle
à six colonnes corinthiennes. Le commentaire du Guide
archéologique du Congrès de Troyes et de Provins de
1902 écrit que, sur les dessins du chanoine Louis
Maillet, ce portail «est une malheureuse imitation du
portique du temple de Jupiter-Stator».
En fait, la façade est déséquilibrée car elle n'a pas
été terminée. Louis Maillet avait prévu de la prolonger
au nord et au sud par des murs en contre-courbe s'appuyant
sur les bas-côtés.
Depuis la route, le visiteur pourra s'arrêter devant
le portail méridional de style Renaissance, donné ci-contre.
Son fronton échancré est soutenu par deux colonnes corinthiennes.
L'intrados
de l'entablement est sculpté de motifs qui rappellent
ceux qui ornent la
base des grandes fenêtres à l'intérieur de l'édifice.
Autrefois, la porte en plein cintre était surmontée
d'une statue en bois de sainte Jule.
Si le côté sud de l'église, bordant la route, est vierge
de toute végétation, toute l'élévation du côté nord,
en revanche, est rendue inaccessible par un mur délimitant
une propriété privée. De plus, en été, de grands arbres
cachent la vue. Au nord comme au sud, on pourra remarquer
des fenêtres au remplage Renaissance.
Sur le chevet de l'église s'élèvent d'imposants contreforts
dont le dépouillement indique clairement que les bâtisseurs
ont abandonné l'art du gothique flamboyant pour de nouvelles
normes artistiques. Comme si les donateurs avaient décidé
que leur argent devait aller à la création de verrières
historiées pour embellir l'intérieur de l'église plutôt
qu'à la sophistication des parties extérieures.
|
|

Le fronton de la façade de l'église Saint-Martin.
La sculpture représente les armoiries d'Henri de Montmorency-Luxembourg
qui fut abbé de Montiéramey et seigneur de Saint-Martin. |

Portail méridional : l'intrados de l'entablement est orné de
motifs Renaissance. |
|
| ARCHITECTURE INTÉRIEURE
DE L'ÉGLISE SAINT-MARTIN |
|

Élévation nord de la nef vue depuis le bras sud du transept.
L'édifice offre des éléments artistiques de trois époques : art gothique,
Renaissance et art classique.
L'encadrement des hautes fenêtres est caractéristique de la fin du
XVIe siècle. |
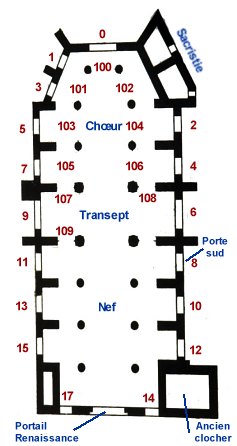
Plan de l'église Saint-Martin-ès-Vignes
Longueur : 52,50 mètres
Largeur : 22,80 mètres.
|
|
Architecture intérieure.
Le Guide archéologique du Congrès de Troyes et de Provins
de 1902 résume cette architecture : «Bâtie à l'époque
de la transition de la Renaissance à l'art moderne, l'église
de Saint-Martin-ès-vignes offre dans toutes ses parties des
réminiscences des siècles précédents.»
La simplicité d'ensemble de cette architecture est une caractéristique
de l'art en Champagne méridionale au XVIe siècle.
L'église comprend une nef à quatre travées, deux bas-côtés,
un transept non saillant et un chœur
de trois travées. La travée terminale présente trois pans
où la prolongation des bas-côtés crée un étroit déambulatoire
sans chapelle rayonnante.
Les piles monocylindriques, identiques dans la nef et le chœur,
ne possèdent qu'une simple moulure en guise de chapiteau.
Les nervures des arcades pénètrent néanmoins ces piles avec
une certaine élégance.
Le remplage des hautes fenêtres, riche de deux larges bandeaux
dont l'un est échancré, sert d'ornement artistique à l'ensemble
de la nef. Les vitraux étant en verre blanc, cette dernière
jouit d'une très bonne luminosité. Dans la nef, seules les
fenêtres des chapelles latérales reçoivent des verrières historiées.
Remplaçant une couverture en bois, la voûte d'ogives date
de la seconde moitié du XVIIe siècle. Les travaux ont été
interrompus de 1681 à 1689 pour attendre la construction du
portail en style classique.
Les croisées d'ogives sont renforcées de liernes et de tiercerons.
C'est la marque d'un style flamboyant finissant. Les points
de jonction accueillent des rosaces et, au centre, des clés
pendantes.
À noter que le transept
est éclairé par deux hautes fenêtres de plus de 11 mètres
de hauteur, rappelant ainsi celui de l'église Saint-Nizier.
|
|

La voûte de la nef vue depuis le transept. |

Le bas-côté sud et ses chapelles latérales. |
|
Les vitraux de l'église Saint-Martin (1/2)
Les vitraux sont la richesse de l'église. Une petite partie
d'entre eux vient de l'ancien édifice démoli en 1590. D'abord
remontés dans le déambulatoire, ceux-ci ont été dispersés
et, pour certains, agrégés à des créations plus tardives.
Globalement, Saint-Martin, dont la construction a démarré
en 1592, possède «un ensemble homogène représentatif de la
production verrière troyenne dans la première moitié du XVIIe
siècle», écrit le Corpus Vitrearum. Ajoutons qu'il
s'y trouve aussi des vitraux de la fin du XVIe siècle. Et
que tous ces vitraux sont datés.
Depuis le XIXe siècle, l'identification des peintres a donné
du fil à retordre aux historiens. Les verrières étant jugées
somptueuses, on les a attribuées aux meilleurs ateliers -
et souvent sans preuve : L. Gontier, J. Blondel, N. Ludot,
l'atelier Macadré.
Parlant de la foi chrétienne des peintres verriers de la Renaissance,
voici par exemple ce qu'écrit l'abbé F. Méchin (qui privilégie
le rôle des Blondel) dans sa Description de trois verrières
pour le Congrès archéologique de France tenu à Troyes
en 1853 :
«Aussi Jean Blondel, de délicieuse mémoire, le modeste auteur
de la plupart des vitraux de St-Martin, sans doute l'un de
ces rares élèves du fameux Linard-Gonthier, qui parfois ont
atteint le mérite du maître, outre un grand amour pour l'église
où il avait été baptisé, avait encore une foi vive et ardente.»
---»» Suite 2/2
à gauche.
|
|
|
Les vitraux
de l'église Saint-Martin (2/2)
---»» Et le même abbé ajoute en note : «Tel est, suivant une
tradition respectable, le nom du principal peintre-verrier,
natif de St-Martin même. Pieux imitateur des peintres chrétiens
du moyen-âge, il n'a pas inscrit son nom au bas de ses œuvres
; nous n'y voyons que des memento mei et des prières
pour les trespassez. Deux ou trois verrières seulement
sont généralement attribuées à Linard-Gonthier, entr'autres
celle de sainte Anne.»
En fait, dans la seconde moitié du XXe siècle avec les travaux
de Nicole Hany, l'identité des auteurs a pu être obtenue grâce
aux contrats et aux dessins qui ont été conservés, grâce aussi
à l'analyse stylistique ou encore par comparaison avec des
œuvres déjà identifiées. Il arrive ainsi d'observer, dans
un même vitrail, la main de Linard Gontier père et celle de
ses deux fils, Nicolas et Linard dit le jeune. Actuellement,
la baie 14
reste toujours attribuée sans preuve à l'atelier Macadré.
Quant aux verrières des baies 6
et 9, datées
de 1654, elles sont signées d'un autre artiste un peu moins
connu, J. Barbarat.
Les artistes vont chercher leurs sources d'inspiration chez
les dessinateurs et graveurs les plus célèbres : Albrecht
Dürer (4
et 6), Martin
de Vos (5),
Dominique Florentin (108),
Gérard de Jode (13).
Contrairement aux verrières des autres églises de Troyes,
celles de Saint-Martin font appel à la nouvelle technique
de l'émaillerie (voir l'analyse proposée plus
bas) qui autorise plus de variété et de fantaisie. Les
vitraux présentés dans cette page et qui relèvent de la fin
du XVIe siècle et des décennies postérieures utilisent tous
cette technique.
En 1959, Françoise Bibolet a proposé de partager les verrières
de l'édifice en quatre périodes :
1) 1500-1505 - Vitraux présents sous la forme de fragments.
2) 1560-1618 - Les verrières son émaillées : baies 1,
3, 6,
7, 9,
12, 15
et 109.
3) 1606-1640 - L'atelier des Gontier. L'émaillerie est utilisée
en de vastes compositions originales : baies 100,
103, 105,
107, 108
; vitraux peut-être des Gontier : 4,
5, 13,
101 et
102.
4) Milieu du XVIIe siècle - Les grisailles : les saints Pierre,
Louis et Jean-Baptiste dans la baie 6.
Et peut-être sainte Anne dans la baie 9.
Les commentaires associés aux verrières, qui sont proposés
ici, sont tirés du Corpus Vitrearum et du livret de
Françoise Bibelot, paru en 1959, sur les Vitraux de Saint-Martin-es-Vignes.
Tous les vitraux de l'église sont donnés ici sauf la verrière
8 (une Trinité) qui ne comporte qu'une lancette et six écoinçons,
la verrière 11 (deux petits panneaux) et la 2 du XIXe siècle.
|
|

Baie n°9, détail
: messe de saint Martin en présence de deux anges.
Début du XVIIe siècle. |
| LES VITRAUX DE
L'AVANT-NEF (BAIES 14 ET 17) |
|
|
BAIE n°17 : VERRIÈRE DE L'ASSOMPTION
ET DES SAINTS, vers 1625 - Linard Gontier le Jeune
|
|
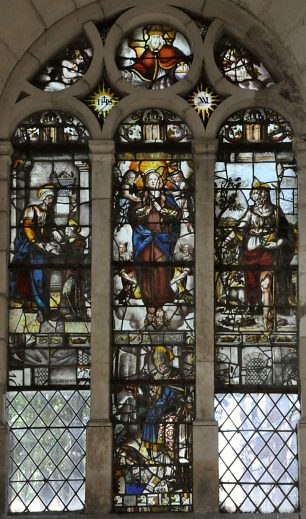
Baie n°17 : Verrière de l'Assomption et des saints, vers 1625.
Attribuée à Linard Gontier le Jeune.
|

Baie n°17, détail : L'Assomption de la Vierge.

|
Baie 17
: L'Assomption et les saints, vers 1625.
Verrière attribuée à l'atelier des Gontier. Linard, le père,
est l'auteur des cartons. Le peintre est probablement l'un
de ses fils.
En bas : saint Claude ressuscite un enfant.
En haut : L'Éducation de la Vierge, l'Assomption, puis saint
Jean-Baptiste désignant l'agneau de Dieu qui est à ses pieds.
Son visage est apparenté à celui de la baie
104. Tympan : le Père céleste entre deux anges adorateurs.
Les couronnements d'architecture dans les têtes de lancettes
sont peints à l'émail.
|
|

Baie n°17, détail :sainte Anne dans l'Éducation de la
Vierge. |

Baie n°17, détail : saint Jean-Baptiste. |
|
|
BAIE n°14 : VERRIÈRE DE LA
PASSION, fin XVIe siècle
|
|
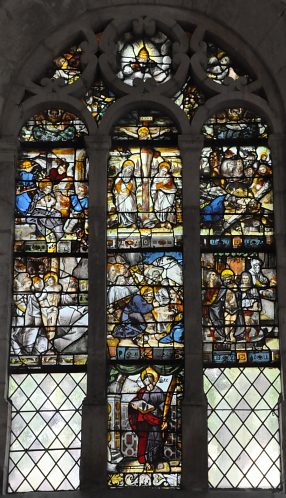
Baie n°14 : verrière de la Passion.
Fin du XVIe siècle.
Atelier inconnu.
Panneau du registre du bas : sainte Christine. |

Baie n°14 : détail du panneau de la Mise en croix. |
|
Baie
14 : La Passion, fin du XVIe siècle.
L'auteur de cette verrière est inconnu. On
l'a jadis attribuée à l'atelier Macadré, mais sans preuve.
On y remarque de nombreux bouche-trous : le contenu
de certains panneaux se présente comme un agrégat informe.
Certains panneaux sont intervertis. On note ainsi dans
le registre médian : Flagellation ; Portement de croix
avec Véronique qui essuie la face de Jésus ; Ecce homo
(donné ci-dessous). Registre supérieur : Christ aux
outrages ; Calvaire et Mise en croix extrait ci-dessus).
Les couleurs sont très chaudes ; les visages, fortement
expressifs.
Au centre du registre inférieur : remploi d'un panneau
restauré de sainte Christine.
Tympan : Dieu le Père entre deux anges.
|
|
|

Baie n°14 : panneau de la Flagellation, détail.
Fin du XVIe siècle. |
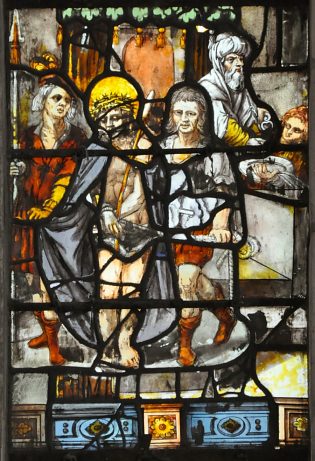
Baie n°14, panneau de l'Ecce Homo.
À l'arrière-plan : Pilate s'en lavant les mains. |

Baie n°14 : détail du panneau de la Crucifixion.
Fin du XVIe siècle.
L'entrelacement des doigts de la Vierge a-t-il une signification cachée
? |
| LES VITRAUX DES
BAS-CÔTÉS (BAIES 13 et 15 au nord ; 10 et 12 au sud |
|

Piéta vers l'entrée de l'église (fin du XVIe siècle). |

Le bas-côté nord.
Les baies 13 et 15
sont à gauche, hors de l'image. |
|
Bas-côté nord - BAIE n°13
: VERRIÈRE D'ABRAHAM, ISAAC ET JACOB, 1619 - Linard Gontier
|
|
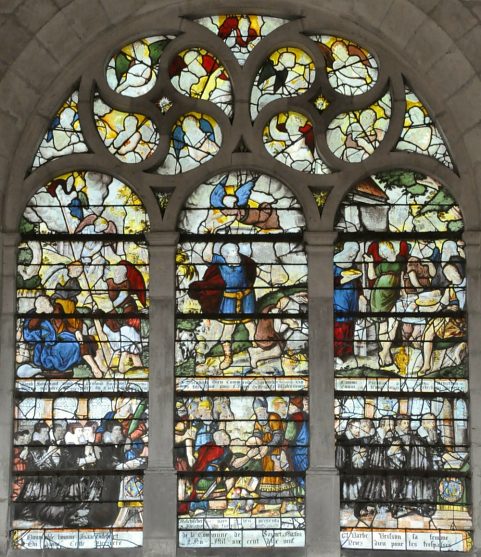
Baie n°13 : verrière d'Abraham, Isaac et Jacob, 1619. |
|
Baie
n°13 : Abraham, Isaac et Jacob, 1619.
Cette verrière est attribuée à Linard Gontier.
Le thème iconographique est illustré en quatre panneaux.
En haut : le Songe de Jacob ; le Sacrifice d'Isaac ;
Abraham partageant son repas avec trois anges. En bas
au centre : Abraham reçoit les offrandes de Melchisédech.
L'artiste s'est inspiré des gravures de Gérard de Jode
pour le Songe, le Sacrifice et les offrandes de Melchisédech.
Le partage du repas est inspiré d'une gravure de A.
Collaert d'après Goltzius.
Au premier registre, le couple donateur, Isaac Gillebert
et son épouse Barbe Brisson, s'est réservé une place
de choix : à gauche, madame et ses six filles présentées
par sainte Barbe (panneau restauré) ; à droite, le donateur
et ses quatre fils agenouillés devant un prie-Dieu.
Au tympan, le Père céleste est entouré de dix anges.
|
|
|

Baie n°13, détail : Abraham s'apprête à sacrifier Isaac.
D'après une gravure de Gérard de Jode.

|
Baie n°13
: panneau du Sacrifice d'Abraham, 1619.
Dieu commande à Abraham de sacrifier son fils, qui sera donc
une victime innocente. Ce faisant, Abraham cèle l'alliance
de son peuple avec Dieu.
La pensée chrétienne voit dans ce sacrifice une préfiguration
de l'Église : la messe (c'est-à-dire le sacrifice du Christ
vivant dans l'Eucharistie) symbolise le renouvellement permanent
de cette alliance entre Dieu et son peuple.
|
|
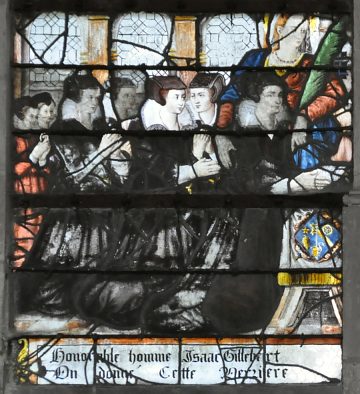
Baie n°13, panneau des donateurs, détail : Le donateur Isaac
Gillebert et ses quatre fils sont agenouillés en prière devant un
prie-Dieu.
Linard Gontier, 1609. |
|
Bas-côté nord - BAIE n°15
: VERRIÈRE DE LA PRISE DE JÉRUSALEM, 1618
|
|
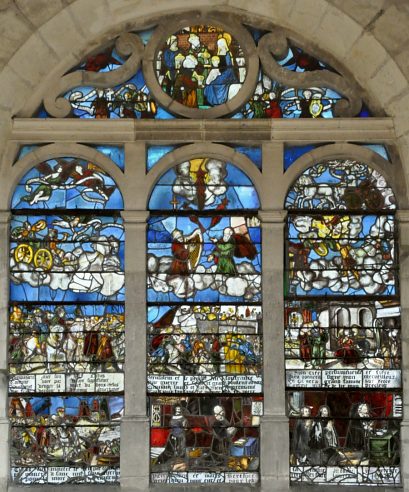
Baie n°15 : la prise de Jérusalem par Vespasien et Titus,
1618.
Atelier inconnu. |
|
Baie
15 : la prise de Jérusalem par Vespasien et Titus, 1618.
Cette verrière est très documentée par les textes peints
au-dessous des panneaux.
Comme dans la baie
13, les donateurs, Pierre Baillet et sa femme Marie
Berthier, se sont approprié deux des trois panneaux
du registre inférieur.
Le bleu ciel azur sur lequel se détachent les scènes
historiées donne un aspect assez enjoué à l'ensemble
de la verrière, mais le dessin en lui-même n'est pas
de la meilleure facture. On en ignore l'auteur.
La verrière se lit de haut en bas et de gauche à droite.
Registre du haut : 1) En l'an 70, Titus et Vespasien
arrivent sur un char (dans la réalité, Titus a été chargé
seul par son père Vespasien de l'offensive contre les
Juifs de Judée) ; 2) le roi David avec sa lyre implore
Dieu ; 3) le prophète Nathan menace.
Registre médian : 1) Arrivée des soldats romains
qui sonnent de la trompe. Remarquons ici que la prise
de Jérusalem et le massacre des Juifs qui s'en est suivi
sont présentés comme une punition du Ciel pour venger
la mort de Jésus. Les Juifs sont clairement désignés
comme déicides (voir, à l'église Saint-Philippe-du-Roule
à Paris, l'analyse proposée de ce dilemme) ; 2) les
Romains donnent l'assaut et siège de Jérusalem ; 3)
souffrances et famine du peuple juif. Les Juifs sont
peints comme des cannibales et des avares : une mère
affamée mange le bras de son enfant et une autre femme
avale son or.
Registre du bas : Les Juifs vaincus sont vendus
à un marchand d'esclaves. Un soldat romain ouvre le
ventre d'un Juif pour y récupérer la pièce d'or que
celui-ci a avalée dans le panneau précédent ; panneaux
des donateurs.
|
|
|
 |

Christ de Pitié
XVIe siècle. |
|

«La Résurrection»
Tableau du XVIIe siècle. |
|

Baie n°15 : la famine à Jérusalem.
À gauche, une femme avale ses pièces d'or ; au centre, une femme mange
le bras de son enfant, 1618. |
|
«Sion cité présumptueuse et fière
Dieu donnera signe mon merveilleuz
En toi sera grand famine sur terre
Comme manger de lor mon précieuz»
|
|

«Le Baptême du Christ»
Tableau du XVIIIe siècle. |
|
Baie 15
: panneau de la famine à Jérusalem.
Voici comment l'abbé F. Méchin décrit le panneau de la famine
à Jérusalem, donné ci-dessus, lors du Congrès archéologique
de France tenu à Troyes
en juin 1853, une époque où un certain antisémitisme sévissait
au sein du clergé français :

«Si l'histoire n'affirmait la vérité des faits suivants, le
cœur se refuserait certainement à les croire, tant ils sont
odieux et effrayants.
La scène a lieu dans l'intérieur d'une maison de Jérusalem.
Deux femmes sont assises assez loin l'une de l'autre ; leur
hideux visage porte l'empreinte d'une profonde terreur ; elles
ont hâte d'accomplir leur action ; vous diriez que le temps
va leur échapper à jamais. L'une, poussée par l'avarice plutôt
que par la faim, avale une à une les pièces d'or qui lui restent
; l'autre... ô spectacle d'éternelle horreur ! Regardez sous
cette cheminée. Devant une flamme ardente, nourrie sans cesse
par une main barbare, tourne et retourne un pauvre enfant
embroché ; il n'a plus qu'un bras, l'autre serait-il
déjà mêlé à la cendre de l'âtre ! Hélas, non ! Voyez-vous
à côté de la mangeuse d'or cette autre créature aux traits
effarés? C'est la mère du petit enfant. Elle tient pressée
entre ses deux mains crispées la tendre chair de son fils,
sa chair. Comme un[e] furie, elle la serre entre ses dents,
la déchire et la dévore avec une voracité sauvage. On dirait
que, dans son horrible festin, la barbarie de son action et
la faim qui la tourmente, doublent sa fièvre et sa démence
: ses yeux sortent de leur orbite, ses nerfs se contractent
: ce n'est plus une figure humaine.
La tradition nous a conservé le nom de cette malheureuse.
Elle s'appelait Mavie, fille d'Éléazar. On connaît assez le
motif qui l'a poussée à une pareille action.»

Il s'agit en fait de Marie, fille d'Éléazar. L'historien
Flavius Josèphe rapporte cet épisode tragique dans la Guerre
des Juifs.
Dans la ville, tout le monde finit par connaître la nouvelle.
Selon Josèphe, Titus, horrifié, en tira justification pour
détruire le temple de Jérusalem.
|

Statue polychrome d'une sainte
Femme. ---»»»
Fin du XVIe, début du XVIIe siècle.
Provient peut-être d'une Mise au tombeau. |
|
 |
|
L'émaillerie
sur verre (1/2).
Cette technique date du second tiers du XVIe siècle.
Durant tout le Moyen Âge et le début de la Renaissance, un
vitrail est un assemblage de verres colorés maintenus par
des plombs qui séparent les différentes couleurs. La couleur,
c'est un pigment pris dans le verre. Et la palette des couleurs
s'est bien sûr enrichie tout au long de la période.
Au XIVe siècle arrivent le jaune d'argent, puis la sanguine
et, avec eux, le modelé en grisaille. La pâte est étalée sur
le verre, et non plus prise dans la masse, ce qui permet des
effets de relief.
À partir du second tiers du XVIe siècle, la technique de l'émaillerie
prend naissance et le travail du peintre verrier en est totalement
modifié. Désormais l'artiste peut poser la couleur au pinceau
sur le verre, ouvrant la voie à une richesse de coloris nouvelle
et à une variété accrue dans les effets du dessin. L'émail,
que l'on peut aussi appeler «couleur vitrifiable», est un
composé d'oxyde de colorant et de fondant. Il se peint sur
le verre blanc, puis est cuit au four. La chaleur le fait
s'intégrer à la verrière.
Cependant cette technique n'est pas sans difficultés car le
fondant à étaler est une pâte chaude et visqueuse. Si elle
n'est pas assez visqueuse (mauvaise mise au point), elle peut
couler sur le verre. Si elle l'est trop, les couleurs seront
modifiées à la cuisson. Sans compter l'effet de l'usure du
temps sur l'assemblage de matériaux fort différents (verre
et pâte) : dilatation, craquelures et finalement séparation
des deux composés, achevant la dégradation de l'œuvre.
Rappelons ici qu'il faudra attendre la première moitié du
XIXe siècle pour voir le directeur de la manufacture
de porcelaine de Sèvres, Alexandre Brongniart, prendre
le taureau par les cornes et lancer ses équipes de recherche
sur la mise au point, une fois pour toutes, des peintures
qui permettront de vaincre les difficultés nées de la technique
de l'émaillerie. L'art du vitrail en sera bouleversé et aboutira
au concept du «vitrail-tableau», rapprochant ainsi la peinture
sur verre de la peinture sur faïence et sur porcelaine.
---»» Suite 2/2
à droite.
|
|

Baie n°15 : arrivée des soldats romains avec l'empereur Vespasien
et son fils Titus.

|
«Vaspasien avec son filz Titus
Comme voye par vraye signifience
Vindrent venger la mort du doux Jesus
Par franc vouloir et divine advertance.»
|
|
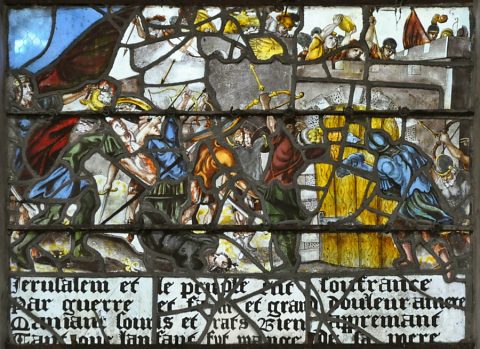
Baie n°15 : les Romains donnent l'assaut.

|
«Jerusalem et le peuple eut soufrance
Par guerre et faim et grand douleur amere
Manjant souris et rats bien appremant
Tant que l'anfant fut mangé de sa mere.»
|
|
|
L'émaillerie
sur verre (2/2).
---»» Revenons au XVIe siècle. La difficulté de la technique
à l'émail explique la rareté des vitraux de ce genre. «De
1595 à 1630, l'art du vitrail est en décadence partout», écrit
Françoise Bibolet. On le conçoit aisément. La nouvelle technique
avait certainement laissé envisager la création de chefs-d'œuvre,
mais c'étaient les vitraux ratés qui se multipliaient... Chez
les peintres verriers, le découragement dut succéder à la
déception. Toutefois, à Troyes,
un peu moins d'un siècle après le début de l'émaillerie, Linard
Gontier releva le défi et, grâce à un talent hors pair, réussit
à créer les chefs-d'œuvre attendus.
Linard (ou Léonard) Gontier est né à Troyes
vers 1566 et mort vers 1641. Il travaillait avec ses deux
fils, qu'il a sans aucun doute formés. Le plus connu est Linard
le Jeune (1601 - vers 1642). Le second est Nicolas.
Le Corpus Vitrearum parle aussi d'un Jean Gontier sans
préciser le lien de parenté.
Lisons Françoise Bibolet : «Tout en continuant d'utiliser
les verres colorés, les Gontier seuls ont su appliquer l'émail
avec un art discret et sûr. Ils ont continué la technique
ancienne du verre teint dans la masse, mais rehaussé de touches
d'émail dans les fonds de paysages, arbres, perspectives ou
animaux, dans les visages d'une foule, dans les broderies
des vêtements.»
Les Gontier utilisèrent leur art avec maestria dans les petits
vitraux. On peut en voir dans les bas-côtés de Saint-Martin.
Voir aussi le vitrail de l'Immaculée
Conception à la chapelle du Saint-Sacrement de la cathédrale
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. C'est par leurs grandes verrières
qu'ils ont surtout marqué l'histoire de l'art champenois,
mêlant là aussi verres de couleur et émail.
À Saint-Martin, les baies hautes du chœur
sont illuminées de grandes scènes historiées des Gontier étalées
sur plusieurs lancettes : vie
de saint Pierre, vie
de saint Jean-Baptiste et Annonciation.
À la cathédrale, les Gontier ont réalisé le célèbre
Pressoir mystique. D'autres peintres verriers les ont
suivis sur la même voie : les Macadré à Saint-Nizier
; Jean Barberat dans le chœur de Saint-Pantaléon.
Source : «Les vitraux de Saint-Martin-es-Vignes»
de Françoise Bibolet, La Renaissance, Troyes, 1959.
|
|
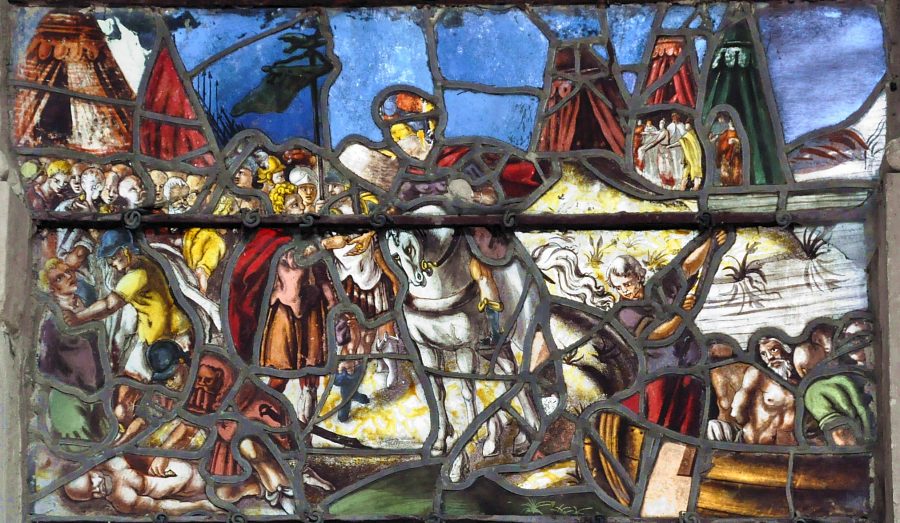
Baie n°15 : Les Juifs vaincus sont vendus à un marchand d'esclaves.
À gauche en bas : un soldat romain ouvre le ventre d'un Juif pour
y récupérer la pièce d'or que celui-ci a avalée. |
|
Bas-côté sud - BAIE
n°10 : VERRIÈRE DE LA GENÈSE ET DE LA RÉDEMPTION, 1600
|
|
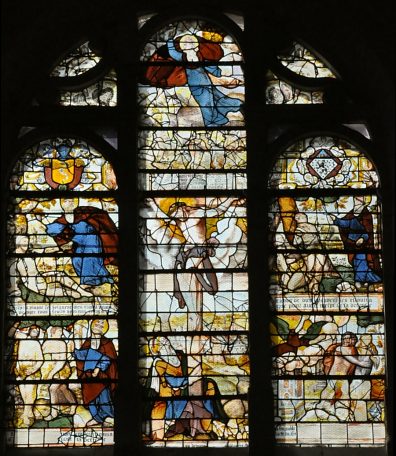
Baie n°10 : verrière de la Genèse et de la Rédemption,
1600.
(aussi appelée verrière du Péché Originel) |
|
Baie
10 : La Genèse et la Rédemption, 1600.
Cette verrière, dont l'auteur n'est pas connu, traite
de la Genèse, un thème très à la mode dans les églises
champenoises au XVIe siècle. La lecture se fait de haut
en bas.
Au tympan, Dieu crée le ciel et la terre, les astres,
les animaux et la verdure. Puis il crée Adam. Il interroge
Adam et Ève après leur désobéissance. Le couple s'enfuit.
Enfin, un ange, qui brandit une épée, leur interdit
l'entrée du Paradis.
La lancette centrale est occupée par la scène de la
Crucifixion qui se veut ici Rédemption, opposée à la
faute originelle. Le texte consacré au donateur est
difficilement lisible.
|
|
| «Noli me tangere»,
tableau attribué à Cossard, XVIIe siècle ---»»» |
|
|

Chapelle latérale sud du Sacré-Cœur. |
 |
|

Le retable de la chapelle latérale sud dite de la Vierge. |
|
Bas-côté sud - BAIE
n°12 : VERRIÈRE DE SAINT SÉBASTIEN
|
|
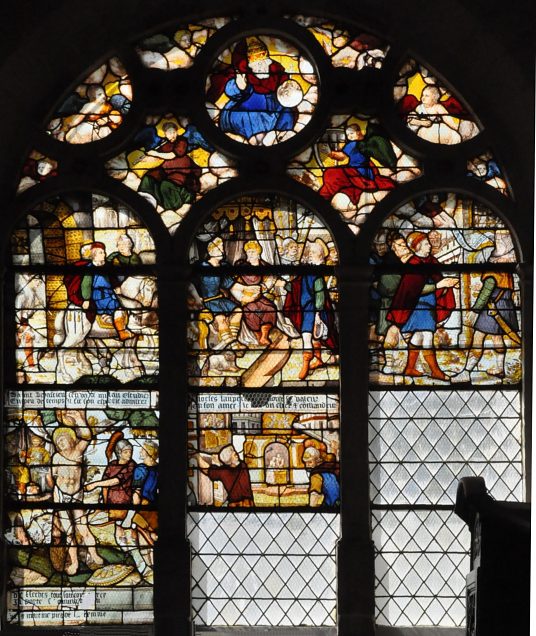
Baie n°12 : verrière de saint Sébastien.
Début du XVIIe siècle. |
|

Baie 12, détail : le Martyre de saint Sébastien.
«La Sagittation»
Début du XVIIe siècle. |

. Christ aux outrages.
XVIe siècle. |
|
Baie
12 : Vie de saint Sébastien, début du XVIIe siècle.
L'auteur de ce vitrail aux saynètres très colorées n'est pas
connu. Un rapprochement de style pourrait l'attribuer à Linard
Gontier. Seul le nom de la donatrice, Martine Pichot, est
inscrit sur le panneau inférieur. Sébastien chevauche vers
Milan ; il est nommé chef de l'armée par Dioclétien et Maximien
; puis arrêté et martyrisé. Le demi-panneau montre les bourreaux
tuer Sébastien à coups de gourdins. Le panneau disparu à droite
illustrait certainement la découverte du corps du martyr.
|


Triptyque «Vie de saint Edme», peinture sur bois.
Mariage mystique avec la Vierge ; naissance de Saint Edme ; saint
Edme consacré archevêque de Cantorbéry. |
|
LE TRANSEPT ET SES GRANDES
VERRIÈRES NORD ET SUD (Baies 6 et 9)
|
|
|
BAIE n°9 : GRANDE VERRIÈRE
DE LA VIE DE SAINT MARTIN ET DE LA VIERGE, XVIe et XVIIe siècles
|
|

La verrière de la baie n°9 (11,80 mètres de haut)
dans le bras nord du transept. |

Baie n°9, détail : le baptême de Martin.
Début du XVIIe siècle. |
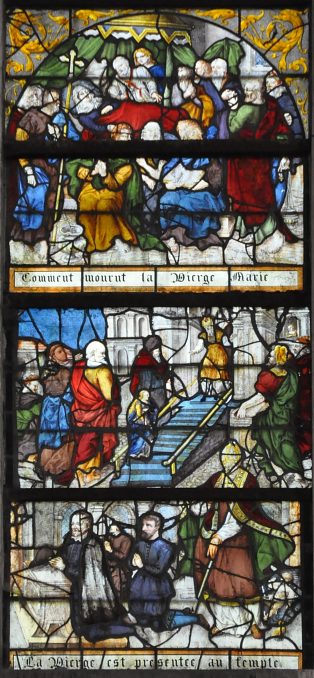 |
|
|
Baie
9 : Vie de saint Martin et Vie de la Vierge.
Cette verrière composite, haute de
11,80 mètres, comprend trois parties.
La partie inférieure, du début du XVIIe siècle,
illustre des épisodes de la vie de saint Martin.
Les deux registres de la partie médiane montrent
quatre saynètes relatives à la vie de la Vierge
(Présentation au Temple, Annonciation, Dormition
et Assomption). Datées du milieu du XVIe siècle,
elles proviennent de la chapelle de la Vierge
de l'ancienne église.
Les saynètes encadrent un grand vitrail consacré
à saint Paul, daté de 1505, et provenant lui aussi
de l'ancienne église.
Le tout est surmonté de trois panneaux en grisaille
réalisés par Jean Barbarat, datés aux alentours
de 1654 : sainte Anne et la Vierge, saint Nicolas,
le Christ de la Résurrection.
Au tympan, les armoiries de la famille d'Autruy
(XVIIe siècle) sont accompagnées de deux écussons
modernes symbolisant la Foi et la Charité.
|
|
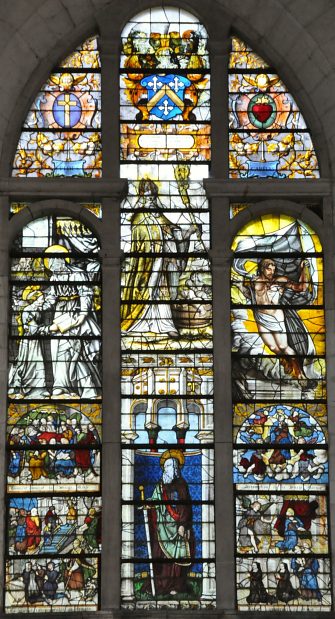
Baie n°9 : verrière de la vie de saint Martin
Partie basse : début du XVIIe siècle,
Partie médiane : milieu du XVIe,
Partie supérieure : vers 1654,
Tympan : XVIIe et XIXe siècles. |

Baie n°9, détail de la partie basse :
Les donateurs, Jacques Bardin et sa femme, Linarde Sauger,
sont présentés par leurs saints patrons : saint Jacques
pour l'époux, saint Léonard pour l'épouse.
Début du XVIIe siècle. |
«««--- Baie
n°9, saynètes de la partie basse :
présentation de la Vierge au Temple et Dormition.
En bas, trois donateurs sont présentés par saint
Claude. |
|
|
|
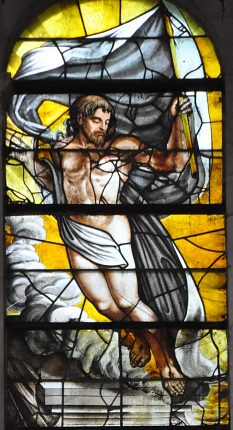
Baie n°9, détail : le Christ de la Résurrection.
Vers 1654.
Grisaille de Jean Barabat, posée en 1895. |

Baie n°9, détail : saint Martin partage son manteau.
Début du XVIIe siècle. |

Chapelle du bras nord du transept
et son retable en bois. |

Baie n°9, détail : Linarde Sauger,
donatrice des vitraux de la vie de saint Martin.
Début du XVIIe siècle. |
|
|
BAIE n°6 : GRANDE VERRIÈRE
DE L'APOCALYPSE, 1505, 1611, 1654
|
|
|
Baie n°6 ---»»»
Verrière de l'Apocalypse.
Partie inférieure, 1611,
Saint Louis, 1505,
Grandes grisailles, 1654.
|
|
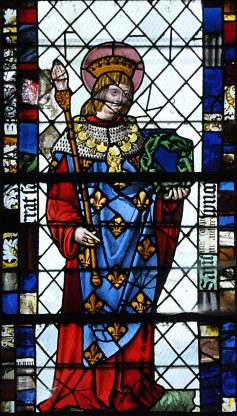
Baie n°6, détail : saint Louis.
Il porte le collier de l'ordre de Saint-Michel
et tient la couronne d'épines à la main.
1505.
Cette lancette doit être rapprochée des verrières
hautes de la cathédrale
de Troyes. |

Baie n°6, détail : partie centrale du tympan.
Y a-t-il trace de fragments d'une Annonciation
dans cet agrégat de bouche-trous ?
|
|
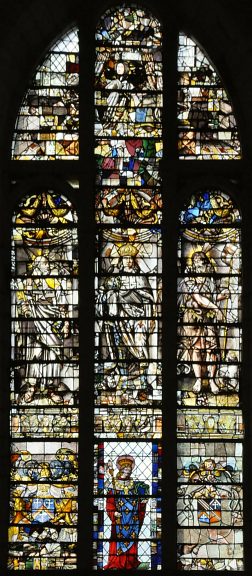 |
|
Baie
6 : l'Apocalypse.
Cette grande verrière de 11,80 mètres de haut occupe
le bras sud du transept.
Elle se compose de deux étages : l'Apocalypse en bas
avec ses trois registres ; au-dessus de l'étrésillon,
saint Louis entouré d'armoiries, puis trois grisailles
de saints.
Les scènes de l'Apocalypse (1611) rappellent
les vitraux de l'église Saint-Nizier
sur le même thème. Leurs auteurs nous sont inconnus.
La touche des peintres verriers étant assez voisine,
il se peut que ce soit le même.
Comme à Saint-Nizier,
les vitraux de l'Apocalypse imitent la suite que Dürer
a gravée sur bois entre 1496 et 1498.
Dans l'image
plus bas, l'illustration de la Bête avec ses sept
têtes, qui sort de la mer, et du bélier cornu qui sort
de la terre, est tout à fait semblable à l'illustration
que l'on voit à Saint-Nizier.
À l'étage supérieur, saint Louis (ci-contre)
porte le collier de l'ordre de Saint-Michel autour du
cou et tient la couronne d'épines à la main. Ce vitrail,
daté de 1505, provient de l'ancienne église Saint-Martin.
Les deux lancettes, de part et d'autre, sont datées
du XVIIe siècle. Peintes à l'émail, on y trouve les
armoiries des donateurs : à gauche, Louis d'Autruy ;
à droite, son épouse, Anne de Villeprouvée.
Au-dessus, les trois grandes grisailles, dues à Jean
Barbarat, sont datées de 1654 : saint Pierre, saint
Louis empereur et saint Jean-Baptiste. Ce sont vraisemblablement
les saints patrons de donateurs disparus.
Le tympan est un agrégat de bouche-trous. Le Corpus
Vitrearum se demande s'il ne s'y trouve pas des
fragments d'une Annonciation. Est-ce dû à la présence
d'un visage féminin ?
L'ensemble de la verrière a été restauré en 1880 par
Vincent-Larcher et son fils Saint-Ange.
|
|
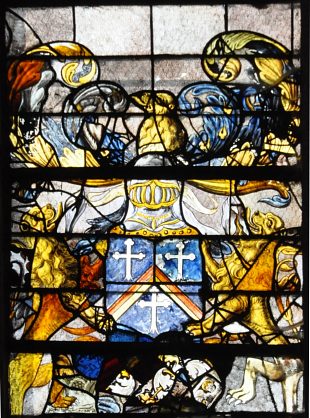
Baie n°6, détail : armoiries de Louis d'Autruy (peintes
à l'émail).
XVIIe siècle. |

Baie 6, détail : saint Pierre par Jean Barbarat.
1654. |
|
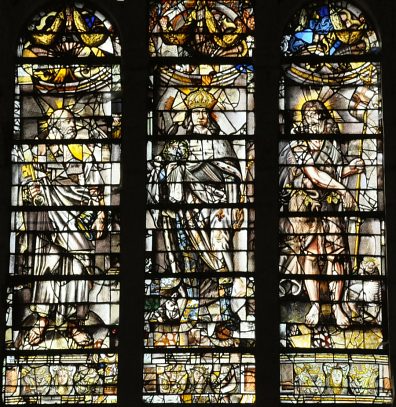
Baie n°6, détail : personnages en grisaille et jaune d'argent par
Jean Barbarat (1654).
Saint Pierre, saint Louis empereur et saint Jean-Baptiste. |
|
Dans l'Apocalypse, le Christ
traverse les nuages sur un cheval blanc et s'en va vaincre
la Grande Prostituée, jeune femme d'une grande beauté,
assise sur un animal à sept têtes.
La femme représente Babylone ou Rome, la cité idolâtre.
|
|
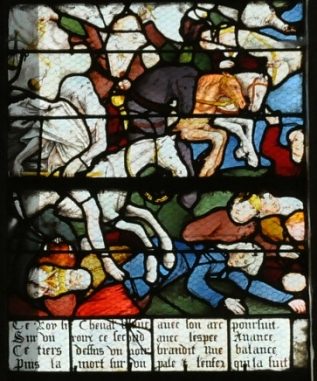
Baie n°6, détail : les quatre Cavaliers de l'Apocalypse. |
|
«Ce roy sur cheval blanc avec son arc poursuit,
Sur un roux ce second avec l'espée avance,
Ce tiers dessus un noir brandit une balance,
Puis la mort sur un pâle, et l'enfer qui
la suit.»
|
|
|

Baie n°6, détail : la Grande Prostituée
(qui représente Babylone ou Rome).

|
«Sur la beste pleine d'abomination,
Une femme à la coupe aux fornication.
Du ciel un cavalier à la robe sanglante
Vient, ayant en la bouche une espée tranchante.»
|
|
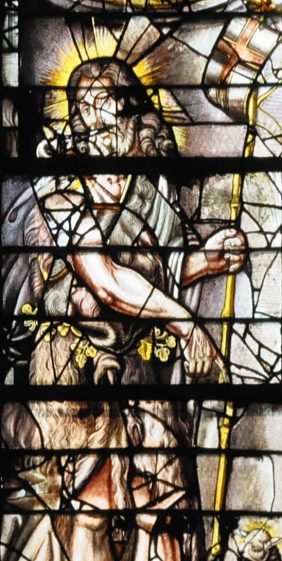
Baie 6, détail : saint Jean-Baptiste
par Jean Barbarat, 1654. |

Baie n°6, détail : La Bête séduit les habitants de la terre.
Voir un panneau similaire à l'église Saint-Nizier
de Troyes.

|
«Icy sort
de la mer un horrible animal
Monstre sept foies testu et fourny de dix cornes
Qui d'ennorme blasphème oubtrepassant les bornes
A reçu du dragon pouvoir de faire mal. 1611.»
|
|
|
LE TRANSEPT ET SES GRANDES
VERRIÈRES (Baies 107, 108 et 109)
|
|
|
BAIE n°107 : VERRIÈRE DE
LA TRANSFIGURATION, 1636
|
|
|
|
|
BAIE n°108 : VERRIÈRE DU
MARTYRE DE SAINT ÉTIENNE, 1639 - atelier de Linard Gontier
|
|
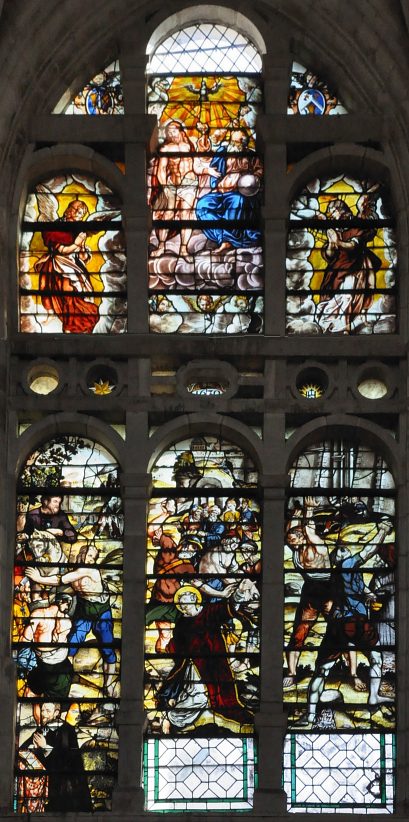
Baie 108 : le Martyre de saint Étienne, 1639. |
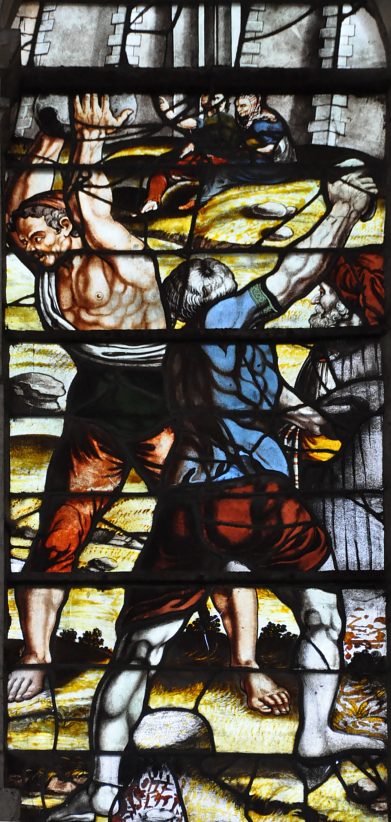
Baie 108, détail : les bourreaux à l'œuvre. |

Baie 108, détail : le cheval d'un bourreau. |
|
Baie
108 : le Martyre de saint Étienne, 1639.
Cette grande verrière (7,0m x 3,0m) a été réalisée par Jean
Gontier sur un dessin de son père Linard. Le père a tiré
son inspiration d'une gravure de Dominique Florentin, qui
s'est lui-même inspiré d'une gravure de Julio Romano.
Alors qu'il est lapidé à mort, Étienne, diacre de la première
église de Jérusalem, a une vision de la Trinité, représentée
ici entre deux anges adorateurs.
Le donateur du vitrail s'est figuré dans le soubassement.
On ignore son identité. La lancette centrale montrant Étienne
a été fortement restaurée.
En haut de cette lancette, l'artiste a représenté le jeune
Saül de Tarse qui garde les habits des bourreaux (et qui assiste
passivement à la lapidation).
Un rappel des conditions de l'exécution du diacre Étienne
est donné à l'église Notre-Dame
de Lourdes à Nancy.
|
|

Baie 108, détail : le jeune Saül de Tarse
observe les bourreaux (haut de la lancette centrale). |
|
BAIE n°109 : VERRIÈRE DE
SAINTE GUDULE, 1ère moitié du XVIe siècle
|
|
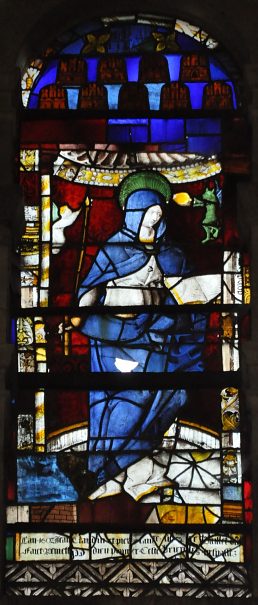
Baie 109, détail : sainte Gudule.
1er quart du XVIe siècle.
Un diable vert s'efforce d'éteindre le cierge de la sainte,
tandis que, sur la gauche, un angelot le rallume.
|
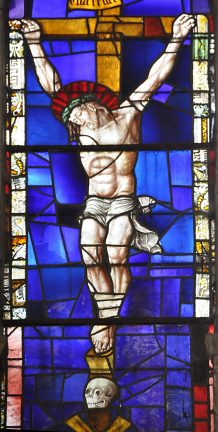
Baie 109, lancette du bas : Crucifixion
Vers 1530 (?)
| Détail : le visage
du Christ crucifié ---»»» |
|
|
Baie
109 : la Crucifixion et sainte Gudule, 1523.
Ces deux vitraux proviennent de l'ancienne église
Saint-Martin. Selon Françoise Bibolet, il est
probable qu'ils étaient placés dans la fenêtre
axiale du sanctuaire.
Les auteurs, à l'évidence différents, des deux
vitraux ne sont pas connus.
Selon le Corpus Vitrearum, le Christ pourrait
dater de 1530.
Le vitrail de sainte Gudule, en habit de moniale
sur un damas rouge, est daté du premier quart
du XVIe siècle.
|
|

Statue polychrome de sainte Madeleine.
Fin du XVIe - début XVIIe siècle.
(Provient peut-être d'une Mise au tombeau.) |
 |
|

Baie 109 : verrière de sainte Gudule.


Statue de saint Laurent.
XVIIe siècle. |
|
|
LE CHŒUR ET L'ABSIDE DE L'ÉGLISE
SAINT-MARTIN-ÈS-VIGNES
|
|

Le chœur de l'église et le déambulatoire nord embelli de vitraux du
XVIIe siècle.
Les arcades sont en plein cintre, contrairement à celles de la nef
qui sont en arc-brisé.
On voit ici, le long du déambulatoire, de gauche à droite : les verrières
7, 5,
3 et 1. |
 |
«««--- Le chœur et l'abside
avec les verrières 101-100-102.
La baie axiale 0
reçoit un vitrail du XIXe siècle
illustrant la vie de saint Joseph. |

La voûte du chœur s'étend sur trois travées.
La travée orientale est à trois pans.

Les Évangélistes se trouvent
dans les clés de la travée médiane. ---»»» |
|
CLÉS DE VOÛTE DU
CHŒUR
2e TRAVÉE |
|

Saint Jean l'Évangéliste et son aigle. |

Saint Luc l'Évangéliste et le taureau. |
|
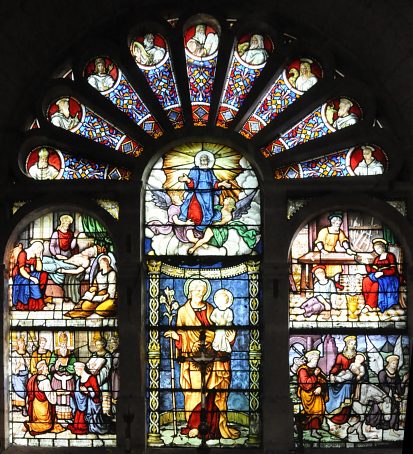 |

Clé pendante à l'abside.
«««--- Baie 0
Saint Joseph et quatre épisodes de sa vie :
Mariage avec Marie,
Fuite en Égypte,
Sainte Famille,
Mort.
Atelier Martin Hermanovska, 1857. |
|

«La Descente de croix»
Tableau de l'École troyenne.
Atelier de la famille de Jacques de Létin.
|
|
BAIE n°1 : VERRIÈRE DE LA
LÉGENDE DE LA CROIX, 1500 et 1562
|
|

Baie n°1 : verrière de la Légende de la Croix, 1562.
Le panneau central du bas est un remploi d'une Mise au tombeau
datée de 1500
et posée au XIXe siècle après bris du panneau. |
|
Baie
n°1 : la Légende de la Croix, 1500 et 1562 (2/2).
---»» Panneau de droite de la rangée
supérieure : le bois du pont est enfoui sous terre.
Il est redécouvert quand on creuse la piscine probatique.
Conformément au présage de la reine de Saba, il servira
à la croix du Christ.
Les bordures, du XVIe siècle, sont en grisaille et jaune
d'argent.
Au tympan : Invention de la croix par sainte Hélène
et Exaltation de la croix par Héraclius Ier. Voir un
développement de ce dernier thème à l'église Sainte-Croix
à Bordeaux.
Dans sa description de trois verrières de Saint-Martin
pour le Congrès archéologique de France tenu
à Troyes
en 1853, l'abbé F. Méchin croit savoir que le panneau
central du bas a été brisé, quelques années plus tôt,
par un malfaiteur qui s'est introduit dans l'église.
«Aujourd'hui on regrette de voir en place, écrit-il,
une mise au sépulcre qui nous semble bien ordinaire.
Du reste, on peut retrouver à St-Pantaléon (...) le
sujet tel qu'il existait à Saint-Martin». L'abbé termine
sa remarque en se félicitant que les vitraux soient
maintenant protégés à l'extérieur par de solides grillages...
Le panneau en question, visible à l'église Saint-Pantaléon
dans la baie
n°1, est donné ci-contre : un ange donne à
Seth le rameau que celui-ci doit planter sur la tombe
d'Adam, son père. Notons en passant que ce vitrail de
la baie n°1, daté de 1540, est le seul vitrail polychrome
de Saint-Pantaléon.
Tous les autres sont en grisaille.
|
|

Baie 1, détail : Adam sur sa tombe. |
|
|
Baie
n°1 : la Légende de la Croix, 1500 et 1562 (1/2).
La verrière date de 1562 et vient de
l'ancienne église Saint-Martin qui sera détruite en
1590. Le panneau central du bas a été brisé. La Mise
au tombeau que l'on y voit, datée de 1500, est un remploi
très restauré au XIXe siècle.
Ce panneau central brisé représentait un ange qui apportait
un rameau de l'Arbre de vie du Paradis terrestre. Le
panneau de droite dans le registre du bas montre Seth,
troisième fils d'Adam, plantant ce rameau sur la tombe
de son père.
Registre supérieur : Salomon fait abattre l'arbre. Impropre
pour construire le temple, il est utilisé comme pont
au-dessus d'une rivière. Pont que la reine de Saba refuse
de traverser par respect pour ce qu'il représente :
sur ce bois, le Rédempteur sera crucifié.
---»» Suite 2/2
ci-dessous à gauche.
|
|
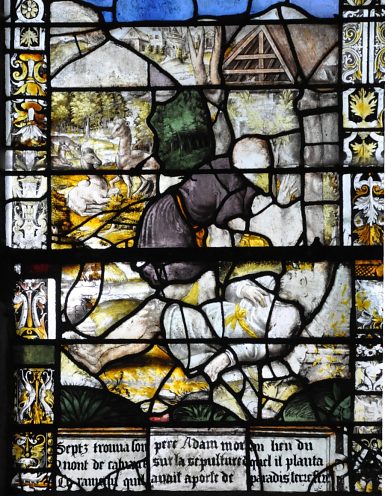
Baie n°1, détail : Seth plante le rameau sur la tombe
de son père, Adam.
Atelier inconnu, 1562. |

ÉGLISE SAINT-PANTALÉON À TROYES
Verrière de la légende de la croix (vers 1540), détail :
un ange donne à Seth le rameau que ce dernier doit planter sur
la tombe de son père.
C'était vraisemblablement à l'origine le thème du panneau central
brisé de la baie
n°1 de Saint-Martin. |
|

Baie n°1, détail : Des animaux fabuleux accompagnent Seth
plantant le rameau sur la tombe d'Adam, son père.
|

Baie n°1, détail : Mise au tombeau, 1500.
Remplace un panneau brisé au XIXe siècle. |

Baie n°1, détail : Les donateurs sont présentés par leurs
saints patrons respectifs, saint Nicolas et saint Edme. |
|
«««--- L'artiste a peint
des animaux fabuleux, voisins des chevaux. A-t-il voulu
représenter
des animaux dont il avait entendu parler, mais qu'il
n'avait jamais vus ? Sur ce même thème,
voir l'«éléphant» dans un chapiteau de l'abbaye
aux Dames à Caen.
|
|
|

Le déambulatoire de l'église Saint-Martin ne possède pas de chapelles
rayonnantes..
De gauche à droite, les verrières 3,
1 et 0. |

Statue de saint Martin à cheval dans le déambulatoire.
Début du XVIe siècle. |
|
BAIE n°3 : VERRIÈRE DE LA
CÈNE, 1607
|
|

Baie n°3 : verrière de la Cène, 1607. |
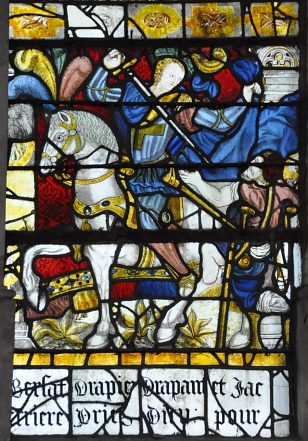
Baie n°3, détail : saint Martin partageant son manteau.
Le saint porte un vêtement du XVIe siècle.

Il faudra attendre le XIXe siècle pour que saint Martin
soit représenté avec une tenue conforme à son statut
d'officier de la légion romaine. |
 |
|
Baie
3 : la Cène, 1607.
Cette verrière, dont l'auteur est inconnu, a été offerte par
Jacques Bersat, drapier drapant, et Jacquette Cloquemy, son
épouse. Tous deux sont introduits par saint Jacques dans le
panneau gauche du registre du bas.
À droite en bas, saint Nicolas se tient dans une niche d'architecture
dont les piliers imitent le marbre.
En haut, la Cène est illustrée par trois saynètes. Celle du
centre a été très restaurée.
Dans la saynète partielle donnée ci-contre, Jésus annonce
aux apôtres que l'un d'entre eux le trahira. Sur la droite,
Jean se montre confiant, tandis que, au premier plan, Judas,
en costume jaune, s'accroche à sa bourse.
Au tympan : Trinité souffrante et Christ de l'Apocalypse.
Des têtes d'anges remplissent les écoinçons.
|
|
«««--- Baie n°3, détail :
Jésus annonce aux apôtres
que l'un d'entre eux le trahira.
1607.
|
|
|
BAIE n°4 : VERRIÈRE DE LA
VIE DE SAINTE ANNE, 1623 - Linard Gontier
|
|
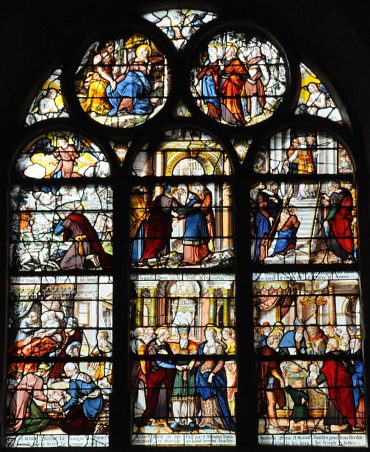
Baie n°4 : verrière de la vie de sainte Anne, 1623.
Verrière attribuée à Linard Gontier.
|
|
Baie n°4
: Vie de sainte Anne, 1623.
Cette verrière, attribuée à Linard Gontier,
est l'une des plus remarquables de l'église. Luminosité des
coloris, finesse des dessins, multiplicité des détails pittoresques,
richesse des vêtements en font un vrai chef-d'œuvre du vitrail
du début du XVIIe siècle. Le Corpus Vitrearum note
que l'artiste a utilisé la sanguine et les émaux de couleurs
variées dans toute la composition. Il mentionne aussi que
l'œuvre a été peu restaurée.

Chaque panneau est illustré d'une légende. Pour deux d'entre
eux, le Refus de l'offrande de Joachim au Temple et
la Prière de Joachim dans le désert, le peintre verrier
s'est inspiré de l'ouvrage d'Albrecht Dürer, la Vie de
la Vierge, réalisé entre 1504 et 1511.

On donne ci-dessous les légendes en ancien français. Lecture
de bas à haut et de gauche à droite :

Registre inférieur :

1) Naissance d'Anne (image ci-contre) :
«Le Ciel bénin versant sa benigne influence
De saincte Anne benist la divine naissance.»
2) Mariage d'Anne et de Joachim :
«Saincte Anne en âge fust par le Vouloir
divin
Conjoincte en mariage au sainct homme Joachin.»
3) L'offrande est repoussée par le grand-prêtre :
«Saincte Anne et sainct Joachin, pour
leurs stérilitez,
Furent, selon la loy, hors du Temple, jettez.»

Registre supérieur :

4) L'ange avertit Joachim qu'il aura une fille :
«L'ange asseure Joachin qu'Anne sa femme
chere
De stérile seroit de la Vierge la mere.»
5) Rencontre à la Porte dorée :
«Saincte Anne et sainct Joachin, qui
estoient séparez
A la Porte Dorée ilz se sont rencontrez.»
6) Présentation de Marie au Temple :
«La Vierge estant à Dieu par ses parents
vouée
Au sainct Temple elle fut receue et avouée.»

Au tympan, à gauche, un ange apparaît à sainte Anne. Celle-ci
a la vision de sa descendance (donnée dans le soufflet de
droite) : Marie, Jésus et les deux filles d'Anne issues de
ses mariages ultérieurs légendaires, à savoir Marie-Cléophas
et Marie-Salomé (accompagnées de leurs enfants, dont saint
Jean).
Cette image est connue comme la Sainte Parenté de la Vierge.
|
|

Baie n°4, détail du tympan : un ange apparaît à sainte Anne.
1623, verrière attribuée à Linard Gontier. |

Baie n°4, détail : la Naissance de sainte Anne. |

Baie n°4 : prière de Joachim dans le désert.
L'ange avertit Joachim qu'il aura une fille. |
|
BAIE n°5 : VERRIÈRE DU CREDO,
1606 - Linard Gontier
|
|
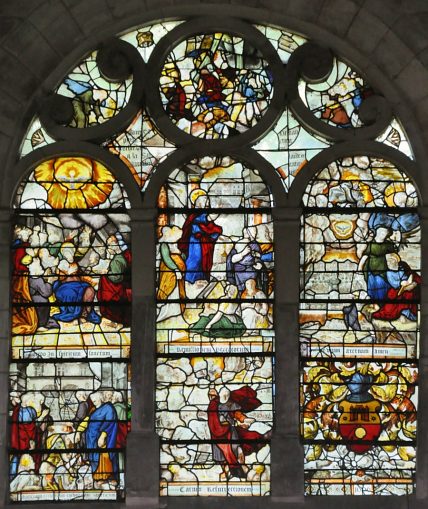
Baie n°5 : verrière du Credo, 1606.
Cette verrière est attribuée à Linard Gontier.
Le panneau inférieur à droite affiche les armoiries de la famille
Le Tartier, donatrice. |

Baie n°5, détail : la Pentecôte.
|
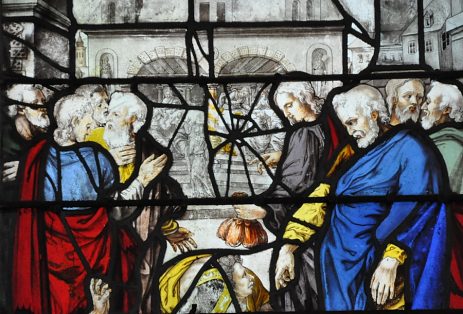
Baie n°5, détail : la Communion des saints.
Les apôtres Pierre et Jean font l'aumône aux pauvres. |
|
Baie
n°5 : le Credo, 1606.
Attribuée à Linard Gontier, la verrière
du Credo illustre la foi chrétienne.
Au registre supérieur : la Pentecôte ; la Rémission des péchés
par saint Pierre ; la Vie éternelle symbolisée par la Jérusalem
céleste.
Au registre du bas : La Communion des saints ; la Résurrection
(les squelettes se relèvent devant le prophète Ézéchiel) ;
armoiries des donateurs (la famille Le Tartier) avec heaume
et lambrequins.
Dans le panneau de la Jérusalem céleste symbolisant la vie
éternelle, Linard Gontier a reproduit, en la simplifiant,
une partie d'une gravure réalisée par Nicolas Prévost, elle-même
inspirée d'un dessin de Martin de Vos.

Il est intéressant de noter que Linard Gontier va réutiliser
cette gravure en 1623 pour réaliser la verrière de l'Immaculée
Conception destinée à la collégiale Saint-Étienne disparue
au début du XIXe siècle.
La verrière, quant à elle, n'a pas disparu. Elle se trouve
dans la chapelle
du Saint-Sacrement de la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Troyes.
Au tympan : décollations de sainte Jule et de l'empereur Claude
(voir la verrière de la baie
n°7).
Utilisation de sanguine pour plusieurs visages et d'émaux
pour les décors.
|

|

Baie n°5, détail : la Jérusalem Céleste.
Représentation réduite d'une gravure de Nicolas Prévost inspirée d'un
dessin de Martin de Vos. |
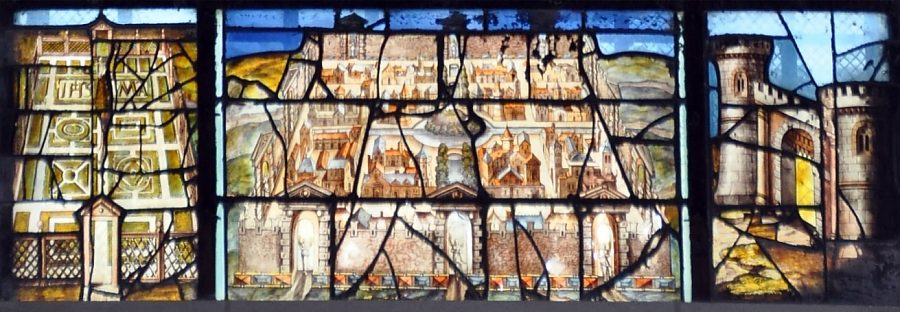
CATHÉDRALE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL À TROYES
Chapelle
du Saint-Sacrement
Vitrail de l'Immaculée Conception, détail.
Linard Gontier, 1623. |
|
BAIE n°7 : VERRIÈRE DE LA
VIE DE SAINTE JULE, 1606
|
|
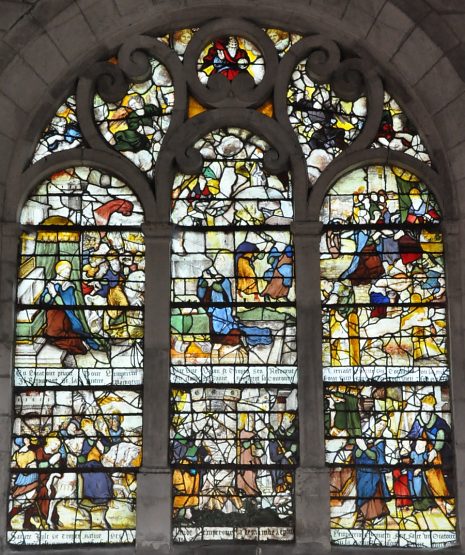
Baie n°7 :verrière de la vie de sainte Jule, 1606. |
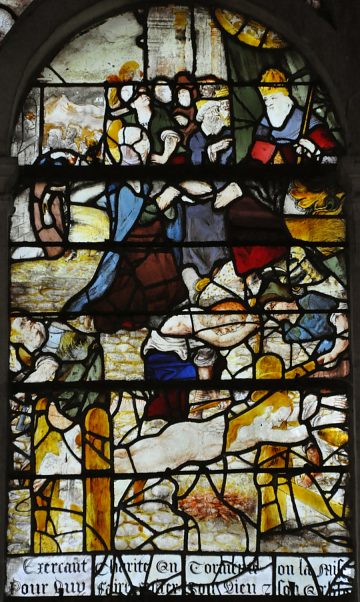
Baie n°7, détail : le Martyre de sainte Jule devant l'empereur
Aurélien.

|
«Exerçant charité en tormente on l'a mise
Pour luy faire quiter son Dieu et son Eglise.»
|
|

Le chœur et, sur la droite, le bas-côté sud.

|
Baie n°7
: Légende de sainte Jule (ou Julie), 1606.
L'auteur de cette verrière n'est pas connu.
Chrétienne, Jule fut capturée par un chef germain, Claude.
Elle le convertit. Sur l'ordre de l'empereur romain Aurélien
(270-275), elle fut martyrisée avec lui et avec plusieurs
soldats à l'entrée de Troyes.
La verrière a été offerte par la confrérie de Sainte-Jule.
Elle occupe la même place qu'au moment où elle fut posée.
Selon le Corpus Vitrearum, la verrière est assez peu
restaurée.
À noter que les décollations de sainte Jule et de Claude se
trouvent au tympan de la baie
n°5.
|
|

Baie n°7, détail : L'«empereur» ( qui est le germain Claude
et non pas Aurélien)
donne à sainte Jule, pour compagnie, deux jeunes filles nobles.

|
«L'empereur converti feit faire un oratoire
Où la saincte faisoit prière meritoire»
|
|
|
LES VERRIÈRES DES BAIES HAUTES
DU CHŒUR (Baies 100 À 106)
|
|

Le chœur de l'église Saint-Martin-ès-Vignes : ici, le second niveau
et la voûte. |
|
Les parties
hautes du chœur de l'église Saint-Martin-es-Vignes
offrent un magnifique spectacle de grandes surfaces colorées
où les scènes historiées s'étalent sur trois ou cinq lancettes.
Dans la photo ci-dessus, on a de gauche à droite : la verrière
de la vie de saint Pierre (baie n°105),
celle de la vie de saint Jean-Baptiste (baie n°103),
et la verrière de l'Annonciation (baie n°101).
Tous ces vitraux ont été réalisés par la famille Gontier
et ses émules entre 1625 et 1640, garantissant ainsi une unité
de style. Chaque verrière est divisée en deux parties, séparées
par un étrésillon. Ici, l'étrésillon une ligne assez étroite
constituée d'oculi.
|
|
|
BAIE n°100 : VERRIÈRE DU
CALVAIRE, vers 1630-1635
|
|

Baie n°100 : verrière du Calvaire.
Vers 1630-1635.
Attribuée sans preuve à Linard Gontier le Jeune. |
|
Baie
n°100 : le Calvaire, vers 1630-1635.
Située dans la fenêtre d'axe, cette verrière haute de
5,80 mètres est souvent présentée comme une œuvre de
Linard Gontier le Jeune. Le Corpus Vitrearum
signale qu'aucun document ne permet de le confirmer.
Elle est datée des années 1630-1635.
Dans la Crucifixion (partie haute), le bon larron (Gesmas)
regarde le Christ, le mauvais larron (Dismas) porte
une épaisse moustache et regarde le sol. Au-dessus du
Christ, l'artiste a représenté le Père céleste, selon
la tradition, en bon vieillard à barbe blanche
Dans la partie inférieure, le bas de la lancette centrale
affiche les armoiries de François le Tartier, seigneur
du Clos le Roi, donateur du vitrail.
Toujours dans le registre du bas, le Pâmoison de la
Vierge est inspiré d'une gravure sur bois anonyme du
XVIe siècle. Dans la lancette de droite, des cavaliers
montent la garde. À gauche, des soldats jouent aux dés
la tunique du Supplicié.
|
|
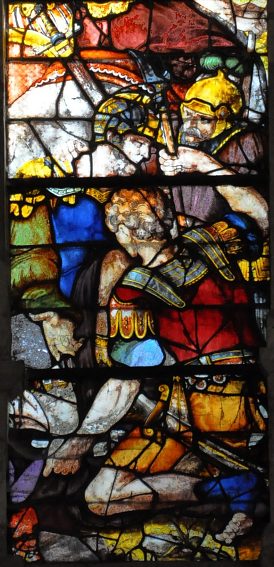
Baie n°100, détail : les soldats romains jouent
aux dés la tunique du Christ. |

Baie n°100, détail : la Vierge en pâmoison. |

Baie n°100, détail : un soldat, casqué comme un condotierre
du XVIe siècle, surveille la scène. |
|

Baie n°100, détail : Crucifixon
Vers 1630-1635. |
|
BAIE n°101 : VERRIÈRE DE
L'ANNONCIATION, vers 1630
|
|

Baie n°101, détail : l'Annonciation, dans le registre inférieur.
Vers 1630.
Un ange vert, dans un somptueux décor d'intérieur, porte le message
à Marie.
La tête de la Vierge est une restauration. |
|
Baie n°101
: l'Annonciation, vers 1630.
L'auteur de cette verrière n'est pas certain. Cependant, on
pourra remarquer qu'elle est très proche de l'art des Gontier.
La scène de l'Annonciation remplit le registre inférieur.
Elle est peinte dans un foisonnement d'architecture et d'objets
d'intérieur qui va du vestibule à colonnades jusqu'au lit
à baldaquin, en passant par un vase aux anses en forme de
sirènes.
Datée vers 1630, la verrière a été offerte par Jacques Vignier,
conseiller d'État, et Marie Mesgrigny, son épouse. Leurs armoiries
figurent dans les écus au bas du vitrail (donateur à gauche,
donatrice à droite).
Si le visage de l'archange est du XVIIe siècle, en revanche,
celui de la Vierge est une restauration du XIXe. Ce visage
en noir et blanc n'est-il d'ailleurs pas obtenu par l'impression
dans le verre de la photo d'une jeune femme ?
Le tympan est occupé par une Trinité entourée d'anges musiciens.
|

| Baie 101, détail : un vase
aux anses en forme de sirènes orne la chambre de la Vierge ---»»» |
|
 |
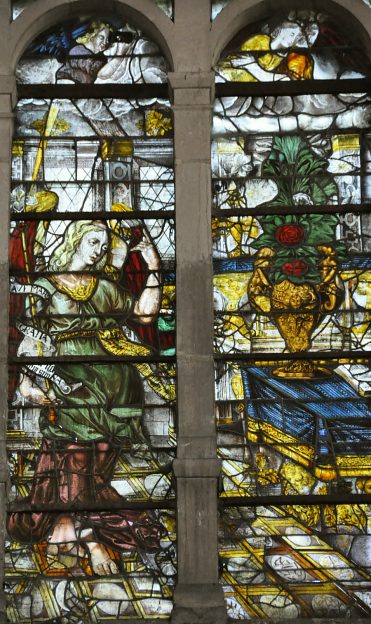
Baie n°101, détail : l'archange Gabriel dans l'Annonciation. |
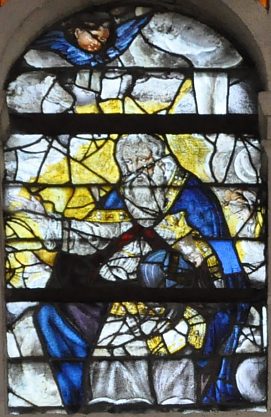
Baie n°101, détail : le Père Céleste dans la Trinité (tympan).
|

Baie n°101, détail : le visage restauré de la Vierge
n'est-il pas le résultat de l'impression
dans le verre d'une photo noir et blanc ?
|
|
BAIE n°102 : VERRIÈRE DE
LA VOCATION DE SAINT JACQUES, 1625
|
|
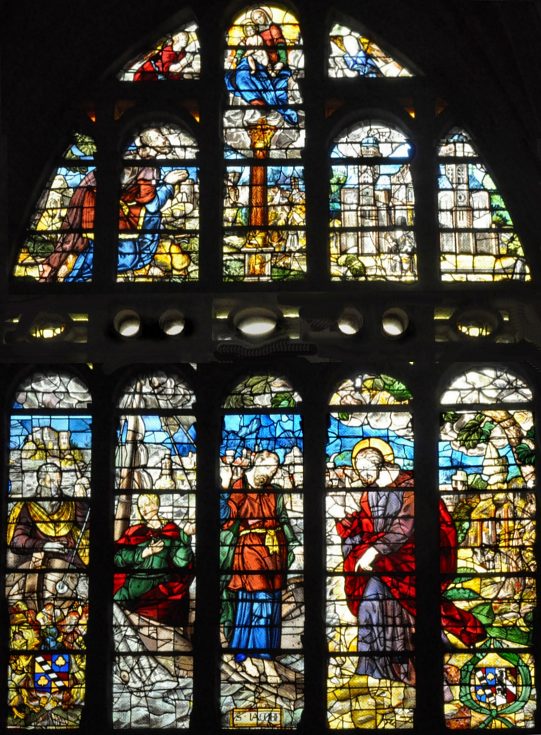
Baie n°102 : vocation de saint Jacques.
Atelier inconnu, 1625. |
|
Baie n°102
: Vocation de saint Jean, 1625.
L'auteur de ce vitrail est inconnu. Il n'est pas attribué
à l'atelier de Linard Gontier.
La scène principale présente Jacques et Jean appelés par Jésus.
Les deux frères sont accompagnés de Zébédée, leur père. Le
Corpus Vitrearum signale que la tête de Jean est celle
d'une femme. S'agit-il bien de lui ?
Au tympan : apparition de la Vierge del Pilar de Saragosse
à saint Jacques. La Vierge tenant son Enfant se tient sur
un pilier à Saragosse. Dans la partie droite, l'artiste a
peint l'église de la ville.
Les donateurs sont les mêmes que ceux de la baie 101
: Jacques Vignier, conseiller d'État, et Marie Mesgrigny,
son épouse. Les armoiries figurent dans les écus au bas du
vitrail (donateur à gauche, donatrice à droite).
|
|

Baie n°102, détail du tympan : la Vierge sur son pilier apparaît
à saint Jacques. |
|
BAIE n°103 : VERRIÈRE DE
LA VIE DE SAINT JEAN-BAPTISTE, 1630
|
|
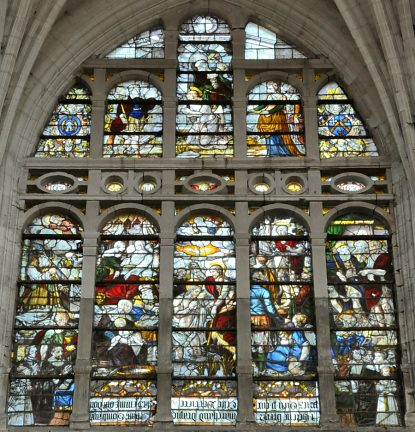
Baie 103 : Vie de saint Jean-Baptiste.
Linard Gontier, 1630. |
|
Baie n°103
: Vie de saint Jean-Baptiste, 1630.
Ce vitrail, de 1630, est attribué à Linard Gontier
père.
Registre du bas :
- Annonce à Zacharie (père de Jean-Baptiste) ; le donateur
et ses deux fils présentés par saint Jean l'Évangéliste ;
- Naissance de Jean-Baptiste ;
- Baptême de Jésus ;
- Prédication de Jean-Baptiste dans le désert ;
- Jean-Baptiste devant Hérode et Hérodiade ; la donatrice
et ses quatre filles présentées par sainte Hélène.
Registre du haut :
Décollation de saint Jean-Baptiste en présence d'Hérode et
de Salomé.
Les donateurs sont Jehan Gombault, marchand drapier et Hélène
Breyer, son épouse. Les armoiries figurent dans les écus du
haut du vitrail (donateur à gauche, donatrice à droite).
Les extraits en gros plan présentés ici sont parmi ceux qui
sont donnés par le Corpus Vitrearum comme les moins
restaurés.
|
|

Baie 103, détail : le Baptême du Christ.
Linard Gontier, 1630. |

Baie 103, détail : la Décollation de saint Jean-Baptiste. |

Baie 103, détail : l'Annonce à Zacharie.
En bas : le donateur et ses deux fils présentés par saint Jean. |

Baie 103, détail : Jean-Baptiste devant Hérode et Hérodiade.
En bas : la donatrice et ses quatre filles. |
|
|
BAIE n°104 : VERRIÈRE DES
SAINTS, Fin du XVIe siècle, 1624-1626
|
|
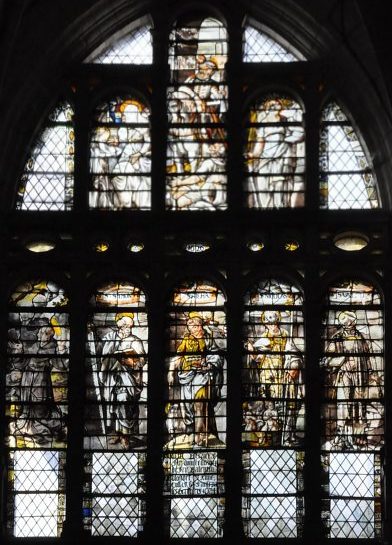
Baie 104 : les Saints.
Atelier Gontier, sans doute dû à un fils de Linard, 1624-1626.

|
Baie n°104
: les Saints, fin du XVIe siècle, 1624-1626.
Cette verrière, peinte en grisaille et jaune d'argent, est
attribuée à l'atelier des Gontier, sans doute à l'un
des fils de Linard. Elle a été offerte par les héritiers de
Valentin Blondet et de son épouse Anne Cossart.
Le registre du bas reçoit cinq grandes figures avec inscriptions
nominatives, inspirées d'une gravure sur bois anonyme du XVIe
siècle.
De gauche à droite : François d'Assise (restauré), Simon,
Jean-Baptiste, Nicolas et Valentin. Étaient-ce les prénoms
des donateurs ?
À l'étage supérieur, une Charité de saint Martin sépare
une Éducation de la Vierge (restaurée au XXe siècle)
et une sainte Jule.
|
|

Baie 104, détail : la Charité de saint Martin.
Baie 104, détail :
saint Jean-Baptiste. ---»»»
Le visage est apparenté avec celui de la baie
17. |
|
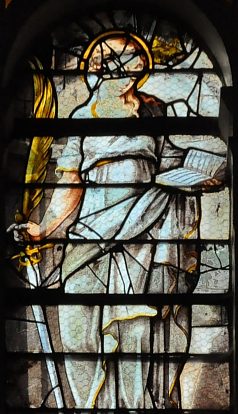
Baie 104, détail : sainte Jule et
l'épée de son martyre. |
 |

Baie 104, détail : les cinq Saints du registre inférieur.
De gauche à droite : François d'Assise, Simon, Jean-Baptiste, Nicolas
et Valentin. |
|
BAIE n°105 : VERRIÈRE DE
LA VIE DE SAINT PIERRE, 1634 - Linard Gontier le Jeune
|
|
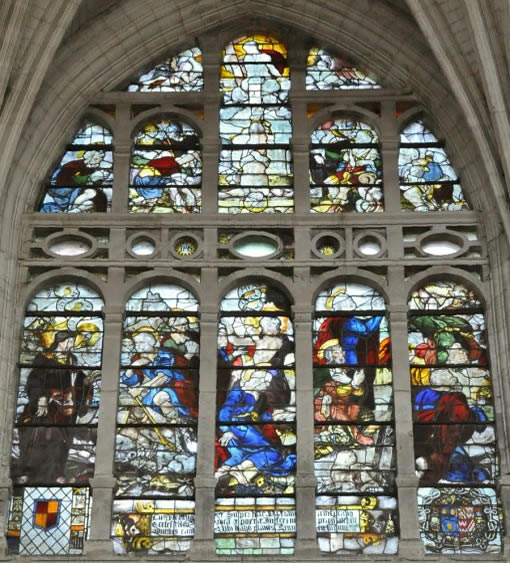
Baie n°105 : Vie de saint Pierre, 1634.
Attribué à Linard Gontier le Jeune. |
|
Baie
n°105 : Vie de saint Pierre, 1634.
Les archives ont conservé l'historique de ce vitrail.
D'abord commandé par Pierre le Courtois, conseiller
du roi au baillage, il a été réalisé, aux frais de sa
veuve Marguerite de Villeprouvée, par Linard Gontier
le Jeune (marché du 14 novembre 1633)
Registre inférieur : 1-2) Vocation des saints Pierre
et André ; 3) Apparition du Christ à Pierre au lac de
Tibériade ; 4) Pierre et Paul à genoux ; 5) Chute de
Simon le magicien.
Au bas de la cinquième lancette se trouve l'écu armorié
de la donatrice entouré d'une cordelette de veuve et
d'un chapeau de triomphe.
Registre supérieur : 1-2) Saint Pierre, dans sa prison,
est gardé par des soldats ; 3-4) Crucifixion du
saint sur l'ordre de Néron en présence d'un juge juif
et des romains. Au centre, au-dessus : Christ du Jugement.
L'ensemble s'est mal conservé, mais a été peu restauré.
|
|

Baie n°105, détail : la Chute
de Simon le Magicien.
|

Baie n°105, détail : Néron et un juge
juif assistent à la Crucifixion
de saint Pierre la tête en bas.
|
|

Baie n°105, détail : Vocation de saint Pierre et de saint André.
Attribué à Linard Gontier le Jeune, 1634. |
|
BAIE n°106 : VERRIÈRE DE
LA PASSION, vers 1650-1660
|
|
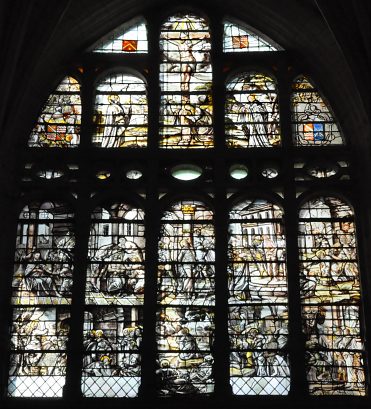
Baie n°106 : Verrière de la Passion.
Artiste inconnu, vers 1650-1660.
Partie basse :
Entrée de Jésus à Jérusalem ; Lavement des Pieds ; Agonie au jardin
des Oliviers ; Baiser de Judas ; Comparution devant Pilate ;
Christ aux outrages ; Couronnement d'épines ; Flagellation ; Ecce
Homo ; Portement de croix. |
|
Baie n°106
: la Passion, ves 1650-1660.
Cette verrière, dont l'artiste est inconnu, est un don de
deux couples apparentés : Louis de Villeprouvée et Marie Angenoust
; Pierre Poterat et Marie de Villeprouvée.
La verrière, en grisaille avec jaune d'argent et sanguine,
comprend deux étages séparés par un étrésillon ajouré.
L'étage du bas présente deux registres illustrant les étapes
de la Passion depuis l'entrée de Jésus dans Jérusalem au Portement
de croix et la rencontre avec Véronique.
L'étage du haut est un Calvaire. Selon la tradition, Jésus
est entouré de la Vierge et de saint Jean. À gauche et à droite
: les écus armoriés des familles de Villeprouvée et Angenoust.
Notons que dans la partie basse, trois panneaux incomplets
ont été prolongés par des zones losangées.
|
|

Baie n°106, détail : Jésus est flagellé. |

Baie n°106, détail : Jésus comparaît devant Pilate.
|

Baie n°106, détail :Agonie de Jésus au jardin des Oliviers.
Dans la partie gauche, les soldats de Caïphe, guidés par Judas, s'apprêtent
à arrêter Jésus. |

Baie n°106, détail : Couronnement d'épines. |
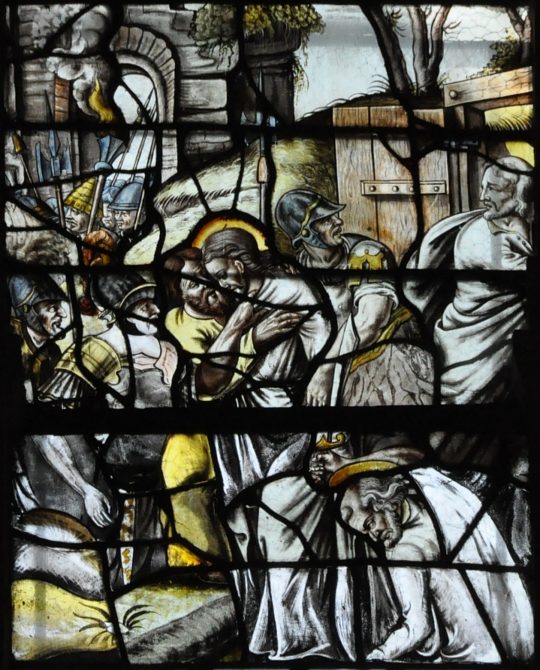
Baie n°106, détail : le Baiser de Judas.

L'artiste a revêtu, par erreur, les soldats de Caïphe de la tenue
de la Légion romaine.
Ou bien il croyait que Jésus avait été arrêté par des légionnaires
romains.

| Baie n°106, détail
: Marie-Madeleine au pied de la croix. ---»»» |
|
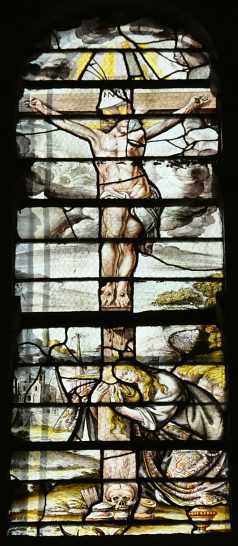 |
|
|

Partie haute de l'orgue de tribune. |

L'orgue de tribune de Saint-Martin-ès-Vignes a été restauré en 1970.
Le buffet principal date des années 1534-1539.
C'est le plus ancien orgue de Champagne.
| «««--- Les ornementations
du buffet sont de style Renaissance. |
|

|

La nef et l'orgue de tribune vus du chœur.
Les statues accrochées sur les piles remplacent, dans les parties
hautes, les chapiteaux absents. |
Documentation : «Troyes en Champagne» de Didier
Guy et Patrick Dupré, Éditions La Maison du Boulanger, 2009
+ «Les vitraux de Saint-Martin-es-Vignes» de Françoise Bibolet, La
Renaissance, Troyes, 1959
+ «Les vitraux de Troyes, XIIe-XVIIe siècle» de Danielle Minois (Guides
Acanthe)
+ «Corpus Vitrearum, Les Vitraux de Champagne-Ardenne», Éditions du
CNRS, 1992
+ «Congrès archéologique de France tenu à Troyes en 1853»
+ «Congrès archéologique de France tenu à Troyes et Provins en 1902». |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|