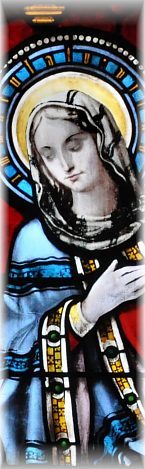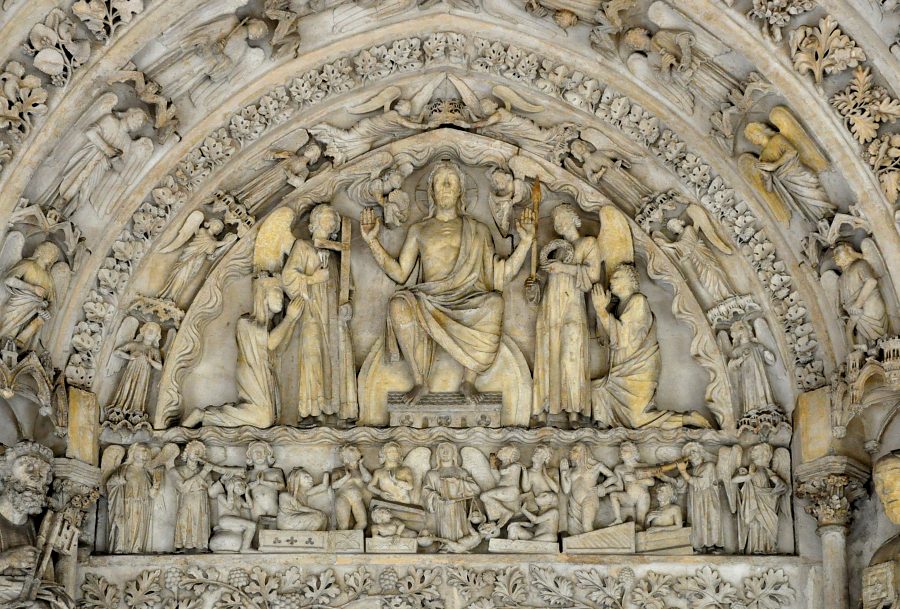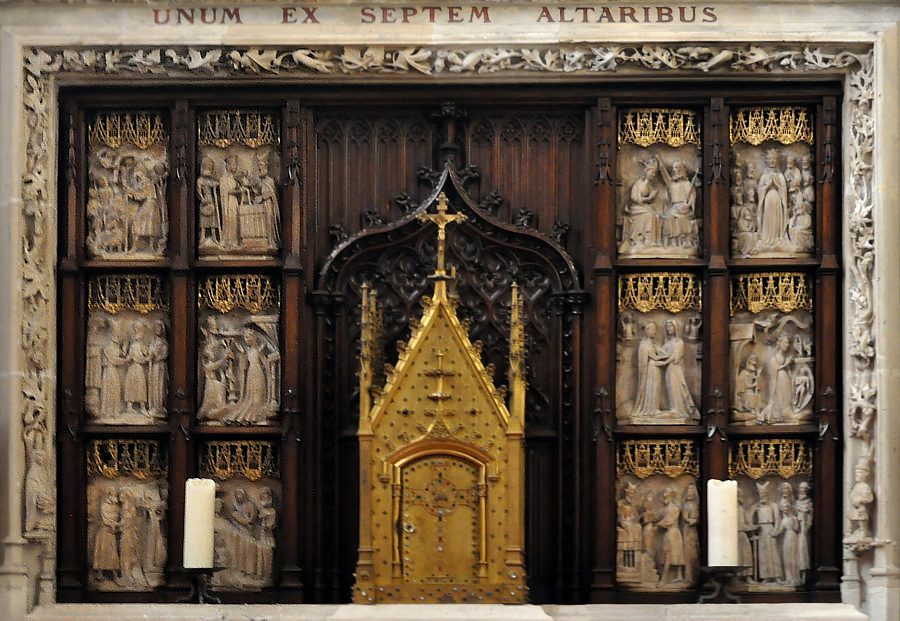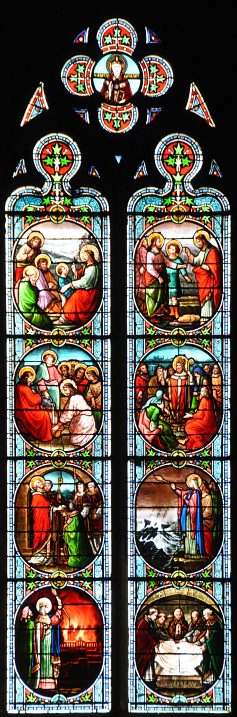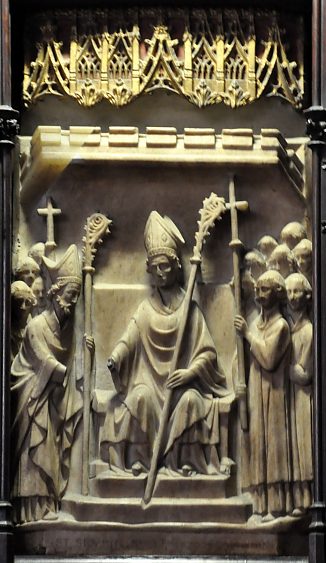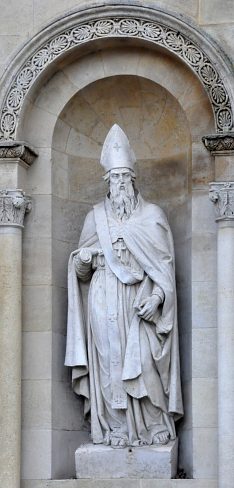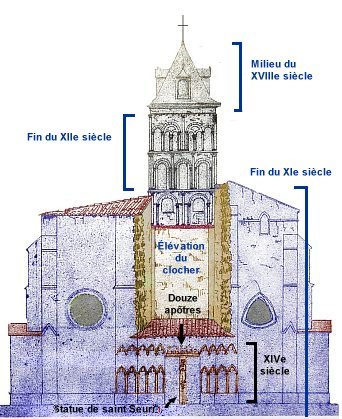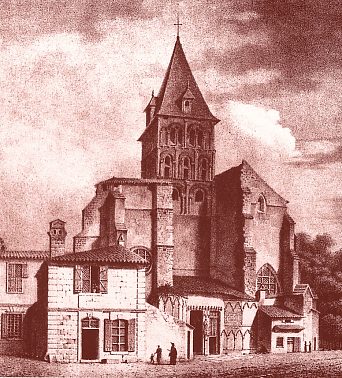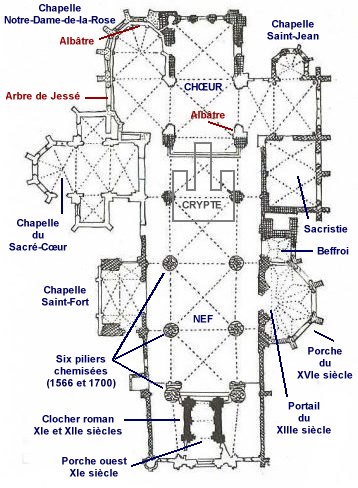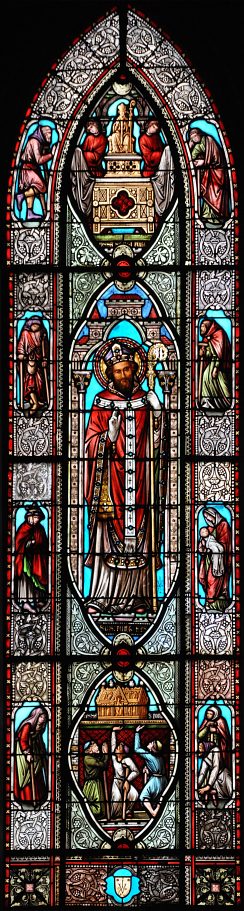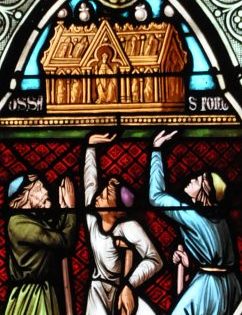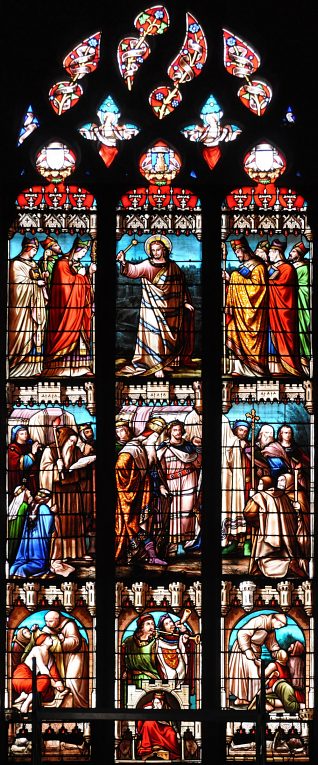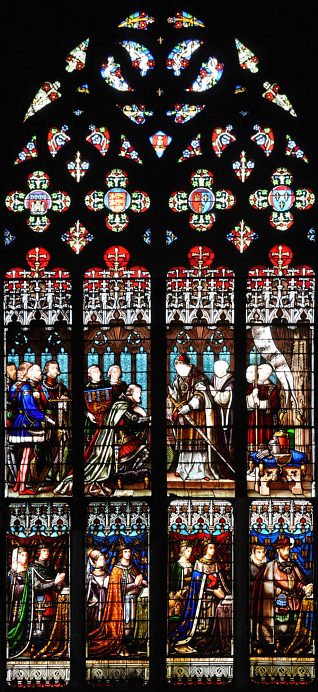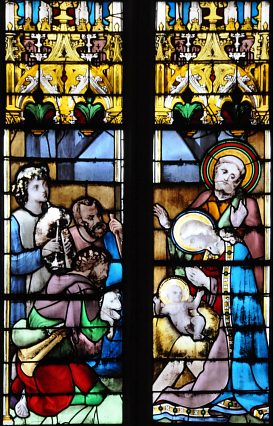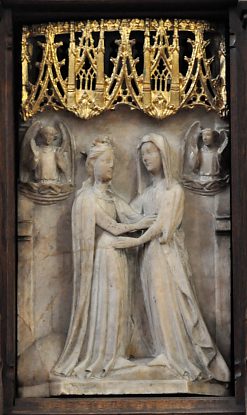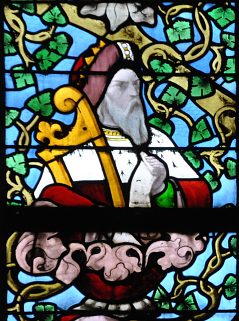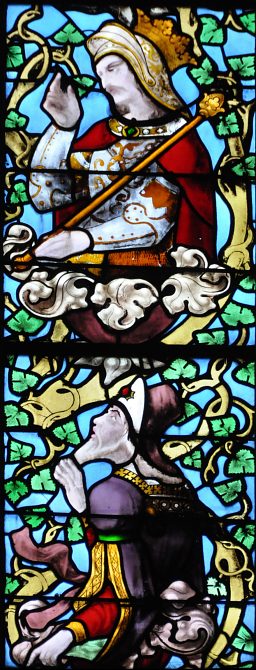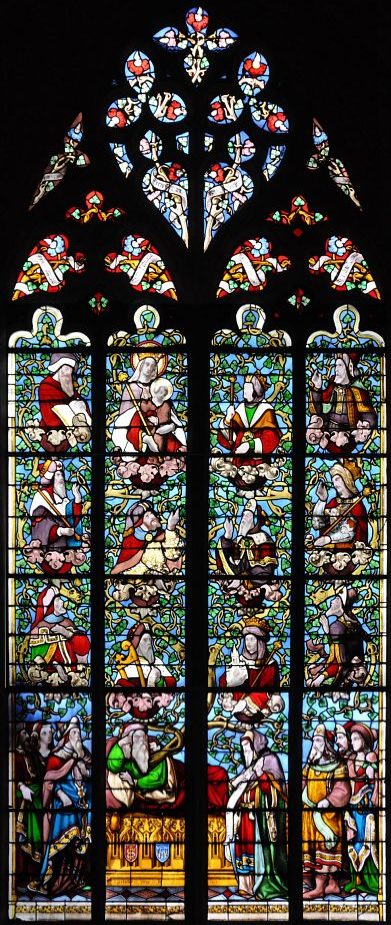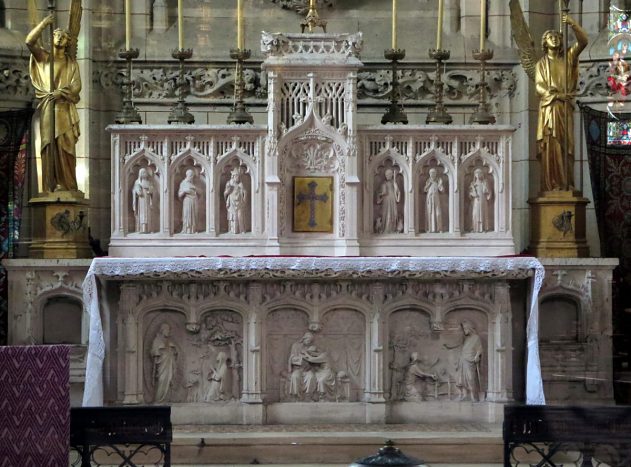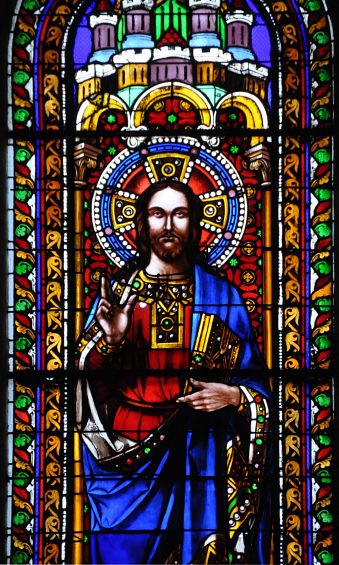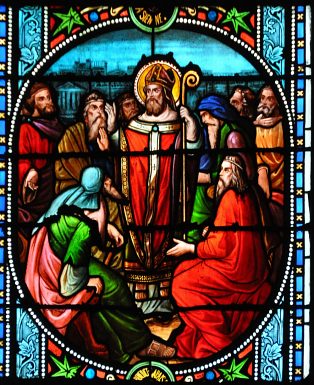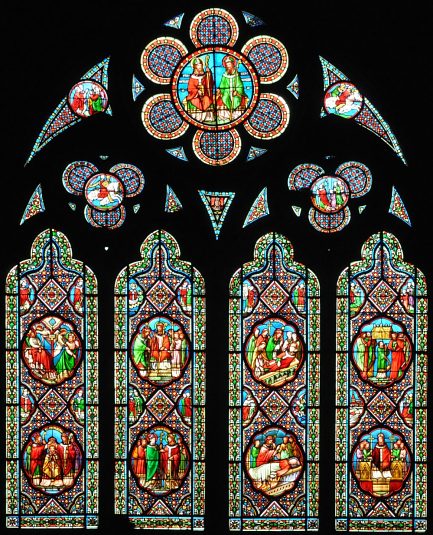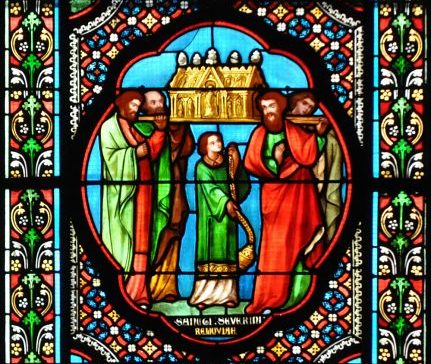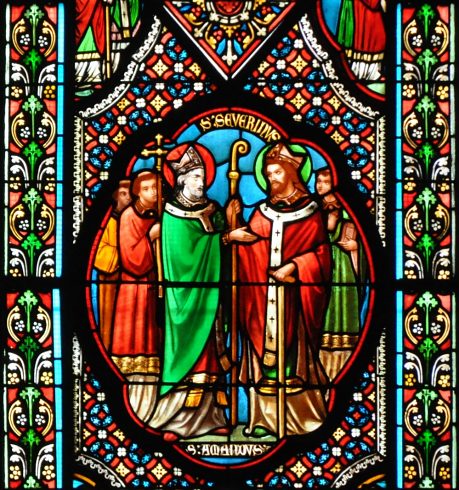|
|
 |
 |
La basilique Saint-Seurin est l'une des
plus anciennes églises de Bordeaux
et peut-être celle qui a subi le plus de transformations architecturales
au cours des âges. La rivalité de son chapitre de chanoines avec
celui de la cathédrale Saint-André
scande toute l'histoire de la ville. Qui aura la prééminence ?
Lequel des deux édifices a été la première église de Bordeaux,
et, plus encore, son premier siège épiscopal ?
L'histoire démarre avec un cimetière gallo-romain, bientôt lié à
la présence de l'église Saint-Étienne, la plus ancienne de la ville,
détruite à la Révolution. Là furent déposés, au Ve siècle, les tombeaux
d'Amand et de Seurin, deux évêques de la communauté chrétienne.
Autour de ces tombes la dévotion se développe. Un pèlerinage s'ensuit.
Au VIe siècle, une petite chapelle funéraire est aménagée. Elle
est transformée au XIe siècle en une véritable église avec un chapitre
de chanoines. De cet édifice, il nous reste le porche
occidental roman et une partie du clocher.
Aux XIIe et XIIIe siècles, on entreprend, en style gothique, le
gros œuvre de l'église actuelle. Les travaux commencent par le chevet,
puis s'étendent vers l'ouest. Sur le mur sud, on édifie un beffroi
pour mieux surveiller les alentours car la construction s'élève
en dehors de la muraille qui protège la cité. Heureusement, les
menaces que représentent les pillards et les armées ennemies ne
se concrétiseront pas. Bientôt, le chapitre va promouvoir le culte
de saint Fort, un martyr chrétien peut-être imaginaire. Les pèlerinages
redoublent. Une entrée solennelle est bâtie sur le mur méridional,
vers la nécropole, ornée d'un grand portail
gothique où abondent les bas-reliefs et les statues.
Le chapitre des chanoines de Saint-Seurin est riche d'une assise
foncière étendue à tout le Bordelais. La multiplicité de ses droits
seigneuriaux lui permet de tenir tête au chapitre de Saint-André.
Et de construire.
Au XIVe sont ajoutées les premières chapelles : Saint-Jean,
Notre-Dame
de Bonne Nouvelle, Sainte-Catherine (devenue sacristie). La
chapelle Notre-Dame-de-la-Rose,
joyau de l'édifice, suivra au siècle suivant.
Au XVIe siècle, le portail sud est protégé par un porche, tandis
qu'une tour hexagonale est ajoutée au beffroi.
En 1566, une partie des voûtes ouest s'effondre ; et, en 1698, une
plus grande partie encore. L'ingénieur en charge de la restauration
va employer les grands moyens pour consolider l'édifice : un pilier
avait déjà été renforcé par une ceinture de pierre après 1566, cinq
autres le sont à leur tour ; de plus, le sol est surhaussé d'environ
trois mètres, ce qui enfouit complètement la crypte. L'atmosphère
intérieure de l'église est perdue. Désormais, c'est une légère impression
de lourdeur qui régnera avec des voûtes reposant sur des piliers
trop courts.
En 1828, une nouvelle façade ouest est élevée sur les dessins de
l'architecte Alexandre Poitevin. Deux nouvelles chapelles sont ajoutées
au nord : Saint-Fort
en 1847 ; la chapelle
du Sacré-Cœur en 1875.
L'église Saint-Seurin est devenue basilique en 1873.
Notons que jadis les bâtiments du chapitre se regroupaient autour
du cloître, juste au nord de l'église. L'urbanisation a tout transformé
: le côté nord de l'édifice est désormais inaccessible.
La crypte, fermée au public, ne figure pas dans cette page. Elle
pourrait être rouverte en 2028 après de futurs travaux de rénovation.
Quant aux vitraux
de la basilique, ils ont tous été créés par l'atelier bordelais
Joseph Villiet dans les années 1850-1860. Certains illustrent des
événements propres à l'histoire de la basilique.
|
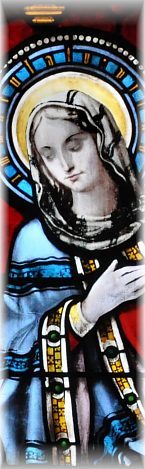 |

La nef et le chœur
de la basilique Saint-Seurin vus depuis l'entrée.
À la suite de l'effondrement partiel des voûtes en 1698, la nef a
été surhaussée de trois mètres.
À cette occasion, les piliers gothiques du premier plan ont été renforcés
par une ceinture de pierre. |
|
|

Le côté sud de la basilique Saint-Seurin vu depuis la place des Martyrs
de la Résistance. |
Ce côté présente des élévations
de différentes époques : clocher roman avec étages du XIIe siècle,
porche Renaissance,
beffroi à base romane avec partie hexagonale du XVIe siècle
; murs goutteraux du XIIIe siècle.
Le côté nord de la basilique, entouré de constructions particulières,
est totalement inaccessible. |
|
|
Architecture
extérieure.
Issue d'un monument médiéval roman, la basilique Saint-Seurin
a connu de multiples transformations et adjonctions.
Si le côté nord, bordé de bâtiments et de jardins privés,
est invisible et inaccessible, le côté sud, en revanche,
s'offre à l'œil du visiteur (photo ci-dessus). Il s'y
mêle des éléments romans, gothiques et Renaissance.
Cette longue élévation, trop marquée par les ajouts
et les transformations, ne présente aucune harmonie.
«Ses lignes architecturales sont sans envolée et sans
souplesse», écrit Gabriel Loirette en 1939 pour le Congrès
archéologique de France à Bordeaux
et Bayonne.
Relèvent de l'art roman : le clocher carré occidental
(à gauche sur la photo ci-dessus) et la base du beffroi
(au centre de la photo). Tout le reste est gothique,
bâti entre la fin du XIIe et la fin du XIIIe siècle.
Le porche central, qui a retrouvé une coloration très
claire à la suite d'une restauration récente, est un
ajout du XVIe siècle pour protéger le portail
du XIIIe caché derrière.
À l'ouest, le clocher roman, surélevé d'un dernier étage
à la fin du XIIe siècle, n'a été coiffé d'un pavillon
à quatre pans en ardoises qu'au milieu du XVIIIe..
Quant au beffroi roman, il a été surélevé de deux étages
hexagonaux au XVIe siècle. Son étrange chapeau en deux
parties a été ajouté au XVIIIe siècle, lors d'une restauration.
Deux éléments extérieurs retiennent l'attention : la
façade
occidentale moderne néo-romane (photo ci-contre)
et le portail
gothique sud du XIIIe siècle.
|
|

Statue de sainte Catherine d'Alexandrie
dans un coin sud-ouest de la basilque.
XVe siècle. |
|
La
façade occidentale néo-romane (2/2).
---»» Ils constatent ensuite : «Mais, soit réflexe incontrôlable,
soit volonté délibérée de corriger un goût trop barbare,
Poitevin rétablit les apparences d'une ordonnance classique.»
En effet, les entablements s'y succèdent ! «Porté
par de fines colonnes jumelées, continuent-ils, le bandeau
qui couronne le premier niveau fait office d'entablement
; au second niveau, la balustrade (...) joue un rôle
identique.» On obtient ainsi «l'équivalent d'un portique
à ordres superposés».
Le constat ne s'arrête pas là puisque nos deux auteurs
ajoutent que les statues de saint Amand et de saint
Seurin «restent totalement étrangères à l'esthétique
médiévale».
Quant au tympan, non seulement son bas-relief se développe
en frise «en contradiction totale avec la tradition
romane des compositions centrées», mais l'art roman
saintongeais n'orne pas ses tympans d'un bas-relief !
En exemple, on pourra se reporter à l'église Saint-Eutrope
et à l'abbaye
aux Dames à Saintes. On constatera que le tympan
du portail principal est tout simplement le plein cintre
qui termine la porte en bois !
D'autre part, Dominique Maggesi a produit un bas-relief
(donné ci-contre), très beau certes, mais dont le style
est totalement moderne.
Ainsi, pour respecter la règle de l'unité de style et
donc s'accorder avec le style roman du clocher, Poitevin
a fait le choix d'un mauvais néo-roman. Robert Coustet
et Marc Saboya concluent leur analyse de sévère manière
: «L'évidente maladresse de son intervention à Saint-Seurin
reflète son mépris instinctif pour les formes d'un temps
“d'ignorance et de grossièreté”.»
Dans son Histoire du vandalisme, parue en 1958,
l'historien Louis Réau ne cite pas l'église Saint-Seurin
et sa façade. Est-ce un oubli ? Ou l'impression
qu'à ses yeux l'ancienne façade ne méritait pas d'être
conservée ?
|
|
|
 |
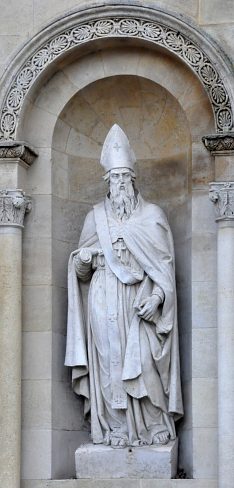
Statue de saint Seurin sur la façade ouest.
(Sculpteur Dominique Maggesi).

«««--- La façade ouest
a été bâtie
par l'architecte Alexandre Poitevin
de 1828 à 1829. |
|
|
La
façade occidentale néo-romane (1/2).
Un dessin d'époque, donné par Robert Coustet et
Marc Saboya dans leur ouvrage Bordeaux, le
temps de l'histoire (éditions Mollat, 2000),
présente la façade ouest de Saint-Seurin avant
la transformation drastique menée par l'architecte
Alexandre Poitevin en 1828.
Un autre dessin d'époque présente l'église de
biais avec le bas de la façade caché par de «pauvres
échoppes dont les toits ne s'élevaient guère au-dessus
des buissons qui bordaient les chemins effondrés
de ce faubourg» (Charles Marionneau, Description
des œuvres d'art dans les édifices de Bordeaux,
1861) On peut ainsi mieux apprécier le côté totalement
disgracieux de cette façade qui n'a, peut-on penser,
jamais été achevée.
Toute l'élévation du clocher, jusqu'au premier
étage fenestré inclus, date de la fin du XIe siècle.
Les deux niveaux supérieurs sont des ajouts de
la fin du XIIe. Enfin, le sommet et le couronnement
en ardoise sont du milieu du XVIIIe siècle.
Au bas de cette ancienne façade, dans l'ouverture
du porche bâti au XIVe, le trumeau recevait une
statue de saint Seurin revêtu de ses ornements
épiscopaux. Dans le mince linteau qui dominait
l'ouverture, les douze apôtres étaient sculptés
assis tenant des phylactères. De part et d'autre
de la porte, une double arcature ornait le mur.
Il est aisé de comparer cette ancienne façade
du XIVe siècle avec la création néo-romane de
1828, fruit de l'imagination d'Alexandre Poitevin,
architecte de la ville de Bordeaux.
En 1939, Gabriel Loirette, pour le Congrès
archéologique de France, n'apprécie guère
cette création de 1828 qu'il décrit comme conçue
«dans le style lourd et prétentieux du néo-roman».
Avant lui, en 1861, Charles Marionneau ne l''apprécie
pas non plus et en vient presque à regretter la
précédente ! Les administrateurs, confie-t-il,
ont voulu la raccorder au style roman du vieux
porche et de la tour du clocher. Ils ont donné
libre cours à un «zèle ardent» qui les persuade
que leur façade néo-romane sera plus artistique
que la précédente. Mais que sait-on du goût des
générations futures ? s'interroge Marionneau.
Toutefois, il ne jette la pierre à personne. En
1828, reconnaît-il, les disciples de Viollet-le-Duc
ne sont pas encore à l'œuvre et l'on ne peut exiger
de Poitevin, «élève de l'école de l'Empire», la
«fidélité scrupuleuse» que l'on exigera de la
nouvelle école.
En 1952, l'abbé Brun dans son ouvrage Les églises
de Bordeaux, voit dans cette façade «un spécimen
assez curieux et assez réussi du néo-roman». C'est
le coup d'œil d'un non-spécialiste.
En revanche, en 2000, Robert Coustet et Marc Saboya
apportent une analyse critique enrichissante.
Ils font d'abord remarquer que Poitevin, «mal
à l'aise avec le style roman», livre un schéma
qui s'inspire des façades saintongeaises (comme
celle de l'église Sainte-Croix)
: le portail est encadré de deux fausses portes
plus petites (devenues d'ailleurs des niches pour
statues) ; l'ensemble est surmonté d'une arcature
; le style roman étant assuré par le plein cintre,
par des voussures ornées d'entrelacs et par une
bande lombarde.
---»» Suite 2/2
à gauche.
|
|
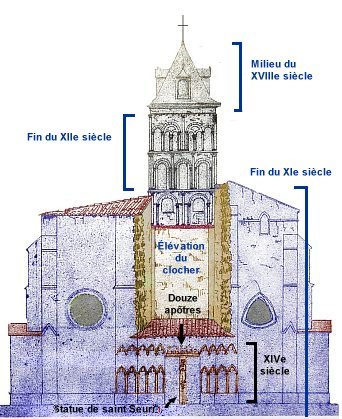
La façade occidentale romane avant les travaux d'Alexandre
Poitevin.
Dessin réalisé d'après un dessin d'époque (source
: Bordeaux, le temps de l'histoire de Robert
Coustet et Marc Saboya). |
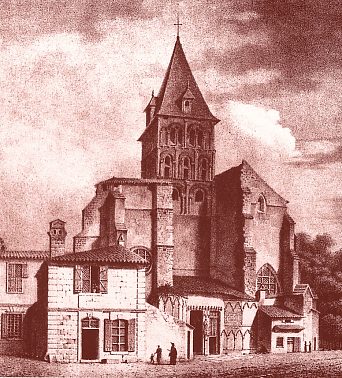
La façade occidentale de Saint-Seurin au début du
XIXe siècle. |
Visiblement,
le dessinateur a exagéré le recul
du clocher.
On a l'impression qu'il s'élève au-dessus
de la première travée de la nef. |
|
On
peut penser qu'en 1828 l'architecte Alexandre
Poitevin n'a pas dû éprouver beaucoup de
scrupules à modifier totalement cette façade
qui fait quand même une piètre
impression.
Dans son Histoire du vandalisme,
publiée en 1958, Louis Réau ne parle pas
de la basilique Saint-Seurin.
|
|
|
|

«Réception de saint Seurin par saint Amand»
Bas-relief de Dominique Maggesi (1831) dans le tympan de la
façade ouest. |
|

Les douze apôtres de l'ancien linteau sont présentés
au Musée
d'Aquitaine de Bordeaux.
Fin XIIIe-début XIVe siècle. |

Modillons de la fin du XIe siècle sur le clocher roman qui domine
la façade ouest.
Les deux étages supérieurs de ce clocher sont du XIIe siècle.
Sa partie terminale a été rajoutée au milieu du XVIIIe siècle. |
| LE PORTAIL MÉRIDIONAL
DU XIIIe SIÈCLE |
|

Sur le côté sud, le portail du XIIIe siècle est la principale œuvre
d'art qui orne l'architecture extérieure de la basilique. |

Le portail du XIIIe siècle et sa voûte en étoile. |

Parmi les statues du portail du XIIIe siècle, la Synagogue est
représentée sous l'aspect d'une femme aux yeux bandés. |
|
Le
portail du XIIIe siècle (2/2).
---»» Dès lors, pour rappeler aux Juifs qui seraient appelés à passer par-là leur faute
de ne pas voir le Messie en la personne de Jésus-Christ,
quel endroit plus approprié que le portail sud de Saint-Seurin ?
Gabriel Loirette rappelle que ces deux fameuses statues
se trouvent dans les cathédrales de Paris, de Reims
et de Strasbourg, mais surtout dans la vallée du Rhin
et en Allemagne, particulièrement à Worms et à Bamberg.
Terminons par une remarque sur l'agencement du portail.
En 1966, dans son article sur Saint-Seurin pour le Dictionnaire
des églises de France, Pierre Dubourg-Noves juge
ce portail «particulièrement maladroit».
En effet, selon le schéma traditionnel, les colonnettes
de la partie basse d'un portail s'élèvent jusqu'à des
chapiteaux où viennent s'accrocher les voussures tombantes
de l'archivolte. Ce jumelage idéal colonnettes-archivolte
se voit au portail de la cathédrale
de Saintes ou à celui de l'église Saint-Pallais
dans la même ville.
Dans le portail de Saint-Seurin, la liaison colonnettes-archivolte
s'effectue par des statues, elles-mêmes séparées par
des colonnettes en délit. Ce qui crée une ornementation
à la limite de la surcharge.
|
|
|
|
Le
portail du XIIIe siècle (1/2).
C'est le joyau extérieur de la basilique. À tel point
que le XVIe siècle a jugé utile de le protéger par un
porche coiffé d'une voûte en étoile (photo ci-contre).
Le portail comprend une porte centrale, surmontée d'un
tympan et d'une archivolte, et de deux arcades adjacentes
recevant, quant à elles, statues, tympan et archivolte.
Les niches abritent les statues des douze apôtres et,
aux extrémités, celles de l'Église
triomphante et de la Synagogue.
«Tout cet ensemble a été si copieusement restauré vers
1844 qu'on ne peut l'interroger qu'avec beaucoup de
méfiance», confie l'abbé Brun en 1952 dans Les églises
de Bordeaux.
Néanmoins, les scènes des tympans retiennent l'attention.
Le tympan central resplendit d'un très beau Jugement
dernier accompagné, dans le bandeau inférieur, d'une
résurrection des morts. Au centre du bandeau, l'archange
Michel pèse les âmes. Aux extrémités, des anges sonnent
de la trompette. Les voussures alternent décoration
florale, chérubins et anges sous dais. Dans sa Description
des œuvres des édifices bordelais, Charles Marionneau,
en 1861, voit dans cette résurrection un rappel assez
exact du bas-relief du même thème au portail occidental
de la cathédrale
d'Amiens.
Parmi les six voussures, trois sont occupées par des
êtres célestes portant des ailes. En 1939, Gabriel Loirette,
pour le Congrès archéologique de France, y décèle
les trois degrés de la hiérarchie céleste du Pseudo-Denys
: Séraphins-Chérubins-Trônes ; Dominations-Vertus-Puissances
; Principautés-Archanges-Anges.
Le tympan gauche représente la Visite
des saintes femmes au tombeau. Au centre, un ange
garde le tombeau vide, tandis que les deux arcades latérales
abritent, d'un côté, les soldats romains endormis et,
de l'autre, les saintes femmes. Dans la voussure du
dessus, deus anges portent l'Agneau mystique tenant
la croix en pal. Au-dessus, des vieillards tiennent
des parchemins ou des phylactères.
Le tympan droit représente la Réception
de saint Seurin par saint Amand, précédée du songe
de saint Amand. Notons que cette interprétation ne fait
pas l'unanimité. Dans Aquitaine gothique (Picard,
1992), Jacques Gardelles signale qu'elle a été donnée
au XIXe siècle par Mgr Cirot de la Ville, historien
de l'église, mais qu'elle «ne repose sur rien de solide».
Mais qu'y voir d'autre ?
Les deux statues des extrémités des arcades, la Synagogue
et l'Église
triomphante, présentent un intérêt historique certain.
La Synagogue
prend la forme d'une femme honteuse dont les yeux
sont bandés ; l'Église
triomphante est représentée par une femme, au visage
réjoui, qui tient le sceptre de la foi. Gabriel Loirette
(Congrès archéologique de France, 1939) rappelle
que, selon la théorie de Viollet-le-Duc, les édifices
chrétiens bâtis au XIIIe siècle abritaient ces deux
statues dans les villes peuplées de Juifs, et uniquement
dans celles-là. Or le côté sud de la basilique borde
un ancien cimetière qui se poursuivait, toujours au
sud, par le quartier juif de Bordeaux.
Ce dernier se trouvait sur le plateau d'une colline,
appelé le mont Judaïc. La très longue rue Judaïque
actuelle, qui s'étale du boulevard du Président Wilson
jusqu'à la Place Gambetta, en garde le souvenir.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Groupe de statues dans le portail du XIIIe siècle.
La partie basse a été refaite à l'identique au XIXe siècle. |

Saint Jacques le Majeur et saint Simon tenant la scie
de son martyre. |
|

Saint André et saint Pierre
dans le portail du XIIIe siècle. |
|

L'Église triomphante tient le sceptre de la foi.
|
|
|
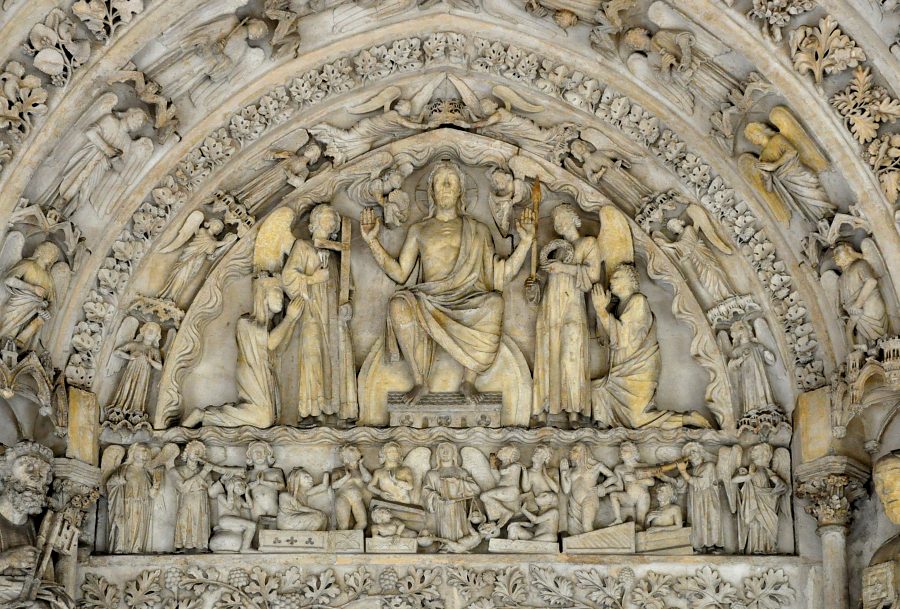
Tympan central du portail du XIIIe siècle : Résurrection et Jugement
dernier.
Le Christ en majesté préside à la pesée des âmes par l'archange saint
Michel.
Aux extrémités, la jonction entre la colonnnette et la deuxième voussure
(à thème floral) est particulièrement maladroite. |

La résurrection des morts : l'archange Michel pèse les âmes.
Dans le bas-relief, un diable essaie de faire pencher la balance de
son côté. |
|
L'église
Saint-Seurin est-elle la plus ancienne de Bordeaux ?
Le chapitre de la basilique s'est longtemps querellé avec
celui de la cathédrale : à qui la gloire d'avoir été la première
église de Bordeaux,
Saint-André ou Saint-Seurin ?
Nombre d'historiens jusqu'à nos jours penchent pour Saint-Seurin.
En 2002, des fouilles sur les places Pey-Berland et Jean-Moulin
ont mis à jour l'abside d'un monument de l'Antiquité tardive
(donc tout proche de la cathédrale actuelle).
Il est probable que ce soit là un élément du premier groupe
épiscopal de la cité, donc de la cathédrale primitive. En
conséquence, si le site de Saint-Seurin est toujours regardé
comme le plus ancien de Bordeaux,
son statut de premier édifice épiscopal est à présent grandement
remis en question. Source : «L'esprit
des bâtisseurs», édité par les Amis d'Ars et Fides Bordeaux,
2011, article de Sandrine Lavaud.
|
|

«La visite des saintes femmes au tombeau».
Tympan gauche du portail du XIIIe siècle avec les voussures de son
archivolte.
En bas : les soldats romains endormis ; l'ange auprès du tombeau vide
; les saintes femmes. |

«Saint Amand rêvant de l'arrivée de saint Seurin» et «la Réception
de saint Seurin par saint Amand»
Tympan droit du portail du XIIIe siècle. |
|
Le rêve
de saint Amand.
Le bas-relief du tympan de l'arcade droite est communément
décrit comme étant e rêve de saint Amand voyant l'arrivée
de saint Seurin pour le remplacer sur le siège épiscopal de
Bordeaux.
Sur ce sujet, citons l'extrait donné par Charles Marionneau
d'après Grégoire de Tours :
Amandus, peu satisfait de la ferveur de son troupeau, et
s'accusant lui-même de ce qui manquait à sa famille spirituelle,
était pris quelquefois d'un découragement profond qui lui
faisait considérer la vie et l'épiscopat comme un intolérable
fardeau. La Providence vint miraculeusement à son aide. Le
saint évêque est averti en songe de l'arrivée d'un collaborateur
inconnu, qui doit partager ses fatigues et ranimer ses espérances.
Déjà il approche ; dans quelques instants il frappera à sa
porte. Réveillé par cette vision, le vieillard se lève avec
une incroyable allégresse. «Mon bâton, dit-il, allons au-devant
de notre hôte» ; et il se dirige vers le chemin par lequel
arrivait le céleste voyageur. Ils sont bientôt en présence,
et, avant d'avoir échangé une parole, ils se précipitent dans
les bras l'un de l'autre, comme deux vieux amis charmés et
attendris de se revoir, et se nomment chacun par leur nom.
|
|
| LE NARTHEX OU
COULOIR-PORCHE ROMAN |
|

|

Chapiteau roman dans le narthex.
«««--- Le narthex de
la basilique
est l'ancienne entrée romane
du XIe siècle. |
|

Chapiteaux romans dans le narthex (XIe siècle).
À gauche, des oiseaux picorent une grappe de raisins.
|
|
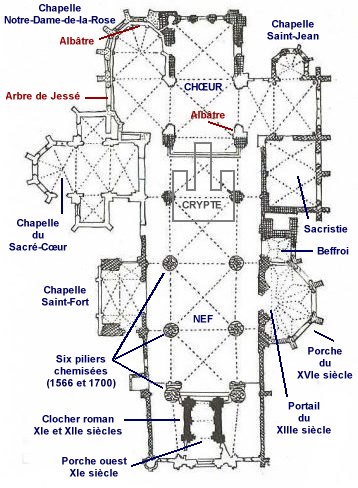
Plan de la basilique Saint-Seurin. |
|
Le
plan de la basilique.
L'église comprend un chœur
rectangulaire à deux travées couvert de voûtes ogivales,
le tout remontant à la fin du XIIe siècle. La seconde
travée du chœur s'ouvre, au nord, sur la chapelle Notre-Dame
de la Rose ; au sud, sur deux travées d'inégale
longueur, dont la dernière donne accès à la chapelle
Saint-Jean.
Cet espace est parfois considéré comme un transept.
La nef s'étale sur quatre travées, toutes voûtées d'ogives.
La travée qui jouxte le chœur
date aussi du XIIe, alors que les trois suivantes sont
du XIIIe. La travée du porche occidental a été créée
au XIVe siècle. Les bas-côtés, qui ont une hauteur analogue
à celle de la nef, sont couverts de berceaux transversaux.
Six chapelles ont été ajoutées au cours du temps. La
plus ancienne est la chapelle Saint-Jean
au sud du chœur.
Son pendant, au nord, beaucoup plus imposant, est la
chapelle Notre-Dame-de-la-Rose
datée du XVe siècle. Les autres chapelles de taille
semblable datent du XIXe siècle (Saint-Fort,
Sacré-Cœur).
L'ancienne chapelle Sainte-Catherine est devenue sacristie.
|
|
|
|
Le narthex
roman.
Le narthex, appelé aussi couloir-porche par certains historiens,
est une entrée du XIe siècle qui donnait accès à la base du
clocher, avant la première travée de l'ancienne église. Avec
la crypte (fermée au public), ce narthex est l'élément le
plus ancien de la basilique.
Jadis, dès l'entrée dans le porche, le fidèle faisait face
à un escalier qui descendait de deux ou trois mètres pour
accéder à la nef. Ce qui fait que les chapiteaux romans du
narthex étaient vus de plus bas et que la crypte n'était pas
enterrée.
Au XIVe siècle, un porche est venu coiffer la partie romane.
Puis l'architecte Alexandre Poitevin, en 1828, après destruction
du porche, l'a encastrée dans une façade néo-romane conçue
à sa manière.
L'intérêt de ce porche est d'y observer d'intéressants chapiteaux
romans. On donne ici le Sacrifice d'Abraham (ci-contre) et
des oiseaux picorant une grappe de raisins (ci-dessus).
|
|

Chapiteaux romans avec, à droite, le Sacrifice d'Abraham. |
| LA NEF DE LA BASILIQUE
SAINT-SEURIN |
|

La nef de la basilique Saint-Seurin et son élévation nord.
Le pilier du premier plan est du XIIe siècle.
Les deux piliers de l'arrière-plan, qui étaient à l'origine semblables
à celui du premier plan, ont été renforcés d'une ceinture de pierre
vers l'année 1700.
À l'extrême-droite, la chaise
épiscopale. |
|
Architecture
intérieure (1/3).
«En entrant dans l'église, on est assez déçu,
il faut l'avouer, par sa lourdeur inélégante»
: c'est ainsi que l'abbé Brun, en 1952, campe
sa première impression de Saint-Seurin.
La lourdeur dont il est question, et que tout
visiteur ressent, vient du manque de hauteur des
piles. En effet, le niveau du sol a été surhaussé
d'environ trois mètres à la fin du XVIIe siècle,
ce qui a bouleversé l'atmosphère gothique de l'édifice.
---»» Suite 2/3
plus bas.
|
|

Christ en croix sur une pile de la nef.
XIXe siècle ? |
|

La chaire à prêcher est du XIXe siècle. |

Rose des saints honorés à Saint-Seurin.
Atelier Jacques Villiet, Bordeaux, années 1850. |
|

Chemin de croix, station VI : Simon aide Jésus à porter sa croix.
Plaque en étain ou en argent repoussé, XIXe siècle ? |
|
Les
vitraux de la basilique Saint-Seurin.
Bien qu'ils soient tous de l'atelier bordelais de Joseph
Villiet (et de plusieurs de ses cartonniers) et
qu'ils remontent tous aux années 1850-60, les vitraux
de la basilique méritent l'attention du visiteur.
Que sait-on des vitraux précédents ? En 1861,
dans sa Description des œuvres d'art des édifices
de Bordeaux, Charles Marionneau rappelle l'existence
d'«anciens et curieux vitraux» : la chapelle
Notre-Dame-de-la-Rose possédait des verrières illustrant
des scènes de la vie de la Vierge ; dans leur partie
basse se trouvaient des écussons aux armes d'Angleterre
et de France. Dans le bas-côté nord, il y avait un petit
panneau remontant au XVIe siècle : un évêque mitré,
tenant sa crosse, se tenait sous un portique ; au-dessus
de lui, deux anges relevaient un rideau.
Tout comme cet historien, on ne peut que déplorer le
peu de respect des chanoines pour ces verrières anciennes
qui ont toutes disparu.
Les vitraux actuels peuvent être partagés en trois groupes.
Le premier rassemble des vitraux relatifs à des événements
propres à la basilique. On les trouve dans les bas-côtés
et ce sont les plus intéressants.
Le deuxième groupe propose des vitraux découpés en médaillons
qui décrivent des scènes de la vie des saints liés à
la basilique : Seurin, Amand, Martial, Véronique, Bénédicte,
etc. À ce groupe se rattachent les vitraux traditionnels
des vies de la Vierge (chapelle
Notre-Dame-de-la-Rose) et de saint Jean dans la
chapelle
éponyme.
Dans le dernier groupe se trouvent les vitraux assez
banals qui affichent un grand personnage dans chaque
lancette (voir par exemple ceux de l'abside).
Au sein du premier groupe, on trouve une grande verrière
contant l'histoire de l'Ancien
cimetière qui se trouvait sur le flanc sud de la
basilique, aujourd'hui place des Martyrs de la Résistance.
Une autre verrière illustre la procession
du cardinal de Sourdis pour honorer un vœu.
Une troisième rappelle la primauté que le chapitre de
Saint-Seurin se donnait face à celui de la cathédrale
Saint-André : la Prestation
de serment de tout nouvel évêque de Bordeaux
qui devait respecter les droits du chapitre de la collégiale
Saint-Seurin avant même d'être intronisé dans la cathédrale.
Le vitrail du Pèlerinage
relate un épisode historique : le Prince de Galles
reçoit ses armes des mains de l'archevêque Amanieu de
la Motte.
Dans le deuxième groupe, on pourra noter un Arbre
de Jessé, une rose des saints
honorés à Saint-Seurin, les vitraux de la vie de
la Vierge dans la chapelle Notre-Dame
de la Rose, la grande verrière de la vie
de saint Amand et saint Seurin dans le bras sud
du transept et celle de la vie
de saint Martial et sainte Bénédicte à droite du
maître-autel dans le transept.
|
|

Chemin de croix, station VII : Véronique essuie le visage de
Jésus.
Plaque en étain ou en argent repoussé, XIXe siècle ? |
|

Rose des saints honorés à Saint-Seurin, partie basse.
Sainte Véronique, sainte Bénédicte et sainte Rose de Lima.
Atelier Jacques Villiet, Bordeaux, années 1850. |

L'élévation sud vue depuis le chœur.
On remarquera le berceau transversal au-dessus du bas-côté.
À gauche, le pilier gothique du XIIe siècle, de type composé, se termine
par un chapiteau floral avec masques.
Il n'a pas été impacté par les travaux de 1700 qui ont chemisé les
autres piliers afin de les renforcer. |
|
Architecture
intérieure (2/3).
---»» L'église a joué de malheur. En 1566, les
voûtes des deuxième et troisième travées de la
nef s'écroulent. Les voûtes disparues sont reconstruites
et l'un des piliers de la nef reçoit une ceinture
de pierre en guise de renfort, transformant son
profil composé en un profil cylindrique. En 1698,
second écroulement des voûtes. Cette fois, c'est
toute la partie ouest qui s'effondre à cause .de
la fragilité d'un autre pilier.
Là encore tout est reconstruit, mais Jean-Baptiste
Augier, ingénieur ordinaire du roi en charge des
travaux, ne veut prendre aucun risque pour l'avenir.
Les cinq autres piliers de la partie ouest de
la nef (dont ceux soutenant la tribune), sont
à leur tour renforcés par une ceinture de pierre,.
De plus, persuadé que le mauvais état du terrain
est en cause, Augier décide de surhausser le sol
de la nef d'environ trois mètres.
Auparavant, depuis la rue, on descendait dans
la nef de l'église par un escalier. De là, pour
aller dans le chœur,
qui était surélevé par rapport à la nef, il fallait
remonter par un autre escalier. De la sorte, le
toit de la crypte, où étaient réunis les sarcophages
des saints, était apparent. «La crypte elle-même,
écrit Gabriel Loire pour le Congrès archéologique
de France de 1939, prenait jour dans la nef
par des ouvertures assez semblables à celles qu'on
voit par exemple à Saint-Sernin de Toulouse.»
---»» Suite 3/3
plus bas.
|
|

Moniale avec l'Enfant-Jésus.
Tableau anonyme.
|
|
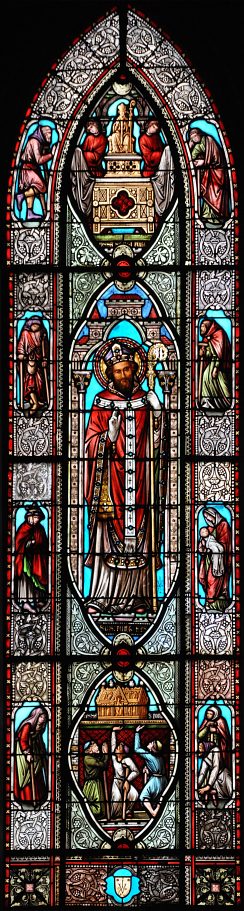
Vitrail de La Légende de saint Fort.
C'est l'un des plus beaux vitraux de la basilique.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862. |
Les malades, les infirmes,
les aveugles obtiennent
une guérison miraculeuse au contact
de la châsse du saint. |
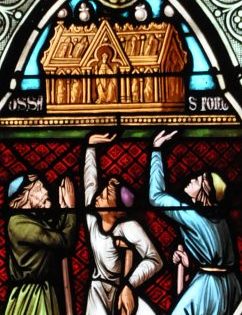 |
|
|
Vitrail
de l'ancien cimetière de Saint-Seurin ---»»»
Ce vitrail de l'atelier Joseph Villiet illustre
des épisodes historiques ou légendaires de l'ancien
cimetière Saint-Seurin, «l'un des plus célèbres
de la chrétienté», écrit Charles Marionneau.
Il se compose de trois rangées.
En haut, selon la légende, Jésus-Christ bénit
le cimetière en présence de sept prélats.
Au centre : convoi funèbre des barons tués à Roncevaux
; leurs corps sont conduits à Saint-Seurin.
En bas : au centre, deux sonneurs d'oliphant (rappelant
peut-être le cor de Roland à Roncevaux) ; à droite
et à gauche, des moines distribuent des vêtements
et des aumônes par ordre de Charlemagne.
Au-dessous des sonneurs d'oliphant, Charlemagne
pleure sur le tombeau de ses guerriers.
|
|

Dans le bas-côté nord, la chapelle Notre-Dame de Bonne
Nouvelle
se présente comme une véritable caverne. |
|
Vitrail
de la Procession ---»»»
En 1861, Charles Marionneau donne l'explication
de cette verrière. Il écrit : «Ce vitrail a pour
sujet l'accomplissement d'un vœu à Notre-Dame
de Lorette. La procession se rend à la chapelle,
portant une lampe d'argent, objet du vœu. Le cardinal
de Sourdis et le maréchal d'Ornano sont les principaux
personnages du cortège.»
Dans la partie basse, le cartonnier a inséré une
suite de petits personnages agenouillés. Selon
Marionneau, ils récitent les litanies de la Vierge
afin d'honorer une dévotion qui, en 1861, était
encore en vigueur à Saint-Seurin.
Charles Marionneau précise que ce vitrail (avec
d'autres) a été exécuté aux frais de la fabrique
de 1861 à 1862. Or son ouvrage édité chez le libraire
Aubry à Paris et le libraire Chaumas-Gayet à Bordeaux
porte l'année 1861. Comme quoi l'auteur n'a pas
perdu de temps...
|
|

«La Vierge donnant le Rosaire à saint Dominique
et sainte Catherine de Sienne»,
Tableau de la seconde moitié du XVIIe siècle. |
| «««--- La Légende
de saint Fort, détail. |
|
|

Vitrail de la Prestation de serment des archevêques
de Bordeaux à Saint-Seurin.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862.

|
Vitrail
de la Prestation de serment (ci-dessus).
Le jour de son entrée solennelle dans la ville
épiscopale, le nouvel évêque devait se rendre
en priorité à Saint-Seurin pour jurer sur l'Évangile
de maintenir les privilèges de la collégiale.
Pour bien montrer l'importance de cette cérémonie,
le cartonnier a représenté, autour de l'évêque,
des membres du chapitre, leur doyen en tête, ainsi
que des dignitaires laïques. Source : Description
des œuvres d'art des édifices de Bordeaux
par Charles Marionneau, 1861.
|
|
|
Vitrail
du Pèlerinage ---»»»
Ce vitrail illustre le pèlerinage des rois et
des princes au tombeau de saint Seurin, situé
dans l'église.
Le dignitaire posait ses armes sur l'autel et
l'évêque, de façon symbolique, les lui rendait.
La scène principale représente le Prince de Galles,
suivi de ses officiers, recevant ses armes de
l'archevêque Amanieu de la Motte.
Dans la partie basse, sont agenouillés : Eudes,
comte de Bordeaux ; Louis VIII, roi de France
; Henri, duc de Lancastre ; Henri II, roi de France.
Le bas du tympan est orné des armes de Bordeaux,
d'Angleterre, de Castille et de France.
Source : Description
des œuvres d'art des édifices de Bordeaux
par Charles Marionneau, 1861.
|


Statue de la Vierge à l'Enfant.
Albâtre, XIVe siècle.
Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle. |
|
|
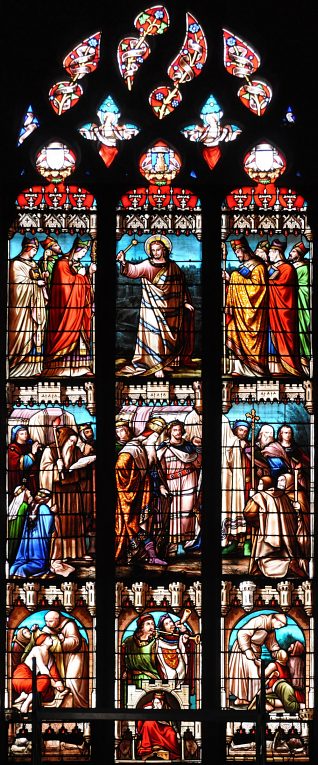
Vitrail de l'histoire de l'ancien cimetière de Saint-Seurin.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |

Vitrail de la Procession du cardinal de Sourdis.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862. |
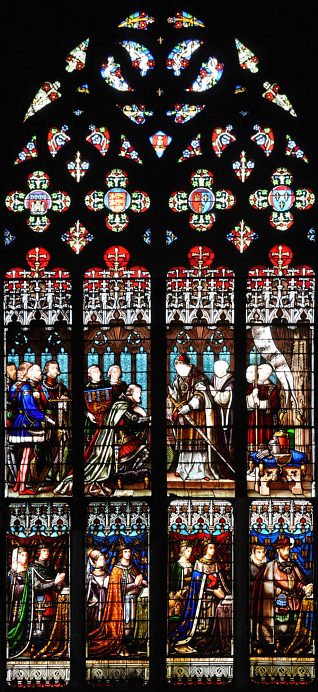
Vitrail du Pèlerinage des souverains.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862. |

Saint Pierre donne son bâton d'évêque à saint Martial.
Vitrail de la vie de saint Martial, détail.
Atelier Joseph Villiet, années 1850. |
|

L'élévation sud et sa voûte gothique quadripartite. |
|
Architecture
intérieure (3/3)
---»» Le remblaiement va enfouir complètement la crypte
et transformer l'aspect intérieur de l'édifice. La charpente
a été, elle aussi, totalement remaniée : les combles
aigus ont laissé la place à une toiture à faible inclinaison.
L'autre point intéressant est la forme de voûtement
des bas-côtés. Ceux-ci ne sont pas voûtés d'ogives,
mais reçoivent un berceau transversal brisé aussi haut
que la nef elle-même (voir photo de la nef ci-dessus
et plus
haut) et que l'historien Gabriel Loirette compare
à de puissants formerets.
Si l'on y ajoute une retombée des voûtes du chœur
sur les piles du chevet, jugée parfois assez gauche,
qu'on y ajoute encore une similitude des piles avec
celles d'églises à coupoles d'Aquitaine (profil, élévation,
décoration), et qu'on adjoigne à tout cela une absence
de triforium et de fenêtres hautes, «il est permis de
se demander, écrit Loirette, si les maîtres d'œuvre
de Saint-Seurin de la fin du XIIe siècle n'ont pas eu
l'intention d'établir des coupoles.»
Coupoles ou non, l'historien ajoute que «le système
de voûtement de Saint-Seurin de Bordeaux est extrêmement
rare», visible seulement dans une église de Charente
et une autre dans les Landes. C'est pourquoi il conclut
son analyse des voûtements des bas-côtés en rappelant
l'opinion d'un autre spécialiste des vieilles églises
de la Gironde, Jean-Auguste Brutails, en 1910, qui voyait
dans Saint-Seurin «la réalisation gothique d'un compromis
entre les églises à coupoles et les églises poitevines
à bas-côtés médiocrement larges.»
En 1912, dans son étude sur Saint-Seurin, Brutails écrira
simplement que «l'usage des berceaux transversaux paraît
inspiré de l'architecture à coupoles.»
|
|
|
LES SOUVERAINS EN
PÈLERINAGE
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1862 |
|

Eudes, comte de Bordeaux. |

Henri, duc de Lancastre. |

Louis VIII et Blanche de Castille. |

Henri II et Catherine de Médicis.
|
|
| LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-ROSE
|
|

La chapelle Notre-Dame-de-la-Rose dans l'absidiole nord a été construite
entre 1427 et 1444.
Au centre de la photographie, gisant du chanoine Guillaume de Lana
qui se fit enterrer dans la chapelle en 1550. |

L'Adoration des mages (hauteur 1,32 mètre).
XVe siècle.
Clé pendante dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |

Trois anges dans le soubassement du Couronnement de la
Vierge.
XVe siècle.
Clé pendante dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |
|
|
Chapelle
Notre-Dame-de-la-Rose (1/2).
Cette grande chapelle de dévotions est la plus
riche et la plus intéressante de la basilique.
Construite de 1427 à 1444 et fruit du zèle de
l'évêque Pey Berland, elle comprend une travée
sur plan carré, un chœur très court et une abside
à cinq pans.
Son style est le gothique flamboyant. Une porte,
dite «de la sacristie», située à droite de l'autel,
regorge de petits personnages et d'animaux. À
la voûte, les deux clés pendantes offrent, sur
leurs deux faces, de belles saynètes en haut-relief
: l'Annonciation et le Couronnement de la Vierge
; l'Adoration des mages et la Résurrection des
morts.
L'autel, situé en avant du fond de l'abside, est
adossé à un retable en pierre. Celui-ci reçoit
douze
bas-reliefs en albâtre qui illustrent des
scènes de la vie de la Vierge. L'autel est surmonté
de trois statues : une Vierge à l'Enfant dite
Notre-Dame
de la Rose, albâtre du XIVe siècle, et deux
anges adorateurs qui sont modernes.
On notera le chemin de ronde établi à la base
des fenêtres et dont la continuité est assurée
par des ouvertures dans les élévations renforcées
du mur.
---»» Suite 2/2
plus bas.
|
|

Le Couronnement de la Vierge.
XVe siècle.
Clé pendante dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |
|
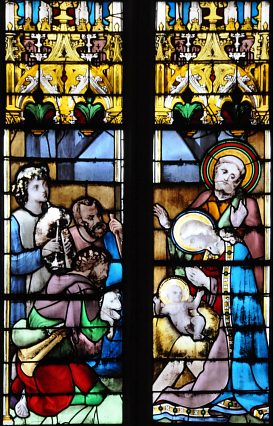
L'Adoration des bergers, détail central du vitrail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

Le Couronnement de la Vierge
Au soubassement : un chœur d'anges.
Vitrail de l'atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857.
Ce vitrail porte les armes du donateur, le cardinal
Donnet.
|
|

La porte de la sacristie, détail.
XVe siècle. |

L'Annonciation, détail central du vitrail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

L'Adoration des bergers, soubassement d'un vitrail
de la chapelle.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |
|
|
|
Chapelle
Notre-Dame-de-la-Rose (2/2).
---»» En 1861, Charles Marionneau, dans sa Description
des œuvres d'art des édifices bordelais, faisait
remarquer la transition de style, bien visible
dans la chapelle, entre le gothique finissant
et l'ornementation Renaissance.
En 1939, Gabriel Loirette, pour le Congrès
archéologique de France, lui emboîte le pas.
Il écrit : «La lourdeur des masses n'empêche pas
d'apprécier la finesse et la multiplicité des
détails ; l'ornementation du retable, des arcatures
et des clefs pendantes, qui s'est poursuivie jusqu'à
une époque assez avancée du XVIe siècle, atteste
la dégénérescence des traditions gothiques et
l'influence de la Renaissance italienne.» Un petit
monument typiquement de style Renaissance se trouve
contre le mur sud de cette chapelle (donné à droite).
La chapelle est éclairée par cinq baies enchâssées
sous des formerets que Jean-Auguste Brutails et
Gabriel Loirette qualifient tous les deux de «vigoureux».
Selon Charles Marionneau tous les vitraux de cette
chapelle sont de l'année 1857 et viennent de l'atelier
Joseph Villiet à Bordeaux.
On pourra admirer un très bel Arbre
de Jessé dans un vitrail à quatre lancettes.
|
|

Ornementation gothique influencée par la Renaissance. |
|
|

La porte de la sacristie et son gothique flamboyant.
XVe siècle. |

La Présentation au temple, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |

La porte de la sacristie et son ornementation
en gothique flamboyant.
XVe siècle. |

Monument de style Renaissance
dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |
| ««---
La partie cerclée est en gros plan ci-contre. |
|
| L'ALBÂTRE DE LA
CHAPELLE NOTRE-DAME-DE-LA-ROSE |
|
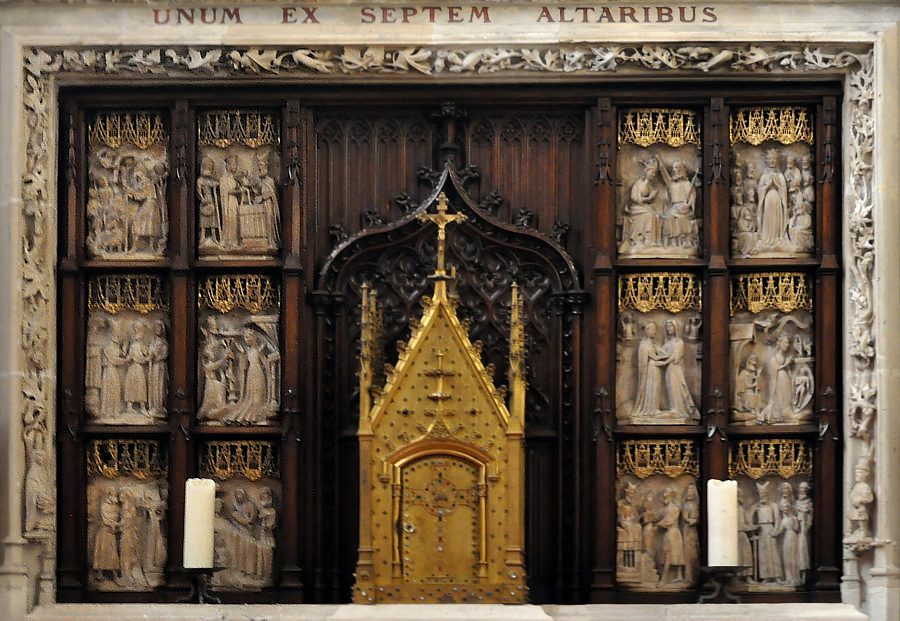
Le retable du XVe siècle et ses bas-reliefs en albâtre dans la chapelle
Notre-Dame-de-la-Rose.
Les bas-reliefs illustrent en dix saynètes la vie de la Vierge. |
|
Les
albâtres de la basilique Saint-Seurin.
Au XVe siècle, les imagiers anglais furent réputés en
Europe pour leurs bas-reliefs en albâtre. Les ateliers
de Nottingham, de Londres et de Burton-on-Trent étaient
renommés. On utilisait ces œuvres pour orner les retables
d'autel et, dans une moindre mesure, le sarcophage des
tombeaux.
En 1939, pour le Congrès archéologique de France,
Gabriel Loirette se montre peu amène sur la qualité
de ces œuvres : «Le style de ces petites sculptures
onctueuses et fades, écrit-il, faites en série, se caractérise
par la maigreur et la raideur des personnages, par la
forte saillie des pommettes et des yeux, par l'allongement
disgracieux des mains et des pieds.»
En France, c'est avant tout dans les provinces plus
anglaises que les autres que ces œuvres de basse qualité
se répandirent, à savoir la Normandie et la Guyenne.
À Bordeaux,
«l'archevêque Pey Berland, ajoute Gabriel Loirette,
plus que tout autre, contribua par des dons, à les diffuser.»
La basilique Saint-Seurin possède deux importants ensembles
de ces albâtres.
Le retable de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose en comptabilise
douze. Ils illustrent des scènes traditionnelles de
la vie de la Vierge. Le retable
de l'ancien maître-autel, qui se trouve maintenant
contre un pilier du chœur,
en possède dix. Autour d'une Annonciation surmontée
d'un Calvaire, ses panneaux racontent des épisodes de
la vie de saint Martial et de saint Seurin.
Toutefois, l'association Ars et Fides Bordeaux
attribue le retable près du chœur,
de par sa plus grande finesse des modèles, à un atelier
français.
|
|
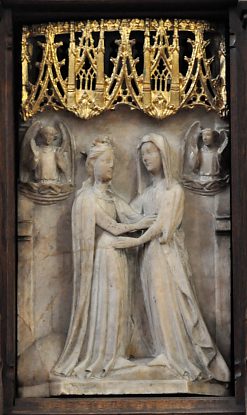
La Visitation.
Panneau en albâtre, XVe siècle. |

Le Couronnement de la Vierge.
Panneau en albâtre, XVe siècle. |
|

Vierge à l'Enfant dite «Notre-Dame de la Rose».
Albâtre anglais du XIVe siècle.
Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |
|
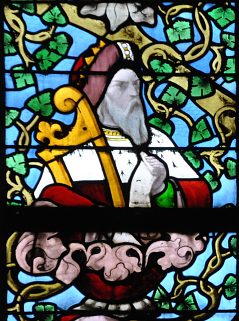
Arbre de Jessé, détail :
Le roi David, fils de Jessé, et sa lyre.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857.
|
|
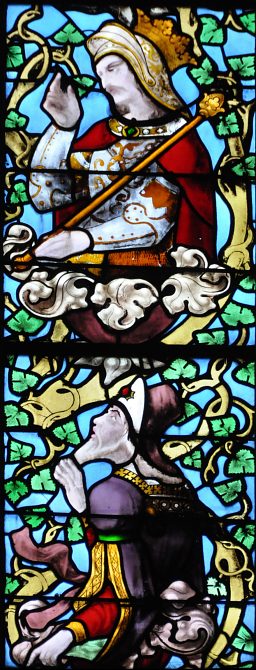
Arbre de Jessé, détail : deux rois de Juda.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |
 |
|
|
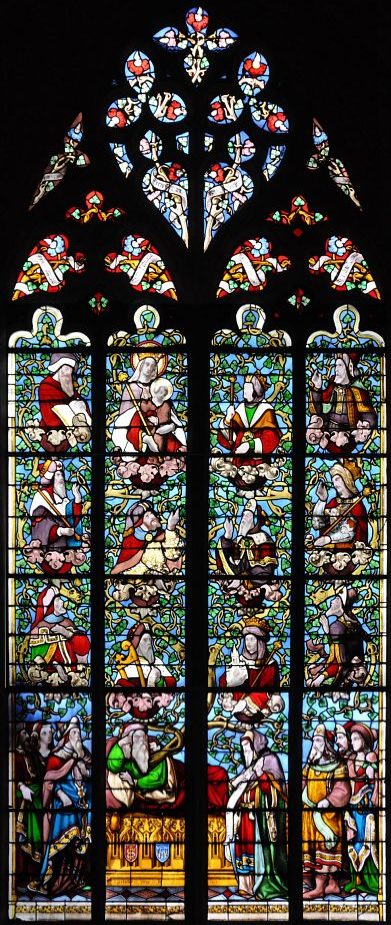
Arbre de Jessé.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857. |
|
L'Arbre
de Jessé de la chapelle Notre-Dame-de-la-Rose.
Ce vitrail de l'atelier Joseph Villiet suit les standards
habituels de l'Arbre : Jessé est étendu, endormi, sur
un lit. De son sein s'élance une tige qui se déploie
en de multiplies ramifications où se tiennent les ancêtres
de la Vierge et de Jésus.
Au-dessus de Jessé sont représentés son fils, le roi
David tenant une lyre, et le fils de David, le roi Salomon,
qui tient une représentation gothique du temple de Jérusalem.
Voir les détails historiques de l'Arbre à la basilique
Saint-Denis à Saint-Denis.
Charles Marionneau signale que, en plus des prophètes,
se trouvent, autour du lit de Jessé, des poètes et des
philosophes du paganisme.
Cet Arbre de Jessé possède un trait particulier : les
visages sont en gris. Il s'agit vraisemblablement du
résultat de l'impression de photos dans le verre, la
cuisson assurant ensuite la vitrification et la durabilité.
En général, et dans un second temps, le peintre verrier
intervenait sur la photo en noir et blanc pour la colorier.
Ici, les visages sont laissés en gris, sans doute pour
diminuer les coûts de fabrication. Mais à qui appartiennent-ils ?
|
|

Vierge à l'Enfant, détail.
Albâtre anglais du XIVe siècle.
Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose.
|

Statue moderne de
sainte Catherine d'Alexandrie.
Chapelle Notre-Dame-de-la-Rose. |
|
«««--- Arbre de Jessé, détail.
Le roi Salomon, fils de David, présente son temple.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1857.
|
|
|
| AUTRES CHAPELLES
DE LA BASILIQUE SAINT-SEURIN |
|

La chapelle du Sacré-Cœur (au côté nord) date des années 1880.
Elle est protégée par un haut panneau de verre. De là vient
le reflet d'un vitrail voisin au-dessus de l'autel... |

Chapelle Saint-Fort sur le côté nord (construite en 1847). |

Saint Jean-Baptiste devant Hérode.
Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste, détail.
Atelier Joseph Villiet, années 1860-70. |

Le Festin d'Hérode.
Atelier Joseph Villiet, années 1860-70.

«««--- Saint Jean reproche
à Hérode Antipas
d’avoir épousé Hérodiade, la femme de son frère
Philippe. Ce qui était interdit par la loi mosaïque. |
|

La chapelle Saint-Jean a été bâtie au XIVe siècle, au sud du
chœur.
Dans la photo, seules trois baies sont visibles sur les cinq. |
|
Les
vitraux de la chapelle Saint-Jean.
Les vitraux de cette chapelle illustrent en dix saynètes,
réparties sur cinq baies, la vie de saint Jean-Baptiste.
En 1861, dans sa Description des œuvres d'art des
édifices de Bordeaux, Charles Marionneau ne parle
que d'un seul vitrail. L'explication est donnée par
Gabriel Loirette (Congrès archéologique de France,
1939) : avant 1868, la chapelle Saint-Jean n'était éclairée
que par trois baies, dont l'une était murée. Il n'y
avait donc que deux baies avec des vitraux. Celle que
décrit Marionneau représente saint Jean-Baptiste debout
«tenant sur le bras gauche un agneau, et de la main
droite, un cartel déroulé, sur lequel on lit cette légende
: Ecce agnus Dei». Et il ajoute : «Ce vitrail
est signé des initiales : J. V. (Joseph Villiet),
1854» De toute évidence, ce vitrail a disparu
ou a été déplacé.
Gabriel Loirette précise que, en 1868, on dégagea la
fenêtre murée et l'on perça deux autres fenêtres, au
nord et au sud. De ce fait, la chapelle compte maintenant
cinq baies.
Les verrières (plutôt dégradées et apparemment non signées)
de ces cinq baies sont de l'atelier bordelais de Joseph
Villiet. En effet, à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Bazas, un vitrail de la chapelle
Saint-Jean-Baptiste offre une scène similaire à la scène
donnée ci-contre à droite : Salomé présente le chef
de saint Jean à un Hérode pensif. Le visage du roi est
exactement le même dans les deux vitraux. La verrière
de Bazas étant datée des années 1852-1862, on en déduit
que l'atelier aura réutilisé une partie des cartons
bazadais pour Bordeaux.
On datera donc les vitraux de la chapelle Saint-Jean
à Saint-Seurin de la fin des années 1860 ou des années
1870.
|
|
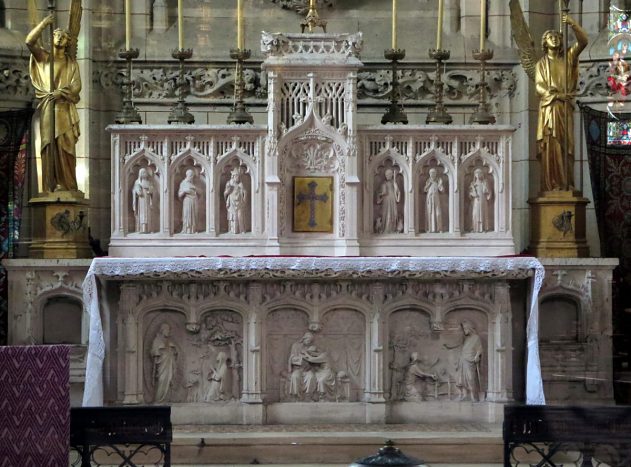 |
|

Salomé portant le chef de Jean-Baptiste à Hérode.
Vitrail de la vie de saint Jean-Baptiste, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1860-70
La tête d'Hérode pensif est exactement la même
que celle qu'on peut voir dans un vitrail sur le même thème
à la cathédrale
Saint-Jean-Baptiste de Bazas.
«««--- Retable de la chapelle
du Sacré-Cœur.
XIXe siècle. |
|
| LE CHŒUR ET LE
«TRANSEPT» DE LA BASILIQUE SAINT-SEURIN |
|

Le chœur de la basilique Saint-Seurin.
Le tombeau de saint Seurin se trouve sous l'autel.

Le vitrail des vies
de saint Martial et de sainte Bénédicte se trouve en haut à droite
de l'image (bras sud du «transept»). |

Saint Amand, évêque.
Vitrail de l'abside, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1853. |
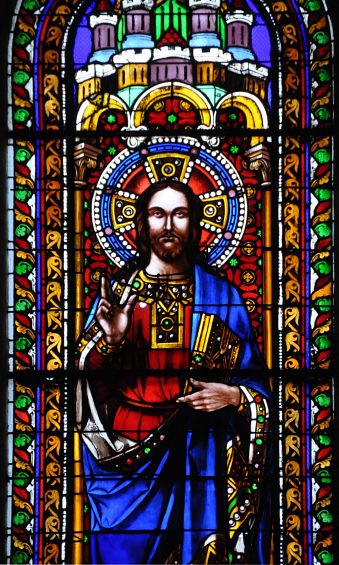
Le Sacré-Cœur.
Vitrail de l'abside, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1853. |

Bras sud du «transept» et entrée dans la chapelle
Saint-Jean. |
Chaise épiscopale dans
le transept ---»»»
2e quart du XVe siècle (?) |
|
|
La
Chaise épiscopale.
Cette chaise de pierre, sculptée en gothique flamboyant,
est l'une des curiosités de la basilique. Sans certitude,
les historiens la font remonter au deuxième quart du
XVe siècle.
Entre les deux gâbles se trouve, comme suspendue, une
mitre d'évêque soutenue par deux anges (donnée en gros
plan ci-dessous à droite).
Pourquoi une chaise épiscopale dans une église qui n'a
jamais eu rang de cathédrale ? L'explication habituelle
se réfère à la tradition bordelaise qui voulait qu'un
nouvel évêque, avant d'être intronisé à Saint-André,
passât à Saint-Seurin pour faire serment de respecter
les privilèges du chapitre (de Saint-Seurin).
Pour s'assurer de cette amabilité dans le cadre de la
rivalité séculaire entre les deux chapitres, les chanoines
de Saint-Seurin avaient sans doute pensé qu'il était
mieux que l'évêque se sentît comme chez lui...
|
|
|

Les stalles de la fin du XVe siècle dans le sanctuaire.
Les parties hautes sont du XIXe siècle. |
|
Les
stalles du XVe siècle.
Au XVIIIe siècle, 47 stalles en chêne se trouvaient
dans le chœur. Aujourd'hui, il en reste 32 ; le reliquat
a été vendu à une église de la région parisienne. Charles
Marionneau date ces stalles de style gothique des dernières
années du XVe siècle. Les miséricordes y reflètent l'esprit
frondeur des huchiers.
Toute la partie supérieure des stalles (c'est-à-dire
les hauts dossiers) date de 1852. En 1861, dans sa Description
des œuvres d'art des édifices de Bordeaux, Charles
Marionneau révèle que, derrière ces hauts dossiers,
se trouvent, cachées, des peintures murales des XIVe
et XVe siècles illustrant la vie des saints évêques
honorés à Saint-Seurin. De son côté, Jean-Auguste Brutails,
en 1912, dans Les Vieilles églises de la Gironde,
mentionne une dépense du chapitre en 1784 : «peinture
à fresque du chevet par J.-A. Berinzago.» Cette information
ne semble pas concordée avec la précédente. Malheureusement,
les ouvrages récents sur la basilique ne parlent pas
de ces peintures cachées.
Charles Marionneau rappelle que, lors de l'examen par
la Commission des Monuments historiques du projet
des travaux à exécuter dans le chœur, il fut demandé
que la boiserie haute restât mobile pour avoir facilement
accès à ces peintures. Ce vœu a-t-il été exaucé ?
|
|
 |

Saint Seurin, évêque.
Vitrail de l'abside, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1853. |
|
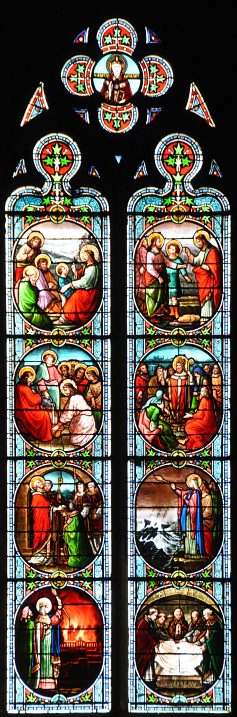
Vies de saint Martial et de sainte Bénédicte.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |

Un retable contenant dix bas-reliefs en albâtre
est accolé à un pilier près du chœur, XVe siècle. |

La Mort de saint Martial.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |
|

Une mitre d'évêque trône entre les deux gâbles de la chaise
épiscopale. |
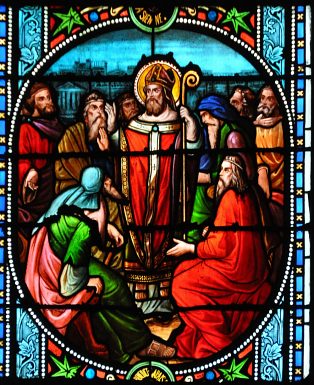
Saint Martial prêche à Sienne.
Vitrail des vies de saint Martial et de sainte Bénédicte, détail.
Atelier de Joseph Villiet, Bordeaux, années 1850. |
|
|
|

Les dix bas-reliefs en albâtre du retable près du chœur illustrent
les vies de saint Martial et saint Seurin.
Au centre : un Calvaire et une Annonciation.
Œuvre du XVe siècle d'un atelier anglais ou peut-être français. |

Arrivée de saint Seurin à Bordeaux.
Bas-relief en albâtre, XVe siècle. |

Sainte Bénédicte arrête un incendie.
Vie de saint Martial et de sainte Bénédicte, détail. |

Sainte Bénédicte apaise une tempête.
Vie de saint Martial et de sainte Bénédicte, détail. |
|
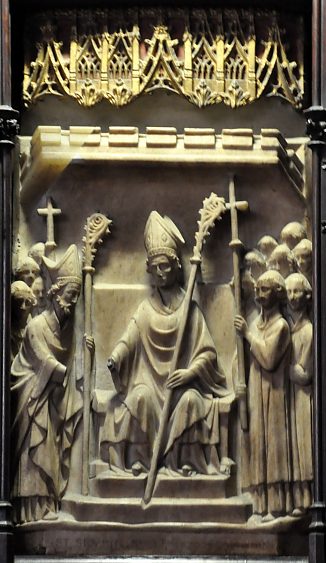
Saint Amand laisse son siège épiscopal à saint Seurin.
Bas-relief en albâtre, du XVe siècle. |
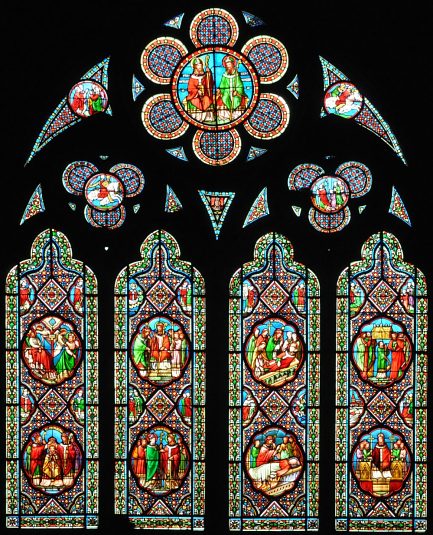
Vie de saint Amand et de saint Seurin.
Atelier Joseph Villiet, 1858.
Vitrail dans le bras sud du transept, |
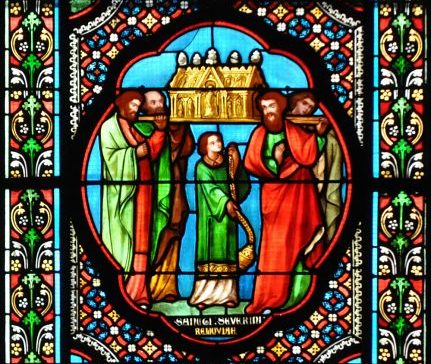
Transfert de la châsse contenant les reliques de saint Seurin.
Vitrail dans le bras sud du transept, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1858. |

Le Martyre de saint Étienne, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux. |
|
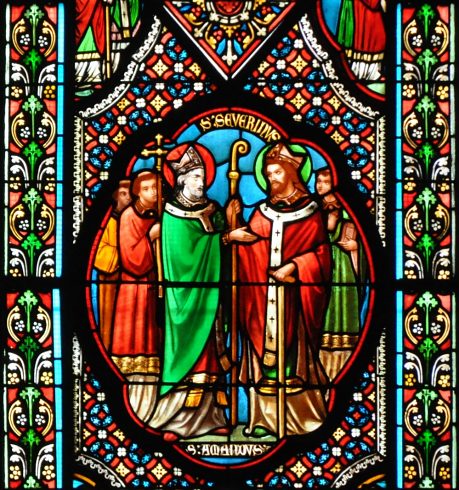
Vie de saint Amand et saint Seurin : amitié entre saint Amand
et saint Seurin.
Vitrail dans le bras sud du transept, détail.
Atelier Joseph Villiet, Bordeaux, 1858. |

L'orgue de tribune.
Le buffet d'orgue date du XVIIIe siècle. |
|
L'orgue
de tribune.
On trouve peu d'information sur l'orgue et sa tribune
dans les documents habituels sur la basilique. En revanche,
en 1912, dans son étude sur Les vieilles églises
de la Gironde, Jean-Auguste Brutails donne le détail
suivant :
1771-1774. Construction de l'orgue, savoir : la tribune
par les frères Laclotte, la balustrade et autres travaux
de serrurerie par Valette, l'instrument par Micot, la
menuiserie par Boyé et par Joseph Peissy, la sculpture
du buffet par Cabirol et Cessy, «l'allongement des bas-côtés
du jubé de l'orgue», c'est-à-dire de la tribune par
Brothier.
En 1862, l'abbé Brun reprend l'essentiel de ces informations
sans citer le facteur Jean-Baptiste Micot qui serait
le créateur de l'orgue.
Étrangement, en 1966, dans le Dictionnaire des églises
de France, Pierre Dubourg-Noves attribue l'instrument
à dom Bedos de Celles, créateur du célèbre orgue de
l'église Sainte-Croix
à Bordeaux
et contemporain de Micot. Cette paternité est reprise
par le même auteur en 1969 dans Guyenne Romane,
éditions Zodiaque, la Nuit des temps. Malheureusement,
Pierre Dubourg-Noves ne donne pas la source de son information.
L'orgue actuel est-il toujours celui de Jean-Baptiste
Micot ?
|
|
|

La nef vue depuis le chœur. |
Documentation : «Les églises de Bordeaux» de
l'abbé Brun, éditions Delmas, 1952
+ «Aquitaine gothique» de Jacques Gardelles, éditions Picard, 1992
+ «Description des œuvres d'art qui décorent les édifices publics
de Bordeaux» de Charles Marionneau, 1861
+ «Les vieilles églises de la Gironde» de Jean-Auguste Brutails, Feret
et Fils Libraires-éditeurs, Bordeaux 1912
+ «Bordeaux Le temps de l'histoire» de Robert Coustet et Marc Saboya,
éditions Mollat, 2000
+ «Guyenne romane» de Pierre Dubourg-Noves, éditions Zodiaque, la
nuit des temps, 1969
+ «L'esprit des bâtisseurs», édité par les Amis d'Ars et Fides Bordeaux,
2011
+ «Dictionnaire des églises de France», éditions Robert Laffont, 1966
+ «Basilique Saint-Seurin, Bordeaux», brochure de l'Office de Tourisme
+ «Basilique Saint-Seurin», brochure publiée par Ars et Fides, Bordeaux,
1995
+ Panneaux d'information dans la nef. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|