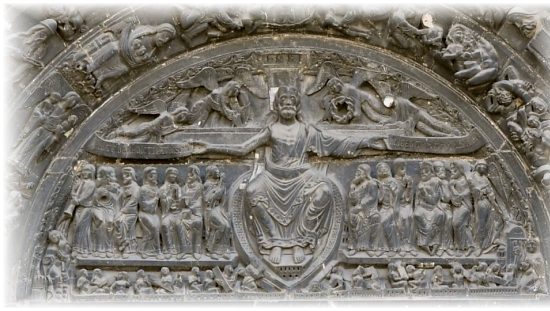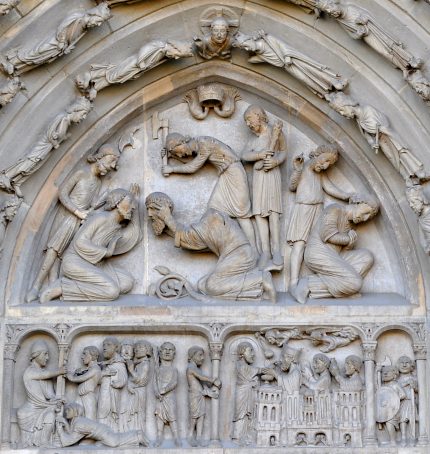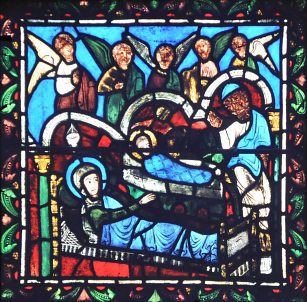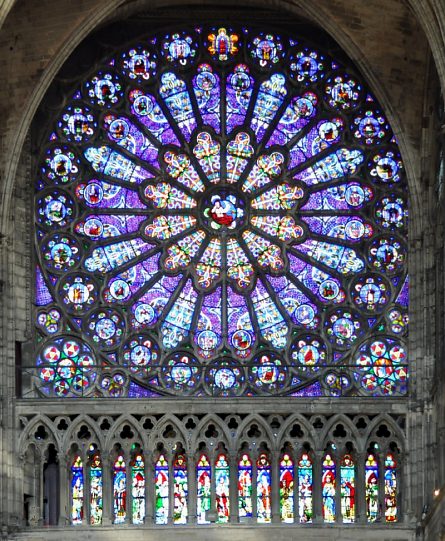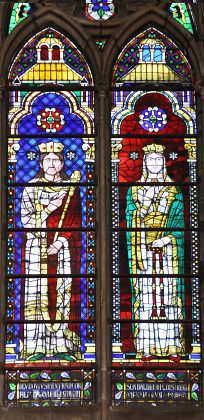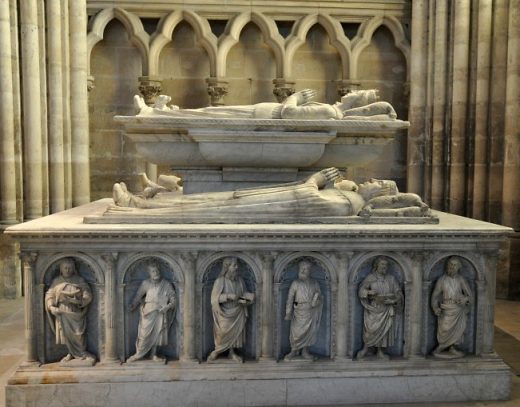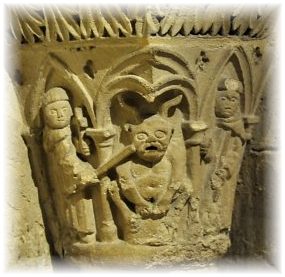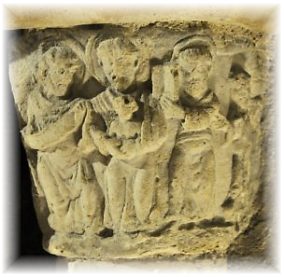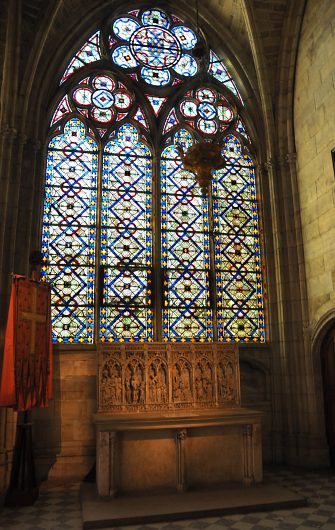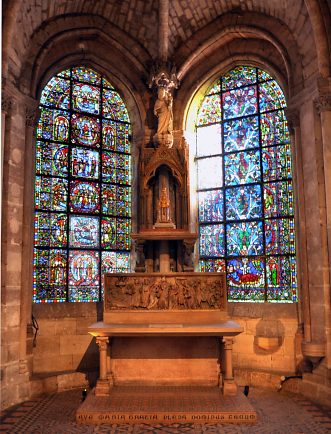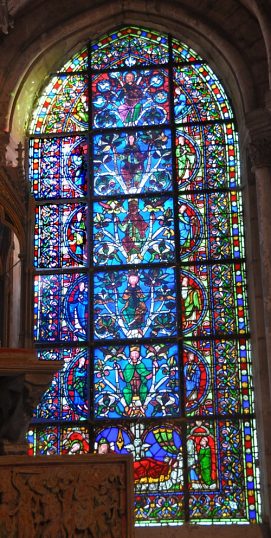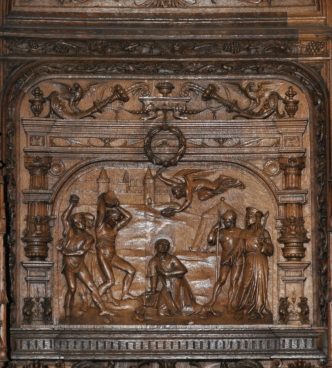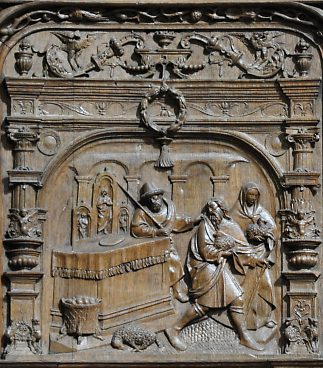|
|
 |
 |
La basilique Saint-Denis est un monument
à part dans le patrimoine architectural religieux français. Ceci
par la volonté d'un homme : l'abbé Suger (1081-1151). L'énergie
et l'idéal religieux de ce prélat qui fut aussi homme d'Etat, surent
transformer une église romane en un monument gothique (agrandi au
XIIIe siècle). Nommé abbé de la riche abbatiale en 1122, il parvint
à réunir des fonds suffisants pour réinventer l'architecture religieuse
de son époque en appliquant un principe simple : la Foi par la Beauté.
Pour croire, le peuple doit admirer, donc voir. Pour voir, il circulera
dans un déambulatoire où seront exposées des reliques dans de magnifiques
reliquaires. D'où l'exigence d'espace et de lumière. Les vitraux
- nécessairement très beaux - compléteront la tâche en apportant
aux illettrés l'enseignement religieux et les règles d'édification
morale. L'esprit du gothique était né. L'église carolingienne de
l'abbaye est agrandie vers 1135. D'abord la façade, puis le chevet.
Suger expose son projet au roi, mais décide de ne pas toucher à
la nef carolingienne.
Un simple sanctuaire ne suffisait pas : l'abbé Suger a joué de ses
amitiés avec le roi Louis VI le Gros, puis avec son fils, Louis
VII, pour faire de son abbatiale une nécropole
royale. Il a réussi : Saint-Denis est riche de plus de soixante-dix
statues de marbre (orants ou gisants) qui font sa renommée. Suger
a aussi bataillé pour en faire le lieu officiel du sacre des rois
de France. Mais, sur ce point, il a été pris de court par la cathédrale
de Reims.
|
|

La nef ett le chœur de la basilique Saint-Denis.
Cette photo aurait plu à l'abbé Suger. Le soleil irradie
de ses rayons les pierres de la nef,
symbolisant le passage de la lumière naturelle à la
lumière immatérielle, «divine». |

La façade de la basilique avec ses trois portails et son unique
tour.
La tour nord a disparu en 1846. |

Le côté nord de la basilique avec «la porte des
Valois», c'est-à-dire le portail du bras nord du transept.

|
Architecture
extérieure.
Au XIIIe siècle, la façade du transept est enrichie
d'un portail qui, au vu de ses sculptures, daterait de 1160.
Les restaurations sont jugées fidèles par les
spécialistes de l'architecture religieuse.
Quant à la façade occidentale, elle affiche
une nouveauté pour l'époque : la rosace centrale
et la disposition des trois portails sculptés.
|
|
| PORTAILS, TYMPANS
ET VOUSSURES |
|
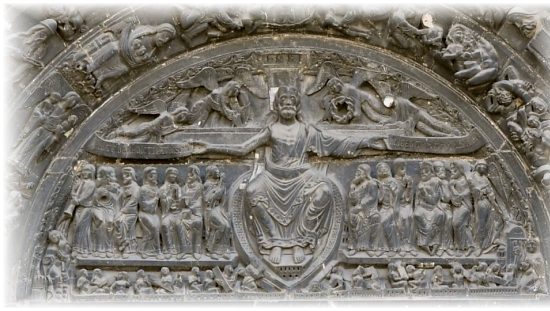
Tympan du portail central
: le Christ est entouré des douze Apôtres.
Tympan du XIIe siècle, saccagé à la Révolution,
restauré au XIXe siècle.
Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |
|
|
|
|

Les vitraux de l'abside, XIXe siècle.
Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan.

Linteau. À gauche,
le préfet Fescennius ordonne l'exécution de Denis,
Rustique et Éleuthère. ---»»»
À droite, les trois compagnons communient. |
|
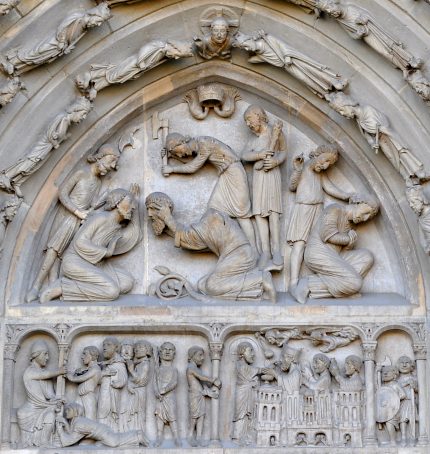
Tympan et linteau du portail du bras nord du transept.
Le tympan illustre la décapitation de Denis et de ses deux
compagnons. |
| LA NEF DE LA BASILIQUE
SAINT-DENIS |
|

La nef et le bras droit du transept.
Le triforium de la basilique est totalement ajouré, apportant
un maximum de lumière. |

Élévations nord à trois niveaux. |
|
Basilique
Saint-Denis : L'ABBÉ SUGER (1/2)
|
 |
 |
Né vers 1081, de modeste
origine, Suger fut placé à
l'âge de dix ans à l'abbaye
de Saint-Denis. C'est là qu'il
rencontra le futur Louis VI le Gros,
fils de Philippe Ier. Commençant
sa vie comme moine, il se fit tôt
remarquer par son don pour plaider
les belles causes et par son art d'administrateur.
Souvent missionné à
Rome, c'est en revenant d'une ambassade
en Italie, en 1122, qu'il apprit son
élection à la tête
de l'abbaye de Saint-Denis. Retournant
à Rome pour le concile de Latran,
il visita les principaux sanctuaires
des régions méridionales et en fut profondément marqué.
|
|
|
Sa future tâche
de constructeur, de mécène
et d'homme d'État sera imbibée
de son apprentissage italien : Bénevent,
Salerne, Bari et surtout le Mont-Cassin.
Revenu à Saint-Denis, il entreprit
de faire reconstruire son église,
devenue trop petite. Les moyens de financement
furent assurés par une gestion rigoureuse
et élargie des propriétés
de l'abbaye. Sa nouvelle église incarnera
sa vision théologique et artistique
du monde, vision renforcée par ses
contacts avec Hugues de Saint-Victor, un
maître à penser réputé
de Paris qui accordait une grande place
aux arts mécaniques et concevait
l'art comme un support spirituel.
Pour croire, il faut voir et être
impressionné par la beauté
des choses saintes. Ainsi on édifie
le peuple et on travaille à la paix.
D'où l'idée fondamentale du
déambulatoire pour circuler autour
de riches reliquaires, le tout plongé
dans une lumière intense, expression
terrestre de la lumière divine. C'est
à cette époque qu'il se met
à écrire sa Vie de Louis
le Gros et une Histoire de Louis
VII.
|
|
|
|

Le bas-côté nord. |
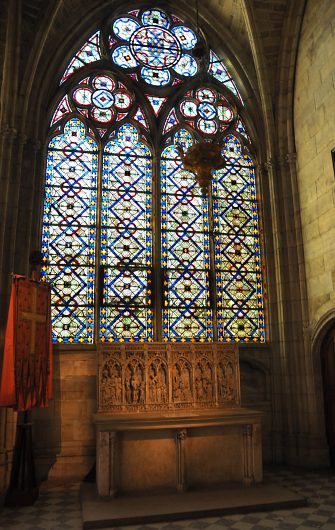
Vitrail moderne et autel avec bas-relief dans un bas-côté. |
|
|

Pierre l'Hermite prêche la première croisade,
détail.
Vitraux de l'Histoire de France (XIXe siècle).
|
|
L'abbé
Suger (2/2)
---»» Suger est aussi un homme d'État. Il travaille aux
côtés de son ami le roi Louis VI jusqu'à la mort de
ce dernier en 1137. Il revient quelques années après
à la cour pour servir Louis VII le Jeune. Son objectif
devient une idée fixe : établir son église comme protectrice
de la royauté et imbriquer étroitement l'Église et le
royaume de France.
En 1145, Louis VII part en croisade. Suger se voit investi
d'une haute mission : gérer le royaume en l'absence
du souverain. Sa tâche durera deux ans et demi.
Il s'en acquittera de magnifique manière : trésor
royal pourvu ; envoi de subsides au roi ; réparation
des châteaux ; rébellion des grands matée
; la paix et la sécurité assurées.
Peu après le retour du roi et malgré l'échec
de la deuxième croisade, Suger est déclaré
«Père de la Patrie».
Sur le plan intérieur, Louis VII veut se séparer
de son épouse Aliénor d'Aquitaine et déclarer
la guerre à Henri II Plantagenêt. Suger
l'en dissuade.
En 1150, l'abbé Suger atteint les soixante-dix
ans. Malade, il entre en agonie en décembre et
meurt en janvier 1151. L'année suivante, Louis
VII divorçait - perdant du même coup l'Aquitaine
- et attaquait Henri II.
L'œuvre de l'abbé Suger est immense. Pour
s'en tenir au plan de l'architecture religieuse, c'est
lui qui a insufflé l'élan initial, l'idée
constructrice et le principe artistique qui sous-tendent
et englobent toute l'histoire des cathédrales
gothiques en Europe et partout ailleurs dans le monde.
Source : «Saint-Denis,
la basilique et le Trésor», Dossiers d'Archéologie,
mars 2001, article de Françoise Gasparri.
|
|
|
|
|

Le chœur de Saint-Denis sous les rayons de soleil rasants d'une
fin d'hiver. |
| LE CHEVET, LE
DÉAMBULATOIRE ET LES CHAPELLES RAYONNANTES |
|

Le chevet et son ciborium.
La continuité des vitraux illustre la volonté de Suger
d'inonder de lumière le chevet et le chœur. |

La voûte du double déambulatoire et ses chapiteaux. |
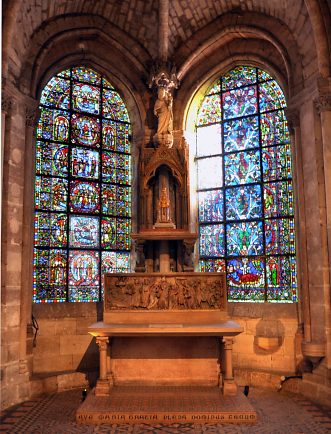
La chapelle axiale de la Vierge avec, à droite, son Arbre
de Jessé. |
|

Le retable de l'Enfance du Christ (XIIIe siècle, pierre peinte).
Chapelle de la Vierge. |

Aucune paroi ne sépare les chapelles rayonnantes du déambulatoire. |

Chapelle rayonnante Saint-Cucuphas.
La quasi-totalité de la verrière de cette chapelle
date de Viollet-de-Duc. |

La chapelle de la Vierge et son vitrail de l'Enfance du Christ.

Seuls les deux panneaux du bas (sur les six en tout) proviennent
de l'époque de Suger : Annonciation et Nativité
(XIIe siècle).
Les autres sont du XIXe siècle. |
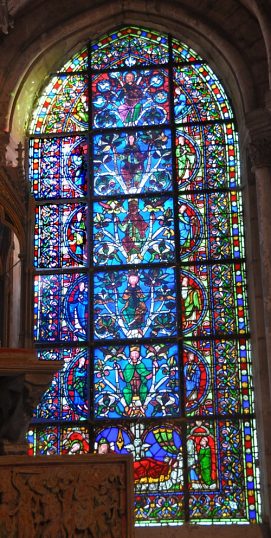
L'ARBRE DE JESSÉ de la Basilique.
Viollet-le-Duc a fait représenter Suger en bas à
droite. |

Chapelle rayonnante Saint-Pérégrin.
On y trouve les célèbres vitraux de la Vie de Moïse (à gauche)
et des Allégories de saint Paul (à droite). Cliquez sur l'image.

«««---
Chapelle de la Vierge, l'ARBRE
DE JESSÉ
Les deux panneaux du bas sont du XIXe,
les quatre autres sont contemporains de Suger.
Cliquez sur les images des vitraux pour les afficher en
gros plan. |
|
|
|
Les sept
chapelles rayonnantes.
Elles apportent deux nouveautés par rapport à
l'art roman : elles sont quasiment contiguës et de peu
de profondeur. Le but de Suger était d'agrandir l'espace
et de mieux faire pénétrer la lumière.
À cette fin, elles
|
possèdent deux grandes
baies.
Même si les chapelles ont l'air resserrées les
unes sur les autres, l'effet d'espace est assuré. De
nombreux édifices du premier âge gothique reprendront
à leur compte ce système de chapelle à
deux baies.
|
|

Retable de saint Eustache (XIIIe siècle).
Chapelle Saint-Maurice. |

Arbre de Jessé, détail : un roi de Juda.
Vitrail contemporain de Suger.
C'est à l'abbé Suger que l'on doit
les caractéristiques de l'Arbre de Jessé.
|
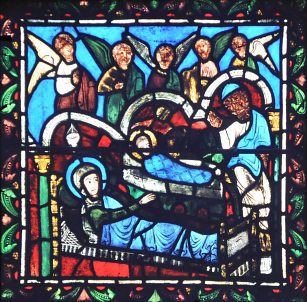
Vitrail de l'Enfance du Christ, détail : la Nativité
(XIIe siècle).
Chapelle de la Vierge. |

Vitrail de l'Enfance du Christ, détail.
date du XIXe siècle.
Les couleurs sont nettement plus chatoyantes... |
|
Basilique
Saint-Denis : L'ARBRE DE JESSÉ
|
 |
 |
Dans le christianisme,
l'Arbre de Jessé est une représentation
de la généalogie de Jésus,
descendant de la Vierge Marie.
Ce symbole religieux a une histoire bien compliquée
où sont intervenues les plus hautes autorités
de l'Église. En effet, la descendance de
Jessé à Marie est en contradiction
avec l'Évangéliste Matthieu pour
qui c'est Joseph qui descend de Jessé.
Les auteurs des Écrits Apocryphes
|
|
|
et les Pères de l'Église
font état de la même descendance. En fait,
la présence de Marie ne s'est vraiment imposée
qu'à partir de la Contre-Réforme et du
Concile de Trente (1545-1562). Les Protestants minimisaient
le rôle la Vierge. En réaction, les prélats
catholiques de la Renaissance vont imposer un culte
marial, tout comme l'image omniprésente de la
Vierge à l'Enfant dans les images, les statues,
les tableaux et dans l'Arbre.
Si l'on résume, pour aboutir à une version
compatible avec les nombreux Arbres de Jessé
que l'on trouve : David a eu deux fils ; le premier,
Salomon, est l'ascendant de Joseph ; le second,
Nathan, est l'ancêtre de Joachim, père
de Marie. Ainsi Joseph et Marie sont cousins très
éloignés...
Ces ascendances ont bien sûr leur part importante
de légendes et de dogmes. Les Évangiles
en donnent deux versions qui ne concordent pas. Mais,
pour les prosélytes, peu importe la vérité
historique, seule compte la vérité
théologique. En faisant descendre Jésus
du roi David (et de son père Jessé), cette
vérité affirme que Jésus est bien
le Messie attendu.
|
|
|
Suivent logiquement tous
les rois qui ont succédé à David, c'est-à-dire son fils
Salomon et les rois de Juda. C'est ce que fait l'Évangile
de Matthieu (qui, rappelons-le, aboutit à Joseph). D'ailleurs,
chez Matthieu comme chez Luc, on trouve un indice supplémentaire
de la messianité : Jésus naît à Bethléem, «la ville
de David».
La vérité théologique possède
un dernier argument pour aboutir à Marie. C'est
un oracle du prophète Isaïe savamment interprété.
À propos de Jessé, Isaïe proclame
: «un rameau sortira de la souche de Jessé,
un rejeton jaillira de ses racines...». Que signifie
cet oracle? Au IIe siècle, l'auteur chrétien
Tertullien en avait déjà donné
le sens : «la branche qui sort de la racine, c'est
Marie qui descend de David. La fleur qui naît
de la tige, c'est le fils de Marie». La vérité
théologique a bouclé la boucle.
Cette version a satisfait tout le monde, que ce soit
les maîtres-verriers qui créaient, les
confréries ou les particuliers qui finançaient
et les évêques qui donnaient leur accord.
De la sorte, la chaîne artistique Jessé-David-Salomon-Roboam
(1er roi de Juda)-Abia-Asa-Josaphat... et finalement
la Vierge s'est imposée malgré l'opposition
à Matthieu.
|
 |
 |
Historiquement, c'est
l'abbé Suger
(~1080-1151), l'un des grands instigateurs de
la basilique de Saint-Denis, qui a donné
la formulation définitive de l'Arbre :
un Jessé couché d'où sort
un arbre dont les branches grimpantes portent
les prophètes (en qualité d'ancêtres
spirituels) et les rois (en qualité d'ancêtres
charnels) de Jésus.
|
|
|
C'est pourquoi, dans l'histoire
du vitrail, l'Arbre de Jessé de la
basilique Saint-Denis revêt une importance capitale. Sa formulation servira de modèle en France
et en Angleterre pendant tout le Moyen Âge.
On pourra voir d'autres Arbres de Jessé dans
l'église Notre-Dame-la-Grande
à Poitiers,
l'église Saint-Pierre
à Dreux,
Saint-Nizier
à Troyes,
Notre-Dame
à Niort
et admirer le chef-d'œuvre d'Engrand
le Prince à l'église
Saint-Étienne de Beauvais.
|
|
|

La nef, les élévations du côté nord et
l'orgue de tribune. |
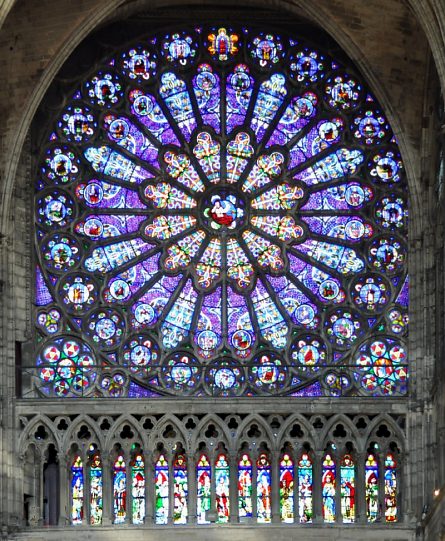
La rose du transept nord et la galerie supérieure qui la borde.
Vitrail du XIXe siècle
Cliquez sur l'image pour l'afficher en gros plan. |
 |

Galerie des papes au-dessous de la rose du bras nord du transept (XIXe
siècle).

«««--- Louis-Philippe visite les caveaux de l'abbaye
de Saint-Denis. Manufacture de Sèvres.
Vitrail du XIXe siècle dans le croisillon sud. Cliquez sur
l'image. |
|
Les vitraux
de Saint-Denis.
Pour son abbatiale, l'abbé Suger a fait réaliser
un projet grandiose et personnel de vitraux par les meilleurs
artistes et maîtres-verriers de la région. Dans
son ouvrage Liber de rebus in administratione sua gestis,
il se répand en qualificatifs louangeurs pour décrire
le rôle de la lumière qui pénètre
dans le sanctuaire par les vitraux. Cependant, dans ses écrits,
il ne cite expressément que trois d'entre eux : l'Arbre
de Jessé, les Allégories de saint Paul et la
Vie de Moïse.
Les allégories sont tirées des épitres
de saint Paul. Il est intéressant de noter que l'abbaye
prenait Paul pour son père spirituel à la suite
à la confusion - peut-être volontaire - entre
saint Denis, premier évêque de Paris et réel
patron de l'abbaye, et Denys l'Aréopagyte, disciple
direct de l'apôtre Paul.
La verrière de Saint-Denis a beaucoup souffert au cours
des âges. Bien des vitraux de Suger - du XIIe siècle
- ont été remaniés au XIIIe. Les vitraux
des grandes fenêtres datent aussi du XIIIe siècle.
Malheureusement, toute la verrière du XIIIe a disparu
lors de la Révolution, en 1794-1795. En 1799, les vitraux
du déambulatoire prirent le chemin du Musée
des Monuments Français. Une partie fut brisée
en route, une autre fut vendue. En 1816, après la fermeture
du Musée, ce qu'on put récupérer revint
dans l'abbatiale.
|
Avec les architectes Debret, puis Viollet-le-Duc, les vitraux furent restaurés, mais
la partie la plus abîmée fut, à son tour,
vendue. Debret lança un vaste programme de création
de verrières : triforium, transept, haute nef, fenêtres
hautes du sanctuaire. Programme complété plus
tard par celui de Viollet-le-Duc pour les fenêtres basses.
En clair, toute la verrière de la basilique a été
refaite au XIXe siècle, à l'exception de quelques
éléments dans les vitraux du déambulatoire
qui sont de l'époque de Suger. Ces vitraux se repèrent
assez facilement : leur éclat est loin d'être
aussi brillant que ceux du XIXe qui leur sont juxtaposés
(voir les trois vitraux ci-dessus).
La verrière du XIXe siècle obéit à
une iconographie royale et dionysienne.
Dans le chœur : la vie de saint Denis ; dans le triforium
de la nef : la vie des papes ; enfin dans les verrières
hautes : la vie des rois et reines de France.
S'y ajoutent une grande verrière dans le transept :
la visite de Louis XVIII à l'abbatiale
(réalisée par la manufacture royale de Sèvres)
et une double verrière : les obsèques de
Louis XVIII et la dédicace de la chapelle funèbre sous Charles X.
Ces vitraux sont de très bonne qualité.
À Saint-Denis, le vœu de Suger - inonder l'église
de lumière - est toujours respecté.
Source : «Saint-Denis,
la basilique et le Trésor», Dossiers d'Archéologie,
mars 2001, article d'Anne Prache.
|
|

Élévations dans la nef avec le triforium ajouré.
Tous les vitraux visibles dans cette photo datent du XIXe siècle. |

Vitrail de la vie des rois de France dans le croisillon nord (XIXe
siècle). Cliquez sur l'image.

|
Dans la vitrerie, l'objectif des
restaurateurs du XIXe siècle était d'illustrer
des thèmes relatifs à la basilique et à
ses gisants : vie de saint Denis dans le chœur ; vie
des papes dans le triforium de la nef ; vie des rois et des
reines de France. dans les verrières hautes.
|
|

Tombeau de Dagobert dans le chœur. Cliquez sur l'image. |
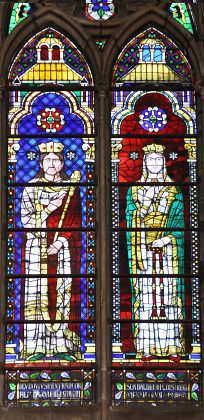
Roi et reine dans la nef, côté nord.
Vitrail du XIXe siècle
Toutes les parties hautes de la nef sont
pourvues de ce style de vitrail. |
|
|

Les stalles de Saint-Denis. Ici, celles du côté nord.
|
|
Les stalles
de Saint-Denis.
Elles proviennent de la chapelle du château de Gaillon
en Normandie et remontent au XVIe siècle. C'est une
commande du cardinal Georges d'Amboise, archevêque de
Rouen.
|
Viollet-le-Duc prit
la décision de les installer à Saint-Denis au
XIXe siècle. Au niveau supérieur, les bas-reliefs
illustrent des épisodes de la Vie de Jésus,
de la Vie de la Vierge et de celles des martyrs. Ils sont
enrichis, dans le bandeau central, par des saynètes
réalisées en marquetterie.
|
|

La Rencontre d'Anne et de Joachim à la Porte dorée.
Bas-relief dans les stalles.
XVIe siècle. |

L'Annonciation. |

La légende de saint Eustache
sculptée sur une miséricorde.
XVIe siècle.
|

Une partie des stalles du côté nord.
XVIe siècle. |
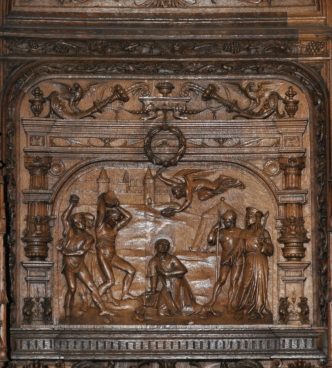
La Lapidation de saint Étienne.
XVIe siècle. |

La Rencontre à la Porte dorée.
Ronde-bosse des stalles, XVIe siècle. |
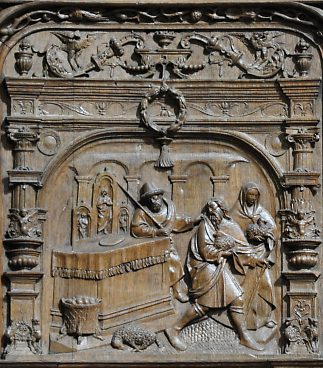
Joachim n'ayant pas d'enfant, son offrande est refusée
au Temple.
Bas-relief du XVIe siècle. |
|
| LES STATUES ORANTES
ET GISANTES DE LA BASILIQUE SAINT-DENIS |
|

Les priants et gisants dans le bas-côté nord de la basilique. |

Monument funéraire de Louis XII et d'Anne de Bretagne.
C'est l'un des plus imposants monuments funéraires de la nécropole.
Les quatre vertus cardinales entourent les piliers qui soutiennent
la plate-forme.
Cliquez sur l'image. |

Statues de Louis XVI et de Marie Antoinette
dans la chapelle Saint-Louis créée en 1830.
Les statues du second plan sont celles qui surmontent le tombeau de
François Ier. |
|
La
nécropole royale de Saint-Denis.
Au début de son existence, la nécropole
de Saint-Denis n'était rien d'autre qu'un cimetière.
On le désignait dans son testament afin d'être
enterré aux côtés de saint Denis et de
ses compagnons, Rustique et Eleuthère, tous trois martyrs
de l'Église. Selon les historiens, la reine Arnegonde
(† ~565-570) aurait été la seule personne
de sang royal à choisir Saint-Denis
- et ceci à titre personnel. En effet,, les rois mérovingiens
préféraient être enterrés là
où ils possédaient quelque attachement : leur
résidence habituelle, un palais qu'ils appréciaient
ou encore un établissement religieux dont ils étaient
fondateur ou bienfaiteur. On trouvait ainsi des sépultures
royales à Poitiers,
Soissons, Metz ou Arras.
Et, bien sûr aussi, à Paris.
Dagobert, mort en 639, choisit Saint-Denis parce qu'il y avait
des attaches : il était tout simplement le bienfaiteur
de l'abbaye. Avec la dynastie carolingienne naissante, le
choix de Saint-Denis s'imposa à Charles Martel et Pépin
le Bref (Pépin y avait reçu l'onction en 754).
Suivirent Charles le Chauve et cinq membres de sa famille.
Il revient aux Capétiens de faire reconnaître
la nécropole de l'abbaye comme le lieu obligé
du repos des rois de France. Il y a à cela deux explications.
D'une part, reprendre la tradition carolingienne, c'est affirmer
la légitimité des nouveaux souverains.
|
D'autre part, certains des premiers
rois capétiens furent tout bonnement abbés laïques
de Saint-Denis. Vont ainsi s'y faire enterrer : Eudes et Hugues
Capet, Robert le Pieux et Henri Ier. Sans oublier que l'énergie
de Suger, au XIIe siècle, fit de cette habitude une
véritable loi.
Quand, en 1108, Philippe Ier choisit Saint-Benoît-sur-Loire
et, en 1180, Louis VII Le Jeune, l'abbaye cistercienne de
Saint-Port de Barbeau qu'il avait fondée, les moines
de Saint-Denis déclenchèrent un tollé.
Néanmoins le lien entre l'abbaye et la Couronne se
renforça : Louis VI le Gros lui reconnut un droit de
dépouilles. Elle fut désormais considérée
comme la gardienne officielle des objets symboliques de la
royauté : les Regalia.
Le principe de l'abbatiale comme nécropole royale était
désormais respecté. Hormis Louis XI, Louis XVI
et Louis XVII, tous les rois de France de Louis VII à
Louis XVIII furent enterrés à Saint-Denis. (Louis
VII avait été inhumé à Barbeau,
mais, en 1817, Louis XVIII fit revenir sa dépouille
à Saint-Denis.) Aujourd'hui la nécropole compte
plus de 70 gisants et tombeaux. C'est un lieu unique en Europe.
Source : «Saint-Denis,
la basilique et le Trésor», Dossiers d'Archéologie,
mars 2001, article de François Baron.
|
|

Les apôtres du tombeau de Louis XII et d'Anne de Bretagne. |

Louis XVI priant (réalisé en 1830). |

Le tombeau de François Ier (1556).
Ce monument est une commande d'Henri II à Pierre Bontemps en
1550.
Il provient de l'abbaye des Hautes-Bruyères dans les Yvelines. |
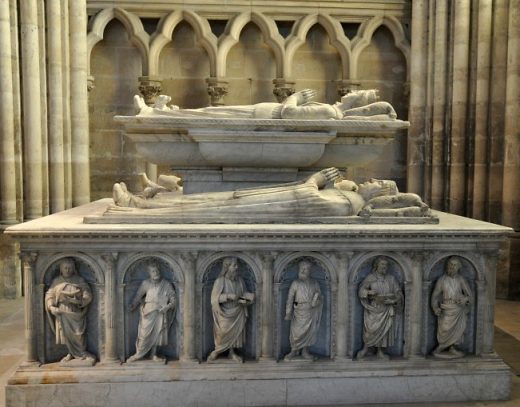
Quatre gisants en marbre dans la chapelle Saint-Michel (XVIe siècle).
Ce monument vient de la chapelle des Célestins à Paris.
Charles et Louis (ducs d'Orléans), Valentine Visconti, Philippe
(comte de Vertus). |

Gisant d'Henri II. |

Gisant de Catherine de Médicis. |

Trois chérubins sur le monument de cœur de François
II.
Sculpture en marbre du Primatice, 1572
Provient de l'église des Célestins. Ramenée
à Saint-Denis en 1818. |

Le tombeau d'Henri II et de Catherine de Médicis.
L'un des plus imposants de la nécropole avec ceux
de Louis XII et de François Ier |

Gisant de Robert II d'Artois, dit l'Enfant. |

Gisant de Clémence de Hongrie, deuxième femme
de Louis X le Hutin. |
|
| LES CRYPTES DE
SUGER ET D'HALDUIN |
|

La crypte archéologique.
C'est là qu'étaient situées les sépultures de Denis,
Rustique et Eleuthère. |

Chapelle avec son autel et ses deux vitraux. |
|
La
crypte. Pour établir l'assise de sa
cathédrale, Suger fit construire une crypte bordée
de sept chapelles rayonnantes, exactement situées
sous les chapelles rayonnantes du déambulatoire
au-dessus.
|
|
|

Un couloir dans la crypte de Suger. Les piliers massifs supportent
le chœur de la basilique au-dessus. |
 |
|

Chapiteau avec quatre prélats. |

Chapiteau avec paysan et charrette. |
«««---
Les dalles funéraires dans le caveau des Bourbon
(ou chapelle d'Hilduin).
Les murs et les chapiteaux de cette chapelle
remontent au plus tard au XIIe siècle. |
|
|
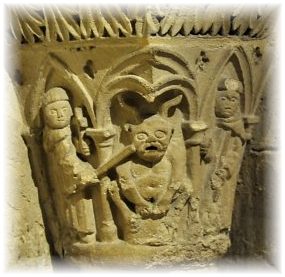
Chapiteau montrant un démon battu par des moines. |

Chapiteau avec deux prélats. |
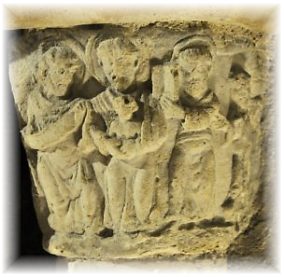
Chapiteau avec des prélats. |
|
|

L'orgue de tribune a été construit par Aristide
Cavaillé-Coll et mis en place en 1840.
|

Ornementation et renommées sur la tourelle centrale (XIXe
siècle). |
|

La nef et l'orgue de tribune vus du tribune. |
Documentation : «Saint-Denis, la basilique
et le Trésor», brochure éditée par Dossiers
d'Archéologie, mars 2001
+ «La cathédrale Saint-Denis», brochure d'Alain
Erlande-Brandenburg, Éditions Ouest-France. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|