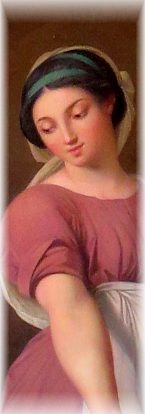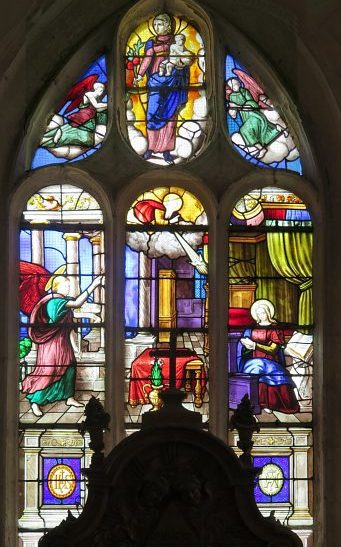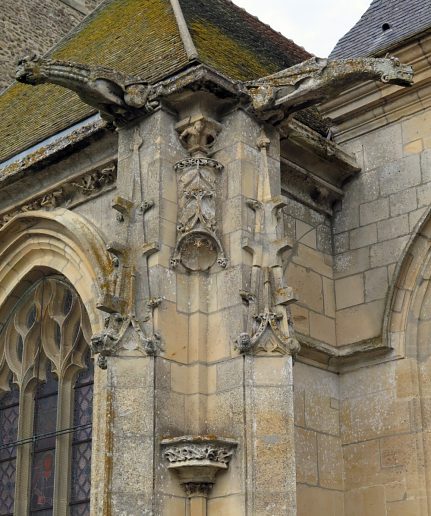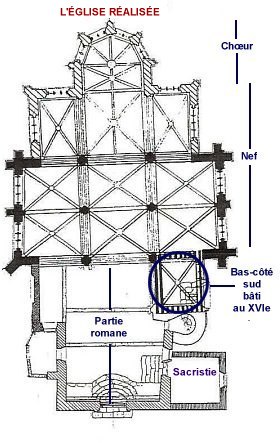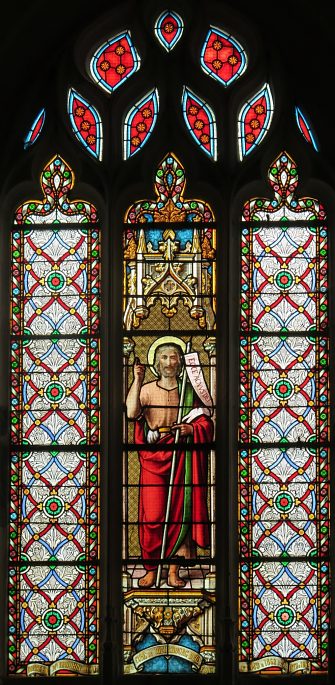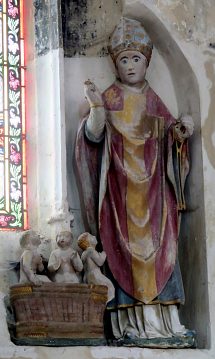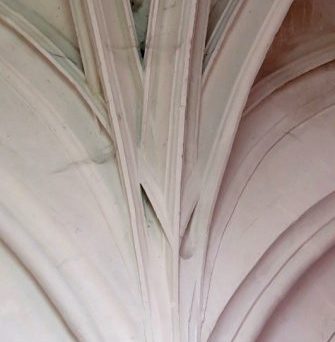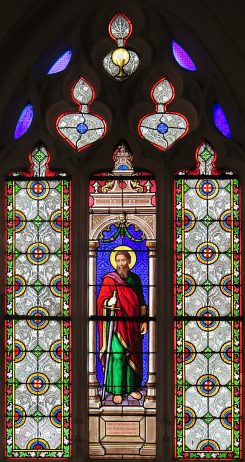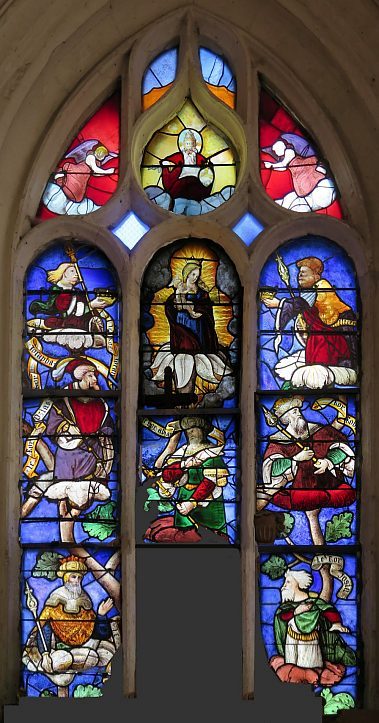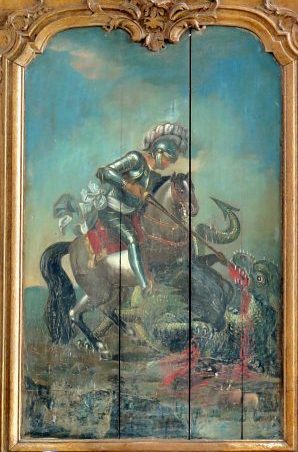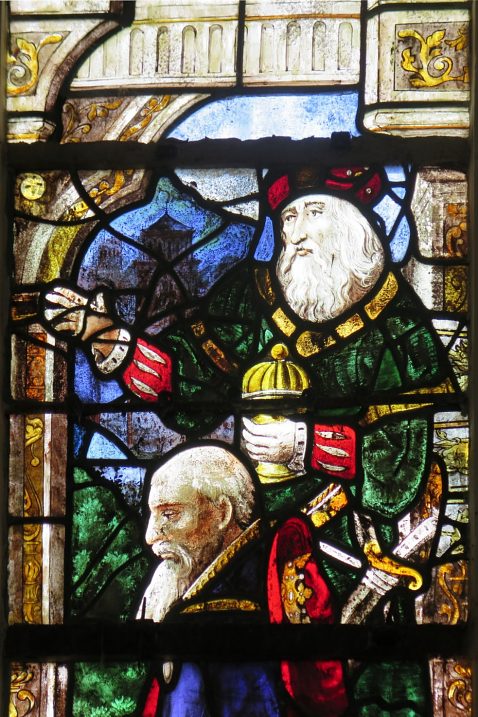|
|
 |
 |
Dans sa plus grande partie, l'église
de Richebourg est du XVIe siècle. Elle est riche de quelques vitraux
Renaissance et d'œuvres d'art (tableaux et statues) qui retiennent
l'attention. Malheureusement, il est rare qu'elle soit ouverte.
L'édifice se compose de deux parties bien distinctes. La partie
ancienne, située à l'ouest, montre des éléments romans du XIIe siècle.
L'origine gallo-romaine du village étant confirmée par des sources
abondantes, il est logique qu'une chapelle romane ait été érigée
là dans les temps anciens.
Au début du XVIe siècle, Saulx-Richebourg est un petit village,
fief du seigneur de Sabrevois. Celui-ci décide de rebâtir l'église.
L'origine de cette décision a depuis longtemps suscité l'intérêt
des historiens locaux. On a évoqué le repentir d'un seigneur qui
aurait tué le curé dans son église. On a aussi parlé de l'arrogance
d'une famille qui voulait affirmer sa puissance face aux rivaux
du voisinage. En fait, une décision de ce genre, prise quelques
décennies après la fin de la guerre de Cent Ans, n'a rien
d'exceptionnel.
Toujours est-ll que l''édifice roman, sûrement bien délabré, allait
être remplacé par une grande église gothique. Les Sabrevois font
élever le donjon de leur château et peut-être aussi
la demeure seigneuriale de la Troche. Dans le même temps ou peu
après, ils lancent la construction de l'édifice cultuel. Le transept
est érigé, puis prolongé d'un chœur, surmonté d'une toiture à forte
pente. La partie extérieure est embellie de sculptures gothiques,
de gargouilles, d'un ruban sculpté sous les chéneaux et même,
selon la brochure de la paroisse, d'un garde-corps pour se déplacer
sur les chéneaux au-dessus des gargouilles !
Et puis les travaux s'arrêtent sans que la raison en soit connue.
Les Sabrevois avaient-ils vu trop grand compte tenu de la population
du village ? Si le départ des ogives de la nef gothique prévue
est bien visible, c'est pourtant la petite nef romane qui va subsister.
De cette nef, on refait la toiture et la charpente. En 1603, le
haut clocher est terminé. Au XIXe siècle, il recevra un toit en
flèche entouré de quatre clochetons.
On ne sait rien de l'histoire de l'église jusqu'au passage de Prosper
Mérimée en 1852. Découvrant son intérêt et son délabrement, il obtient
les fonds nécessaires à sa restauration et demande son classement
aux Monuments historiques. Ce sera chose acquise en 1862. Supprimé
en 1886, ce classement est rétabli en 1905.
L'arrêt des travaux, intervenu vers la fin du XVIe siècle, a entraîné
une modification totale de l'affectation des parties gothiques construites
: ce qui devait être le transept et la grande travée du chœur est
devenu nef (voir les plans
plus bas). Quant à la petite nef romane, son état de dégradation
actuel n'incite pas le visiteur de l'église à y pénétrer...
On peut résumer l'intérêt de l'église Saint-Georges à deux facteurs
: ses deux vitraux
Renaissance dont un bel Arbre
de Jessé de 1612 et une luxuriante architecture gothique flamboyante
: les nervures s'y multiplient à tel point qu'on y trouve même des
entrelacements
de retombées d'ogives, une caractéristique très rare dans les
voûtes gothiques.
|
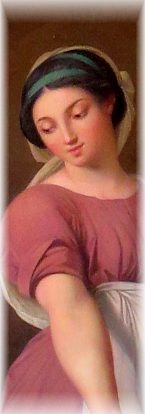 |

La nef et le chœur gothiques de l'église Saint-Georges. |
|
|
|
|

L'église Saint-Georges vue depuis le nord.
La partie gothique est à gauche et au centre.
La tour fait aussi partie de la construction gothique.
Le toit en flèche à quatre clochetons date du XIXe siècle. |

Le chevet gothique de l'église avec ses fenêtres
en tiers-point aux dessins de remplage variés. |
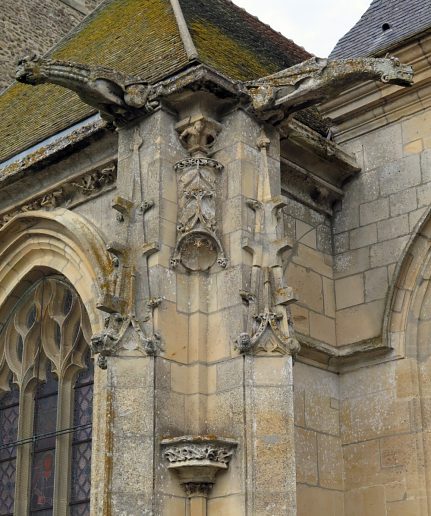
Vestiges de la partie gothique flamboyant
avec gargouilles, dais, console et pinacle à crochets.
|
|

Vestiges de la partie gothique flamboyant
avec gargouilles, dais, console et pinacle à crochets. |

Porte gothique du côté sud.
XVIe siècle. |
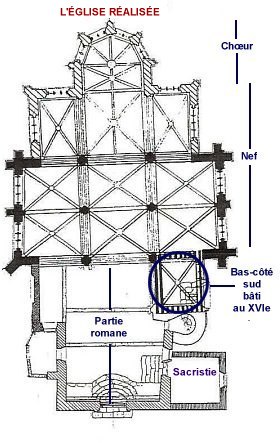
Plan de l'église Saint-Georges.
d'après le plan de Gilles Métairie dans la brochure de la paroisse.
Passez la souris sur l'image pour voir le plan de l'église
prévue. |
|
Plan
de l'église et architecture intérieure.
Le plan de l'édifice est indispensable pour en
saisir toute la bizarrerie. La nef romane qui subsiste
aurait dû faire place à une nef gothique
de plusieurs travées. L'église se serait
poursuivie à l'est par un transept de deux travées,
clos par un chœur d'une large travée avec
absidioles nord et sud, large travée prolongée
par une autre plus étroite, puis par une abside
à quatre pans.
Sans nef gothique, les éléments bâtis
au XVIe siècle ont dû être réanalysés.
Le transept est devenu nef avec bas-côtés
nord et sud. La large travée prévue pour
le chœur vient maintenant s'ajouter à cette
nef. Quant au chœur, il se contente d'une travée
étroite et d'une abside.
De la nef gothique prévue, seul a été
réalisé le début du bas-côté
sud, là où se trouve la porte d'entrée
de l'église, au-dessous du clocher.
La partie romane est riche d'une voûte charpentée
avec entraits et engoulants sculptés. Malheureusement,
un filet de protection assez serré a été
tendu au-dessus de la voûte, rendant impossible
l'observation des ornements romans. D'après la
brochure rédigée par la paroisse, les
armes des Sabrevois, constructeurs de l'église
au XVIe siècle, sont visibles sur l'une des poutres.
|
|
|
|
|

La nef vue et le bas-côté sud.
Les tombées d'ogives tombent en pénétration dans
les piliers, endroit parfois marqué d'un discret chapiteau.
À part l'Arbre de Jessé
au-dessus de l'autel absidiai sud, tous les vitraux visibles ici sont
du XIXe siècle. |

À l'arrière-plan, la partie romane constitue l'avant-nef
de l'église. |
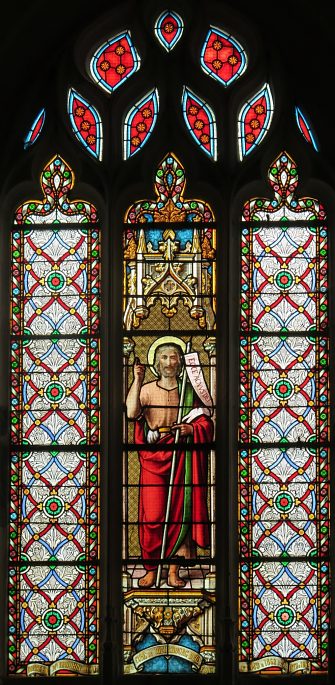
Saint Jean-Baptiste dans un vitrail du XIXe siècle.
Atelier Eugène Moulin à Dreux, 1872. |

Signature du maître-verrier
Eugène Moulin à Dreux, 1872
au bas du vitrail
de saint Paul. |
|

Retombées d'ogives complexes dans la
partie gothique. Voir l'exemple
n°2. |

Deux masques de bronze ornent
la cuve baptismale en marbre. |
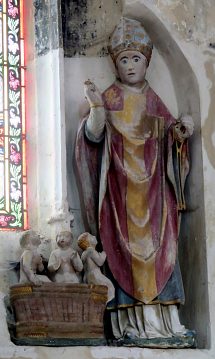
Statue de saint Nicolas
Pierre, XVe ou XVIe siècle. |
|
|
««---
Des retombées d'ogives complexes.
La construction de l'église gothique s'est arrêtée brutalement
au XVIe siècle sans qu'on n'en connaisse ni la date
précise ni la raison. Manque de fonds ? Décès
de l'architecte ? Prise de conscience de la trop
grande surface de l'édifice par rapport au nombre d'habitants
du bourg ? Guerre ? Épidémie ? Famine ?
Dans la brochure réalisée par la paroisse, Jacqueline
Gontier liste les possibilités sans y répondre.
On donne ici une autre explication en partant d'un constat.
La photo ci-contre donne en gros plan le profil des
retombées d'ogives dans l'un des deux bas-côtés gothiques.
On y voit une nervure passant au-dessous d'une autre.
En fait, c'est un entrelacement, un «réseau sculpté»
que l'on ne rencontre pratiquement jamais dans une église
gothique. Une photo plus
bas montre un autre cas d'entrelacements. En général,
les nervures tombantes viennent se rejoindre sur le
chapiteau ou au-dessus du chapiteau dans un bouquet
ordonné, toujours simple et logique.
Un dessin architectural aussi rare avait de quoi rendre
les maîtres d'ouvrage perplexes ! Si l'on y ajoute la
multiplication des nervures dans les arcs et l'incrustation
systématique de clés
pendantes au sommet des ogives, les commanditaires
n'auraient-ils pas pris peur devant la complexité mise
en œuvre par l'architecte et, bien sûr, devant le coût
qui en résultait ?
D'où l'hypothèse d'un arrêt des travaux dû au renvoi
de l'architecte. Les maîtres d'ouvrage en auraient alors
cherché un autre, plus conventionnel... qu'ils n'auraient
pas trouvé. Ou bien ils auraient décidé de se contenter
de la partie gothique déjà bâtie : la dimension de l'édifice
aurait été jugée suffisante ou encore les fonds disponibles
auraient été dirigés vers la vitrerie.
Quoi qu'il en soit, cet entrelacs de nervures à la retombée
des ogives est une curiosité de l'église Saint-Georges.
|
|

La cuve baptismale, du XVIIIe siècle, est classée
monument historique.
La cuve est soutenue par une colonne galbée en pierre.
À droite, la bannière de saint Georges. |

La libre seigneuriale sur l'élévation d'un bas-côté. |
|
Litre
seigneuriale.
Une litre polychrome, dont les vestiges sont difficilement
lisibles, parcourt les élévations nord
et sud de la partie gothique. On arrive à y distinguer
les armoiries de la famille des Sabrevois.
|
|
|

Sainte Catherine d'Alexandrie
foulant au pied l'empereur Maximin.
Pierre, XVe siècle. |

Ici s'arrête la partie gothique construite au XVIe siècle. Le point
de départ des ogives de la future nef gothique était prévu.
Dans la partie qui est restée romane, la charpente en berceau (refaite
au XVIe siècle) est couverte
d'un filet de protection qui rend impossible l'observation des engoulants. |
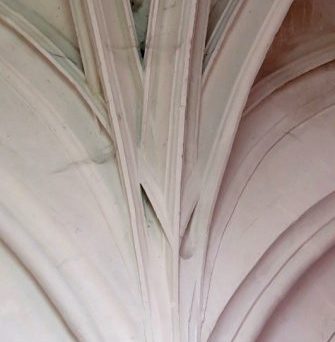
Retombées d'ogives complexes dans la partie gothique. |
|
Les
vitraux de l'église Saint-Georges.
Trois verrières, issues totalement ou partiellement
de la Renaissance, sont réellement intéressantes.
Deux sont entièrement ou presque du XVIe siècle
: l'Arbre
de Jessé et l'Adoration
des Mages. Tandis que la troisième n'offre,
de l'époque Renaissance, que le seul tympan
avec une Vierge à l'Enfant entre deux anges.
Le reste des verrières, d'après la signature
qu'on y découvre, peut être attribué
à Eugène Moulin, peintre verrier installé
à Dreux.
Ces verrières dateraient du début des
années 1870.
On y voit le Sacré-Cœur, saint
Paul et saint
Jean-Baptiste. Chacun d'entre eux est entouré
de deux lancettes à thème géométrique
polychrome, selon l'exemple donné plus
haut.
Les Évangélistes figurent dans le tympan
des vitraux qui ornent les quatre pans du chœur.
Notons que c'est à Eugène Moulin que l'on
doit le bel Arbre de Jessé, daté de 1877,
qui orne une chapelle de l'église Saint-Pierre
de Dreux,
une ville située à vingt-cinq kilomètres
de Richebourg.
|
|
| Deux Évangélistes
au tympan des vitraux du chœur.
Années 1870. |
|

Saint Jean |

Saint Matthieu |
 |
|
|
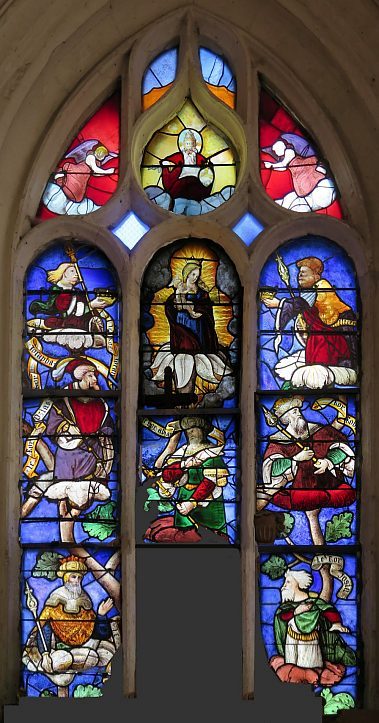
Baie 6 : l'Arbre de Jessé, 1612
Le panneau central du bas (où l'on voyait Jessé)
a disparu.
Il est depuis bouché par de la pierre. |

Baie 6, détail : le roi Roboam. |
|
Baie
n°6 : vitrail de l'Arbre de Jessé, 1612 (2/2).
---»» Sauf exception, un phylactère
indique les noms des rois. On a ainsi : Josapha, Osias,
Achaz, Roboam et Josias. Le roi à la magnifique
tunique peinte au jaune d'argent (donné ci-contre)
n'est pas représenté avec son nom. Si
ce n'est pas le roi Salomon, il pourrait s'agir de Manassé,
toujours représenté dans l'Arbre avec
un habit somptueux.
Dans un Arbre, dessiner des rois sortant d'une corolle
de fleur est une pratique assez ancienne. On la retrouve
abondamment dans l'Arbre attribué à Jean I Macadré,
et daté de 1518, qui orne une fenêtre de l'église Sainte-Madeleine
à Troyes.
On la retrouve dans le chef-d'œuvre
d'Engrand le Prince à Beauvais
en 1522. Au XIXe siècle, elle est reprise dans l'Arbre
peint par Eugène Moulin à l'église Saint-Pierre
de Dreux.
On remarquera que les personnages du tympan sont trop
petits et maladroitement intégrés dans la mouchette
et les deux soufflets. Leur dessin n'est clairement
pas à la hauteur de ceux de l'Arbre. Pour Guy-Michel
Leproux, c'est sans doute là le travail du verrier de
Mantes, Quentin de Clèves.
|
|
|
 |

Statue de sainte Barbe
Pierre, XVIe siècle.
«««---
Baie 6, détail :
la Vierge tenant l'Enfant
dans l'Arbre de Jessé.
Atelier Jean Riou, 1612. |
|
|
Baie
n°6 : vitrail de l'Arbre de Jessé, 1612 (1/2).
Longtemps daté du XVIe siècle (comme le
fait le Corpus Vitrearum en 1978), ce vitrail
est maintenant daté de manière certaine
de l'année 1612. L'information est donnée
par Guy-Michel Leproux dans l'ouvrage Vitraux parisiens
de la Renaissance paru en 1993.
En 1612, un marché est passé par un verrier
de Mantes, Quentin de Clèves, à Jean
Riou, peintre verrier parisien. À charge
pour ce dernier de créer un vitrail représentant
un Arbre de Jessé de huit pieds sur 6, soi 2,40
m sur 1,80m (c'est-à-dire les dimensions exactes
de la fenêtre de l'église Saint-Georges),
avec un tympan représentant le Père céleste
entre deux anges.
Un examen précis du vitrail montre que Jean Riou
ne fait pas usage de la technique des émaux,
un art déjà connu, mais encore difficile
à utiliser à cette époque (voir
le texte sur l'émaillerie du verre à l'église
Saint-Martin-ès-Vignes
à Troyes).
En revanche, le verrier utilise massivement la sanguine
et le jaune d'argent (la gloire qui entoure la Vierge
est obtenue de cette manière). Il use aussi d'une
belle variété de grisailles pour les barbes
des rois de Juda.
Guy-Michel Leproux écrit : «Jean Riou traite
le thème de l'Arbre de Jessé de façon
traditionnelle, mais il a l'habileté de ne pas
multiplier les personnages dans cette fenêtre
de petites dimensions et il parvient à conserver
à son œuvre une grande lisibilité.»
Le panneau central du bas, qui représentait à
l'évidence Jessé, a disparu. Le panneau
est maintenant bouché par de la pierre.
Les sept rois de Juda, peints en couleurs assez vives,
surgissent de corolles de fleurs. Les deux du haut offrent
chacun leur couronne à la Vierge.
---»» Suite 2/2
ci-dessous à gauche.
|
|

Baie 6, détail : le roi Salomon ou le roi Manassé.
Jean Riou, 1612. |
|
 |

Baie 6, détail : le roi Roboam.
| «««---
Baie 6, détail : un roi de Juda offre sa couronne
à la Vierge. |
|

Baie 6, détail : le roi Josias.
Jean Riou, 1612. |

Le bras nord du transept est devenu une partie du bas-côté nord de
la nef.
Ici, vue sur la chapelle nord et l'autel Saint-Georges. |
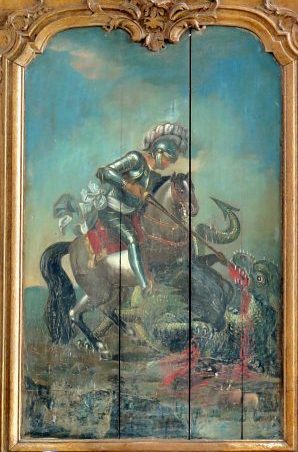
Saint Georges terrassant le Dragon.
Peinture sur bois qui pourrait être du XVIIe siècle.
Autel Saint-Georges dans le bas-côté nord de la
nef. |

Notre-Dame de Richebourg
Pierre, fin du XVe ou début du XVIe siècle. |
|
Notre-Dame
de Richebourg.
Par son style, cette statue se rapproche plus de la
sculpture troyenne que de la sculpture d'Île-de-France.
Un panneau dans la nef révèle que cette
œuvre, qui suscitait une grande dévotion,
a été cachée par les paroissiens
pendant la Révolution et les dernières
guerres.
|
|
|
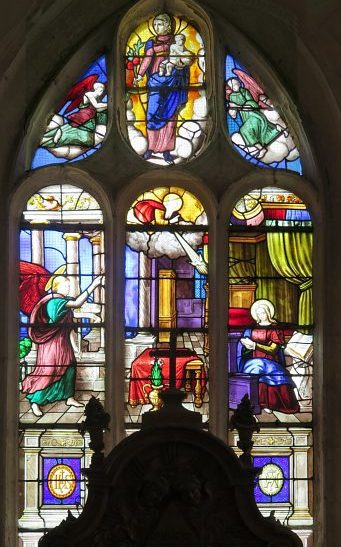 |
«««---
Baie n°5 : l'Annonciation.
Lancettes du XIXe siècle. Tympan du milieu du XVIe
siècle. |
|

Baie n°5, tympan : Vierge à l'Enfant entre
deux anges.
Milieu du XVIe siècle. |
|
Baie
n°5 : vitrail de l'Annonciation.
La scène principale est, pour l'essentiel, du
XIXe siècle. En revanche, le tympan comprend
en majorité des vestiges datés du milieu
du XVIe siècle. Si les deux anges qui entourent
la Vierge à l'Enfant semblent bien en totalité
du XVIe, il est clair que le visage de la Vierge, disproportionné,
est une retouche du XIXe siècle.
|
|
|

Baie n°11 : l'Adoration des Mages.
Premier tiers du XVIe siècle. |

Baie n°11, détail : la Vierge. |
|
|
Baie n°11 : vitrail de l'Adoration des Mages.
C'est, dans l'église Saint-Georges, le second grand
vitrail daté de la Renaissance. Le Corpus Vitrearum
donne le premier tiers du XVIe siècle.
Dans le tympan, les quatre angelots qui meublent les
deux soufflets paraissent anciens, tout comme les trois
angelots de la mouchette supérieure.
Les mages sont habillés de beaux costumes typiques de
la cour de France à la Renaissance.
Il faut renouveler l'hypothèse d'un transfert, au début
du XVIe siècle, de l'utilisation des fonds disponibles.
L'Arbre
de Jessé et l'Adoration des Mages, vitraux d'une
qualité certaine, semblent être d'origine. On peut penser
d'autres fenêtres étaient aussi ornées de verrières
de qualité, malheureusement perdues, et sans aucune
traçabilité de la perte.
D'où l'idée que, une fois la décision prise de ne pas
construire la nef gothique, les fonds de la famille
Sabrevois et tous les autres dons auraient été utilisé
pour parer l'église d'une vitrerie historiée de très
bonne qualité.
|
|

Baie n°11, détail : le Mage Gaspard. |
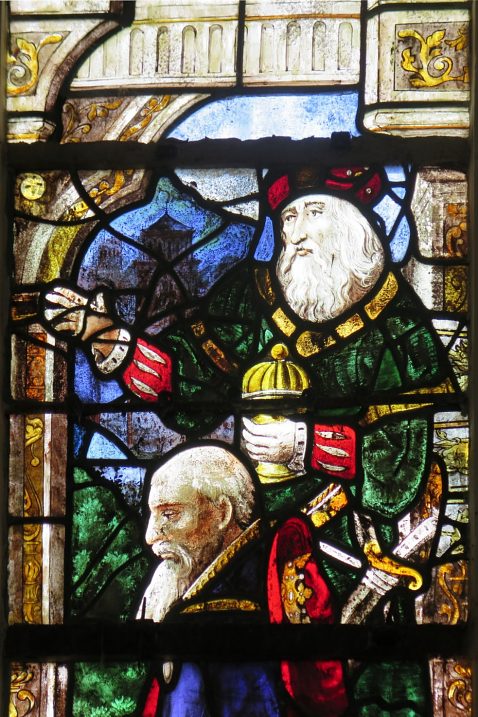
Baie n°11, détail : les Mages Melchior et
Balthazar. |
|
| LE CHŒUR
DE L'ÉGLISE SAINT-GEORGES |
|

Le chœur de l'église et ses boiseries datées du XVIIe
siècle.
À droite, l'autel qui termine le bas-côté sud.
Au sol (sous le tapis rouge), la pierre tombale de Charles de Sabrevois
(† 1537). |

Le chœur est couvert par deux voûtes ogivales, la dernière
étant à quatre pans. |

Clé pendante de style Renaissance dans le chœur. |

Clé pendante dans la 1ère travée de la nef.
|

Jésus avec Marthe et Marie
ou «Une
seule chose est nécessaire»
par Savinien Petit, 1856. |

L'autel Louis XV est en bois doré et peint.
La gloire qui surmonte le tabernacle est du XVIIIe siècle.

|
Les tableaux
de Savinien Petit (1815-1878).
Savinien Petit est un peintre du XIXe siècle totalement
méconnu. En 1841, il entre à l'Ecole des Beaux-Arts
où il reçoit les conseils d'Ingres. Après un
séjour à Rome, il rentre à Paris et se
consacre à la peinture religieuse.
Ses toiles sont rares. À l'heure actuelle, il est surtout
connu pour ses dessins qui font parfois l'objet d'expositions.
Le chœur de l'église néo-romane Saint-Gervais
à Rouen
est orné d'une peinture murale de six saints réalisée par
Savinien Petit.
|
|

Jésus et la Samaritaine
par Savinien Petit, 1863. |

Le chœur de l'église Saint-Georges est éclairé
par des vitraux du XIXe siècle.
Aux tympans des vitraux : les quatre Évangélistes (voir
Jean et Matthieu plus
haut). |

Les nefs gothique et romane vues depuis le chœur.
Dans la nef romane, le filet de protection de la voûte (refaite au
XVIe siècle) masque tous les ornements de la charpente. |
Documentation : «L'église de Richebourg», brochure
éditée par la paroisse, 2002
+ «Corpus Vitrearum, Les vitraux de Paris, de la Région parisienne,
de la Picardie et du Nord-Pas-de-Calais», Éditions du CNRS, 1978
+ «Vitraux parisiens de la Renaissance», Délégation à l'Action artistique
de la Ville de Paris, 1993
+ «Dictionnaire des églises de France», éditions
Robert Laffont, 1966
+ Panneaux d'information dans la nef. |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|